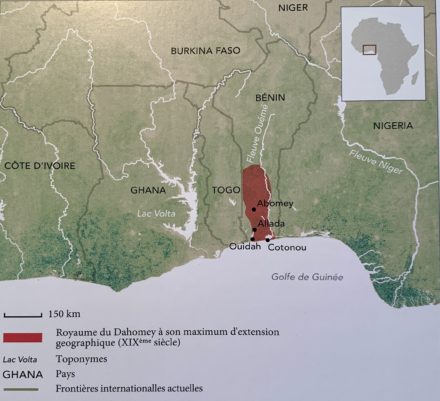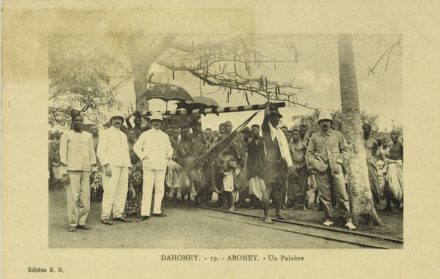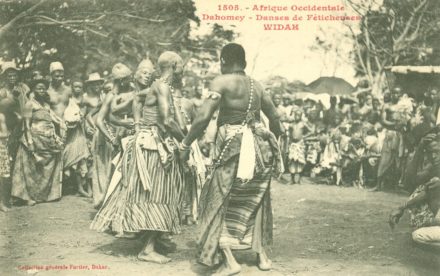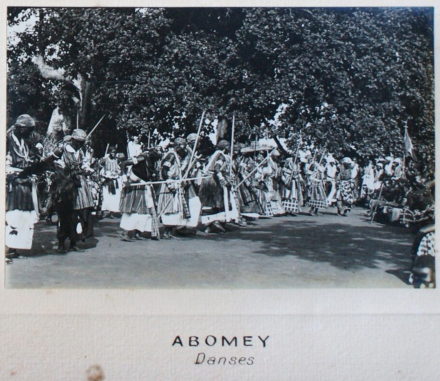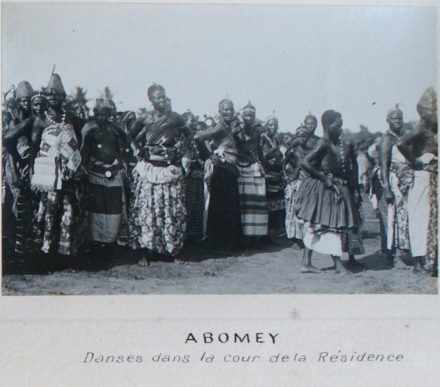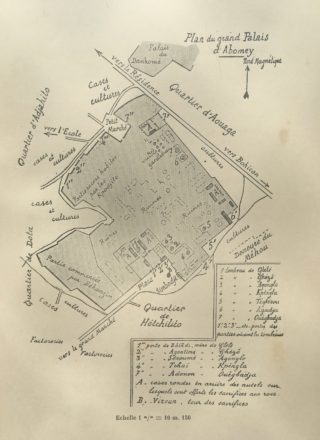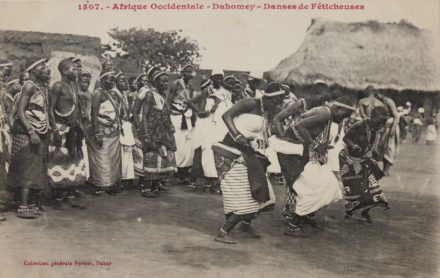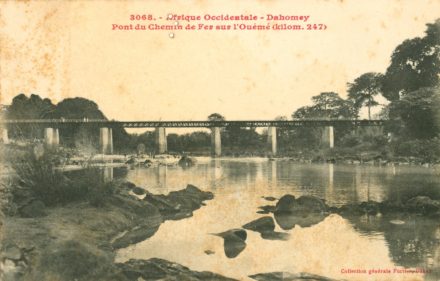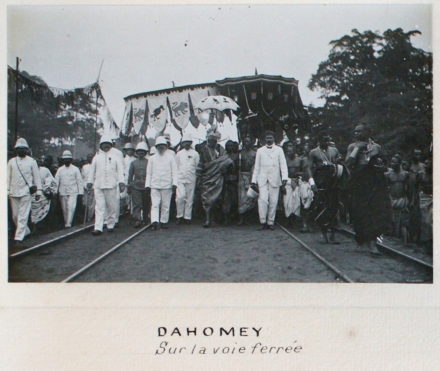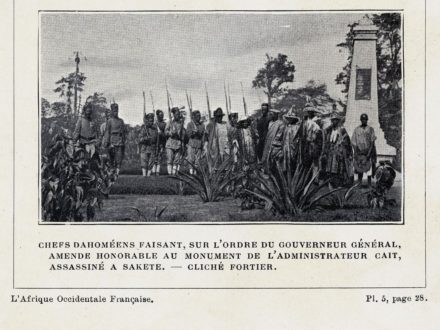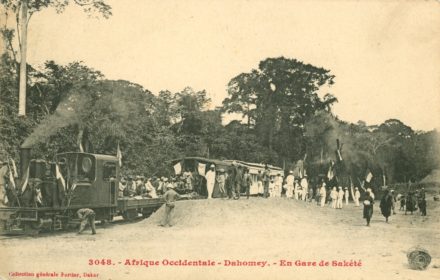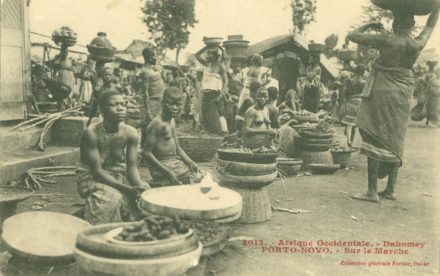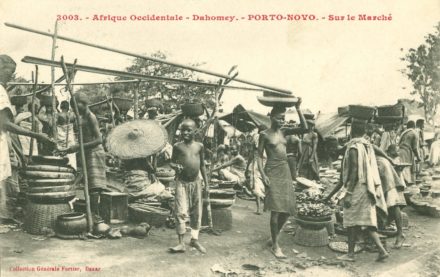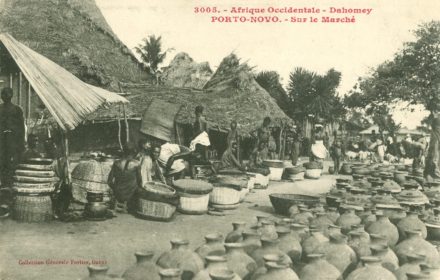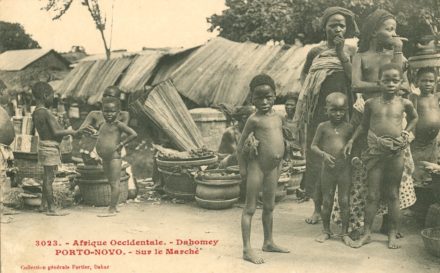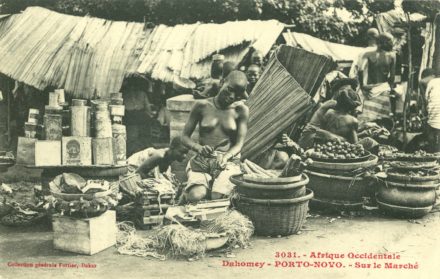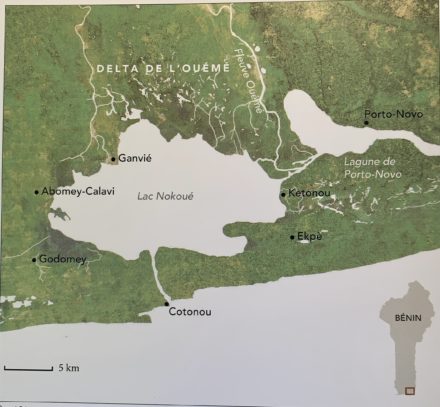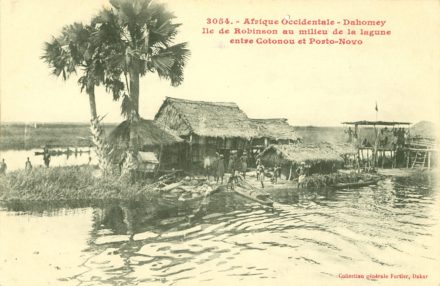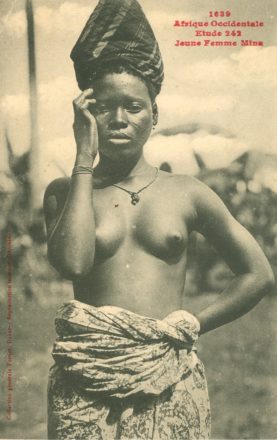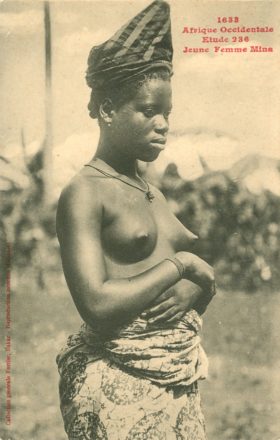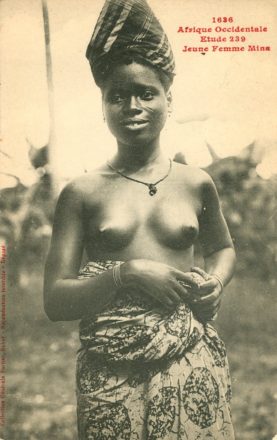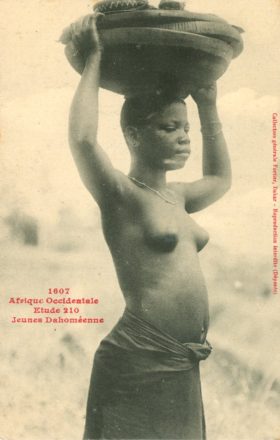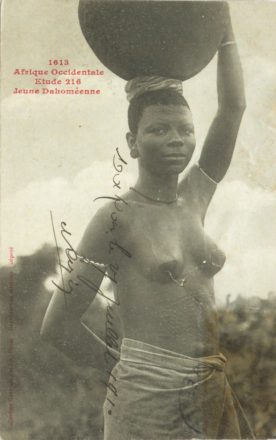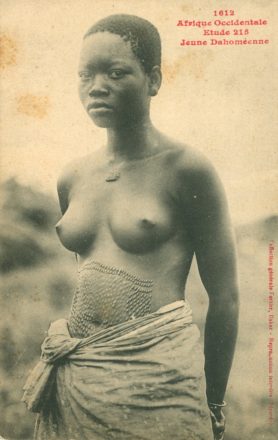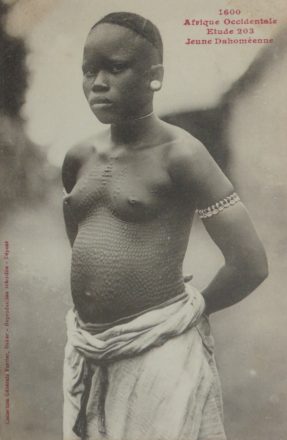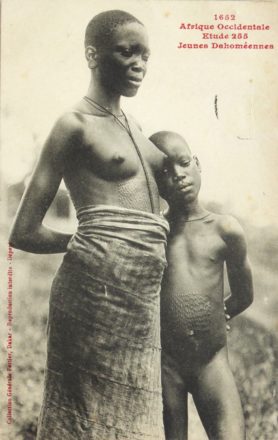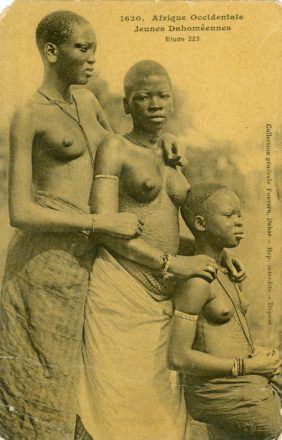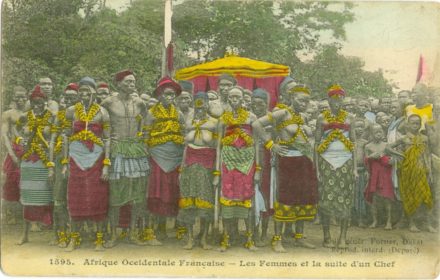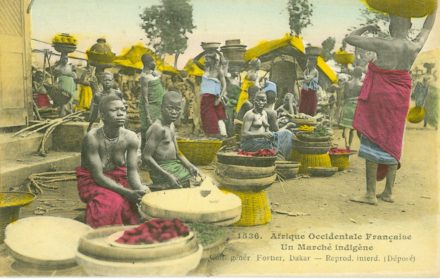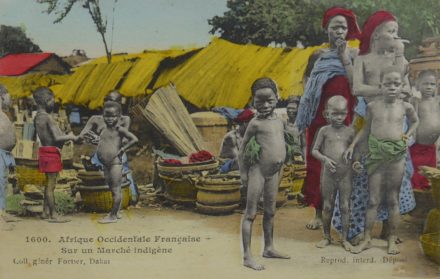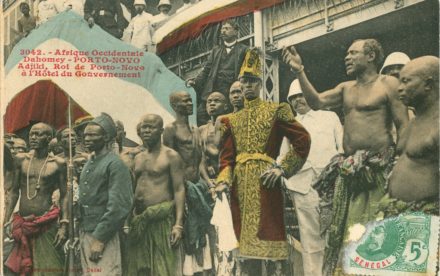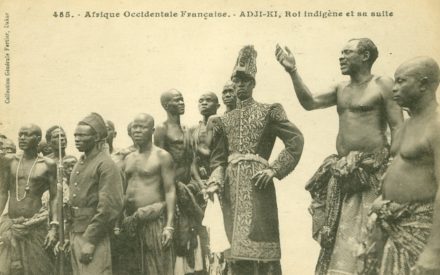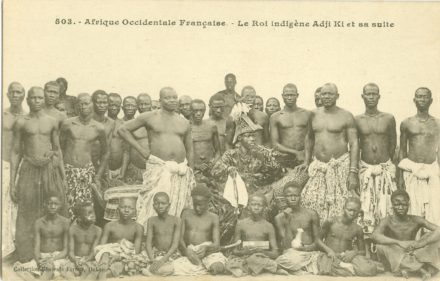Remerciements: Les auteurs remercient Mariângela Nogueira, Paulo Fernando de Moraes Farias et João José Reis pour leur généreuse relecture du manuscrit et leurs suggestions. Ils remercient également leurs interlocuteurs béninois qui ont aidé à déchiffrer certaines des images sur le vodun : à Abomey, Constant Legonou et Bacharou Nondicharo et à Ouidah, Daagbo Avimadjenon Ahouandjinou et Daagbo Hunon Houna II.
INTRODUCTION
Le Dahomey et le Brésil
En 1908 et 1909, le photographe Edmond Fortier effectue deux voyages en Afrique de l’Ouest, dans la colonie du Dahomey, aujourd’hui République du Bénin. Accompagnant les autorités coloniales françaises, il part de la capitale sénégalaise de Dakar, où il habite, et se consacre à photographier les rencontres de l’entourage avec les populations dahoméennes, avec leurs rois et ministres ; il enregistre cérémonies, célébrations et scènes de la vie quotidienne. La compilation de ces images, diffusées à l’origine sous forme de cartes postales, se justifie par leur valeur documentaire, tant d’un point de vue historique qu’ethnographique.
Elles nous montrent une époque où le colonialisme européen était déjà bien établi dans la région, bien que la résistance africaine ait continué à éclater dans des soulèvements occasionnels. Ils nous offrent aussi une rare occasion d’examiner, dans un temps passé mais persistant, une terre qui n’est pas très étrangère, spécialement au Brésil, puisqu’elle lui est historiquement et culturellement liée, en particulier au Nordeste. Ce lien résulte non seulement de l’histoire tragique de la traite des esclaves, qui pendant des siècles a amené des personnes de cette partie de l’Afrique, mais aussi d’un dialogue constant entre les deux rives de l’Atlantique qui se poursuit après l’arrêt de la traite en 1850 et encore à ce jour.
Au XVIIe siècle, le littoral de la future colonie du Dahomey reçut le triste surnom de « Côte des Esclaves ». C’était une portion de la Costa da Mina, selon le nom donné par les Portugais à cette partie du Golfe du Bénin. On y trouvait les royaumes d’Allada et de Ouidah, qui prospéraient grâce au commerce abject suscité par l’avide demande européenne. Cependant, dans les années 1720, le royaume intérieur du Dahomey, dont la capitale était Abomey, conquit et subjugua les populations d’Allada et de Ouidah.1 En accédant à la côte, il devint la puissance hégémonique de la région et l’un des principaux fournisseurs de captifs pour le trafic atlantique. Située entre le royaume ashanti à l’ouest et le royaume Oyo à l’est, la région dominée par le Dahomey avait une relative unité culturelle. Entre autres aspects, on y parlait des langues apparentées et inter communicables, que les linguistes ont traditionnellement appelées langues gbe (gbè). Les pratiques religieuses, bien que plurielles, éclectiques et dynamiques, présentaient également un degré relatif d’homogénéité, leur base commune étant la dévotion aux voduns (vodún), un mot qui, dans les langues gbe, désigne les dieux ou les mystères des forces invisibles.2
Entre 1750 et 1820, les rois du Dahomey envoyèrent à la cour portugaise au moins cinq délégations munies de cadeaux artisanaux pour solliciter le monopole du trafic à destination du Brésil. Ces relations diplomatiques avec Lisbonne et Bahia témoignent de l’importance stratégique que le Dahomey accordait à ses relations commerciales.3 Les captifs africains embarqués dans les ports du Dahomey pouvaient avoir des origines diverses : certains venaient de l’intérieur profond, d’autres de régions voisines et de langues, religions, habitudes et connaissances communes. Au Brésil, on les appelait globalement « minas » et, à Bahia également « jejes« . En fait, ces catégories plus larges coexistaient avec d’autres, à usage plus restreint, qui exprimaient leur diversité ethnique : Ladas (Ardas), Mahis (Maquis), Fon, Savalou, Agonli, Dagomé, Courana etc. La présence des Africains parlant les langues gbe au Brésil était notoire à partir du XVIIIe siècle, et à Bahia ils devinrent le groupe démographiquement majoritaire. Outre d’autres apports culturels, les jejes contribuèrent à la formation du candomblé. Leur dévotion au vodun offrait un modèle d’organisation de type ecclésial qui facilitait la recréation de pratiques religieuses d’origine africaine sur le sol brésilien.4 C’est pourquoi les images du début du XXe siècle de Fortier, qui représentent les cultes vodun au Dahomey (et en sont l’un des tout premiers témoignages photographiques) ont une très grande pertinence.
Les Jejes à Bahia étaient aussi, à partir de la fin du XVIIIe siècle, le principal groupe d’Africains affranchis. Une minorité d’entre eux parvinrent à une relative ascension sociale, participant aux corporations militaires, aux confréries catholiques et au commerce maritime ; ils devinrent l’embryon d’une « bourgeoisie » afro-brésilienne qui, dans les premières décennies du XIXe siècle, fut renforcée d’affranchis nagots de langue yoruba. C’est cette élite afro-bahianaise qui a mené le mouvement de retour en Afrique à partir de 1835, lorsque, après la « Révolte des Malês », les autorités bahianaises lancèrent une campagne de persécution systématique contre les Africains affranchis.5
Un grand nombre de Nagots, Haoussas, Tapas, Bornos et Jejes, ainsi que leurs descendants nés au Brésil, s’installèrent au XIXe siècle dans des villes de la côte africaine comme Aguè, Ouidah, Porto-Novo et Lagos, entre autres. Ces « rapatriés », dont le passé était lié à l’expérience de l’esclavage, rejoignirent la communauté marchande lusophone préexistante de commerçants portugais et brésiliens impliqués dans la traite jusqu’au milieu du XIXe siècle et, plus tard, dans l’économie du palmier à huile. Le groupe issu de cette rencontre, connu sous le nom d’agudas, était donc socialement et racialement hétérogène, comprenant des Portugais, des Brésiliens et des Africains. Cependant, ses signes d’identité étaient l’usage du portugais, et, pour la majorité, le catholicisme (à côté de l’islam et du culte des voduns et des orishas). Artisans qualifiés et marchands prospères, les Agudas constituaient une nouvelle élite locale, qui se mariait entre eux et se distinguait de la population indigène. Le patrimoine architectural qu’ils ont édifié dans plusieurs enclaves de la côte, à forte influence brésilienne, reste encore aujourd’hui (bien que souvent en ruines) une preuve de leur ancienne prospérité. Jusqu’à la fin du XIXe siècle, il y eut un flux constant de rapatriés en provenance du Brésil et, dans une moindre mesure, de Cuba. En fait, les Agudas ont continué à commercer avec Bahia, générant la circulation des personnes, des biens et des idées entre le Brésil et le Dahomey pendant tout le siècle. Les derniers navires marchands ont navigué entre Salvador et Lagos dans les années1890.6
Le mouvement de retour des affranchis agudas sur la Costa da Mina s’est produit parallèlement à la pression britannique pour mettre fin à la traite négrière dans l’Atlantique. Les attaques des croiseurs britanniques à l’encontre des navires négriers, commencées en 1810, s’intensifièrent dans les années 1830, et la traite devint une activité à haut risque. Dans ce contexte, la production d’huile de palme, avec une demande croissante de l’industrie européenne, apparut comme une voie alternative de « commerce licite » pour les trafiquants locaux et les marchands européens et brésiliens.
L’avancée de la frontière d’influence des Français au Dahomey eut lieu au milieu du XIXe siècle, simultanément à l’essor de l’économie de l’huile de palme et la nécessité d’assurer des ports d’expédition avec des avantages douaniers. Ces efforts ont eu comme résultat la signature de plusieurs traités avec les autorités locales et ont abouti à l’installation d’un protectorat français à Porto-Novo en 1863. Dès lors, la pénétration se poursuit et se traduit par l’occupation militaire du Dahomey, obtenue en 1892 avec la prise de la capitale Abomey par les troupes françaises et l’arrestation et la déportation de son roi Béhanzin (Gbεhanzìn) en Martinique en 1894. Avec l’installation de la colonie du Dahomey, la communication avec le Brésil diminua, mais le statut social et l’alphabétisation des Agudas conduisirent au recrutement de certains d’entre eux par l’administration française. Lors de la visite de Fortier en 1908, par exemple, certains des interprètes étaient agudas. À Porto-Novo travaillait Marçal Villaça, un membre de la famille Olimpio; et à Abomey, Ignácio Oliveira et Lucien da Assumption.7

Les relations entre le Brésil et le Dahomey prennent un nouveau souffle dans la seconde moitié du XXe siècle, grâce à des intellectuels comme Pierre Verger, photographe et français comme Fortier. Basé à Bahia depuis 1948, il commence à photographier les cultes des voduns et des orishas des deux côtés de l’Atlantique, et à étudier l’histoire de leurs « flux et reflux », étant l’un des premiers auteurs à attirer l’attention sur la communauté aguda de la Costa da Mina.8
Dans les années 1970 et 1980, avec le renforcement des mouvements sociaux noirs, le symbolisme mythique de l’Afrique, associé à la projection croissante de la religiosité envers les voduns et les orishas, a commencé à enrichir l’imaginaire de la négritude et l’agenda politique antiraciste.9 En outre, le continent africain et le thème des Agudas suscitèrent un intérêt intellectuel et académique. Dans ce processus, Pierre Verger, « messager entre deux mondes », contribua à la création, en 1982, du Musée afro-brésilien, avec une collection de pièces acquises au Bénin, et à la fondation, en 1988, de la Casa do Benim dans le centre historique de Salvador de Bahia. Il faut rappeler qu’en 1975, dans une tentative d’éradication de la mémoire coloniale, le Dahomey fut rebaptisé République populaire du Bénin, avec à sa tête un gouvernement d’orientation socialiste. Cette longue et variée histoire des relations entre le Brésil et le Dahomey/Bénin, dont nous n’avons esquissé que quelques-unes des caractéristiques les plus pertinentes, délimite le contexte de la publication de cet ouvrage qui, d’une part, apporte la preuve visuelle d’une culture politique, religieuse et quotidienne apparemment lointaine et, d’autre part, évoque la complexité et la diversité des pratiques et connaissances indissolublement liées aux populations africaines. Ce sont là des façons d’être et d’être dans le monde qui, dans la mémoire, sont encore activées et ravivées, ne serait-ce qu’obliquement, dans la vie quotidienne du peuple brésilien.
Ie PARTIE
Edmond Fortier et le Dahomey (1908-1909)
Le photographe Edmond Fortier, auteur des documents que nous commenterons ci-dessous, est né en Alsace en 1862, mais s’est installé à Dakar, dans la colonie française du Sénégal, en Afrique occidentale, dans la dernière décennie du XIXe siècle. Il a laissé une œuvre de plus de 4 000 images, publiées pour la plupart sous forme de cartes postales. Les négatifs originaux n’ont pas encore été trouvés. Pour étudier sa production il faut donc en collecter et organiser les éléments dispersés, depuis plus de cent ans, sous forme de correspondance. Dans cet ouvrage, nous nous focalisons sur les photographies prises en 1908 et en 1909 dans la colonie française du Dahomey. À l’âge de 46 ans, Fortier était à l’époque un photographe expérimenté. Il avait beaucoup voyagé en Afrique de l’Ouest, et avait visité même la ville reculée de Tombouctou visitant même Tombouctou, aux confins du Sahara, en 1906. Professionnel indépendant, il n’était pas seulement photographe, mais aussi éditeur et petit commerçant : il faisait imprimer ses cartes postales en France et les vendait dans sa papeterie de Dakar à des touristes de passage sur des transatlantiques y faisant escale et à des Européens vivant en Afrique.10

Bien que Fortier soit un étranger qui n’a passé que quelques jours dans la colonie du Dahomey, ses photographies, encore très peu étudiées, enrichissent notre connaissance de l’histoire du Bénin au début du XXe siècle. Il s’est sans doute souvent immiscé dans les situations représentées, créant des jeux de rôle. Détenteur d’une technologie de pointe pouvant servir à cataloguer et classer l’« autre », Fortier était un représentant emblématique de la domination coloniale. En contrepartie, intentionnellement ou non, sa façon de travailler a permis de documenter les expressions de la culture et de la religiosité africaines, contribuant ainsi à la mémoire collective des habitants de cette région. Comme nous le verrons, des circonstances favorables ont permis à Fortier de photographier des manifestations importantes de adeptes du culte aux voduns. Il a aussi photographié de multiples villes, comme Cotonou, Ouidah, Allada, Abomey et Sakété. Quant à la vie quotidienne des populations, il a visité de près le marché de Porto-Novo et a produit diverses images d’embarcations traversant le lac Nokoué (Noxwe).
Pour que les photographies reproduites sur cartes postales puissent servir de sources de recherche, il est essentiel de connaître les contextes dans lesquels elles ont été créés. Une autre condition préalable est une datation minutieuse. Dans notre recherche, nous avons cherché à rassembler toutes les images produites par Fortier dans la colonie du Dahomey de l’époque, soit un total de 210 primaires.11 À l’origine, ils étaient édités en quatre séries avec des numéros différents, mais toujours avec des légendes imprimées à l’encre rouge.12 Dans la série consacrée aux rituels voduns (de 1493 à 1532), Fortier publie, sans ordre chronologique, des photographies des événements survenus entre 1908 et 1909. Les deux voyages ne sont espacés que de quelques mois mais ils ont eu lieu, comme nous le verrons, dans des circonstances différentes. Pour le chercheur, soucieux de déchiffrer les détails qui conduisent à la compréhension du « texte imagétique », l’identification précise de la situation dans laquelle a eu lieu un rituel est d’une extrême importance. De plus, travailler sur des ensembles d’images concernant le même événement facilite toujours la tâche du chercheur, en lui permettant d’élaborer une vision plus panoramique que l’analyse d’images isolées. Fortier n’ayant apparemment laissé aucune note pouvant aider à reconstruire son parcours professionnel, il faut recourir à d’autres sources de l’époque pour enrichir les informations sur ses clichés. Le première voyage de Fortier dans la colonie du Dahomey eut lieu du 3 au 7 mai 1908. Les légendes de plus de 160 cartes postales éditées par le photographe indiquent : « Voyage du ministre des Colonies sur les côtes d’Afrique… » En effet, du 18 avril au 22 mai 1908, Fortier se joint à l’entourage officiel qui accompagne le ministre Raphaël Milliès-Lacroix dans son périple le long de la côte de l’Afrique de l’Ouest, s’arrêtant au Sénégal, en Côte d’Ivoire, au Dahomey et en Guinée-Conakry. Milliès-Lacroix (1850-1941) fut un homme politique actif dans la IIIe République française (1870-1940), homme de gauche et membre du Parti républicain socialiste (PRS) fondé en 1901. Il fut sénateur et, en 1906, ministre des Colonies du gouvernement Clémenceau. Milliès-Lacroix, comme lui, était anticlérical et dreyfusard.13
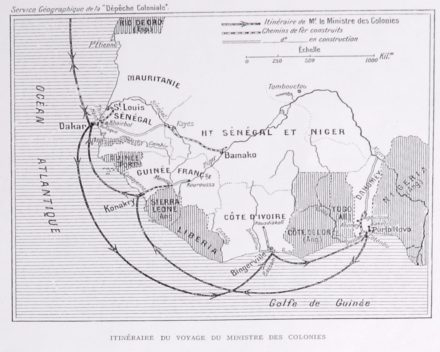
Au début du XXe siècle, la France contrôlait des colonies réparties sur l’ensemble de la planète : Nouvelle-Calédonie dans le Pacifique, Madagascar dans l’océan Indien, Guyane en Amérique du Sud, Martinique, Guadeloupe et petites Antilles dans les Caraïbes, Indochine en Asie, Algérie en Afrique du Nord. En Afrique de l’Ouest, la France administre cinq colonies : le Sénégal, le Haut-Sénégal et Niger (actuel Mali), le Guinée-Conakry, la Côte d’Ivoire et la Dahomey (actuel Bénin). L’immense territoire de l’Afrique-Occidentale Française (AOF) est rarement visité par les ministres des Colonies, qui se limitent alors au principal centre administratif, le Sénégal. Le choix de Milliès-Lacroix de découvrir les autres colonies françaises de la région est donc une nouveauté dans la routine du ministère. Pourquoi cet intérêt particulier ? Pourquoi l’Afrique, parmi tous les continents ? Ce que nous savons, c’est que le voyage a enthousiasmé le ministre au point de lui valoir de la part de Clémenceau le surnom « Le Noir ».14 Dans un entretien de presse à la veille de son départ, Milliès-Lacroix explique qu’il s’agit d’un « voyage d’études » pour évaluer par lui-même les besoins et les ressources des colonies françaises d’Afrique de l’Ouest. Il souligne qu’il refuse toute ostentation : de fait, il n’est accompagné que de son directeur de cabinet et d’un secrétaire particulier. Le financement de la tournée, du moins entre Paris et Dakar, vient du budget de représentation du ministère, afin de ne pas peser sur la métropole ni la colonie. Milliès-Lacroix va en train jusqu’à Lisbonne, puis monte sur un bateau de ligne, l’Amazone, de la Compagnie des Messageries Maritimes, en route vers Buenos Aires avec escale à Dakar.15 Nous en savons très peu sur les relations entre Fortier et l’administration coloniale française au Sénégal, car aucun document n’a encore été trouvé à ce sujet. Nous savons par contre qu’en janvier 1908, trois mois avant le voyage du ministre, Fortier s’est joint à l’entourage accompagnant le Gouverneur général de l’AOF, Martial Merlin, lors d’un voyage dans la colonie de Guinée, et en a tiré 73 cartes postales.16 Il s’agit d’une série modeste et rare, jamais rééditée. Nous ne disposons cependant pas d’informations qui expliquent quel type d’accord a été conclu entre le photographe et le gouvernement colonial. Était-ce une commission, et en ce cas, pour quelle rémunération ? Ou s’agissait-il d’un échange : voyage gratuit contre photographies ? Ou bien travaillait-il pour la presse ?
Il est possible que les relations locales de Fortier lui aient facilité l’obtention de sa place dans l’entourage du ministre Milliès-Lacroix en avril et mai 1908. Vivant à Dakar, il pouvait facilement se renseigner sur les préparatifs du voyage et postuler comme photographe. Les frais de base étant couverts, Fortier avait tout à y gagner, en accumulant de nouveaux clichés pour son entreprise d’éditeur de cartes postales d’Afrique de l’Ouest. Les images prises pendant la tournée avec le ministre ont été rééditées par Fortier jusqu’à la fin des années 1920.


L’hebdomadaire La Dépêche Coloniale Illustrée publie, le 15 août 1908, un numéro complet consacré au voyage du ministre. Malgré l’absence de mentions d’auteurs, on y reconnaît des dizaines de clichés de Fortier et d’autres photographes, tels que Pierre Tacher, résident français à Saint-Louis du Sénégal, et F. W. H. Arkhurst, un Akan (de l’ethnie nzema) qui vivait alors en Côte d’Ivoire.17 Un des clichés d’Arkhurst est un instantané intéressant qui nous permet d’identifier l’appareil utilisé par Fortier à l’époque. Tous deux ont photographié le passage du ministre à Grand-Bassam, en Côte d’Ivoire. Fortier saisit, de face, le moment exact où l’entourage du ministre traverse un portique orné de feuilles de palmier (Figure 6). Pour ce faire, il s’est probablement mis en travers du chemin de son collègue Arkhurst, qui n’a réussi à prendre le groupe que quelques secondes plus tard. Sur le cliché que nous attribuons à l’Africain, dans le coin inférieur gauche, on peut voir Fortier en action (Figure 7).18 Il porte sur sa poitrine son instrument de travail et il est coiffé d’un casque blanc ; il court et jette un regard rapide à son collègue, comme présentant ses excuses d’occuper le devant de la scène. L’appareil de Fortier semble peu maniable mais robuste, une nécessité pour travailler sous les tropiques.19

Nous ne disposons pour l’instant d’aucunes informations prouvant une relation formelle entre Fortier et l’état-major colonial au Sénégal, mais de précieux documents sur le voyage de Milliès-Lacroix en 1908 sont récemment devenus accessibles aux chercheurs. En 2009, le musée de Borda de Dax, ville natale du ministre, a organisé une exposition de quelque quatre-vingts pièces – statuettes, masques, ornements, objets du quotidien – apportées de son voyage sur les côtes africaines et offertes au musée par des membres de sa famille en 1966. À la surprise des organisateurs, les descendants de Milliès-Lacroix, informés de la préparation de l’exposition, ont décidé de remettre à l’institution une intéressante documentation complémentaire jusqu’alors inconnue : le carnet de voyage et deux albums photos.20 L’un d’eux, dans une belle reliure en cuir, composé par Fortier, regroupait 280 copies sur papier photographique. Une dédicace documente la relation personnelle du photographe avec le ministre. Le deuxième album, organisé par Milliès-Lacroix lui-même, contient des photographies de qualité variée prises par des membres de la délégation (dont, certainement, des amateurs) et 36 cartes postales de Fortier de la série Collection Générale, publiée en 1906 et rééditée en 1907. Cette importante présence de ses cartes postales dans l’album personnel du ministre est une autre indication de leurs étroites relations. Dans cet album se trouve un cliché (Figure 8) dans lequel on reconnaît à nouveau le photographe : il marche devant le cortège et porte son appareil en sautoir. Dans un autre (Figure 9) on aperçoit seulement sa silhouette derrière une fenêtre, d’où il a photographié la scène de la Figure 10. Il est remarquable que Fortier, avec un appareil aussi volumineux et sans doute difficile à manipuler, ait réalisé des cadrages aussi complexes.
Comme nous le verrons, l’initiative des descendants de Milliès-Lacroix de rendre publics ces documents a eu un impact décisif sur l’élucidation de certains clichés de Fortier. Ce sont souvent d’autres sources, comme le carnet de voyage du ministre, son album personnel ou l’album que lui a offert Fortier, qui ont permis de situer des images dont la localisation n’était pas indiquée dans les légendes des cartes postales (voir Figures 11 et 12). Dans cet exemple, l’image qui apparaît dans l’album offert par Fortier au ministre a permis, grâce au cadrage plus large, de faire le lien avec la série d’Abomey.

Les comptes-rendus écrits et visuels du voyage attestent que Milliès-Lacroix a été reçu en grande pompe dans les villes africaines qu’il a visitées. Partout, les festivités organisées par les autorités coloniales utilisent à profusion les drapeaux tricolores, les arcs de triomphe et autres emblèmes français. Ces symboles, qui ornaient les évènements de musique et de danse de la culture locale, servaient aussi de symboles du processus de domination qui sous-tendait ces spectacles. Ce fut le cas au Dahomey, où le ministre séjourna du 3 au 7 mai 1908.
À cette époque, l’islam et le christianisme étaient déjà largement répandus dans la région, mais la majorité de ses habitants étaient adeptes du vodun. Une partie des rituels de cette religion était périodiquement pratiquée sur les places publiques. Pour recevoir le ministre furent organisées des célébrations impliquant les prêtres, les initiés et les dévots du vodun. Ces cérémonies (qui, bien que réalisées sur commande, conservaient une grande partie de leur originalité rituelle) ont été captées par Fortier dans des images qui en sont l’un des plus anciens témoignages photographiques connus. Comme on le verra, Fortier a photographié des rituels voduns à Ouidah, à Pahou, à Abomey et près de Savalou. Cela n’a été possible que parce qu’il faisait partie de l’entourage officiel du ministre, ce qui lui permettait d’être très proche des gens qui dansaient. C’était une opportunité unique pour un grand photographe. Fortier était sans aucun doute un excellent professionnel, mais avait un train de vie très modeste, insuffisant pour voyager par lui-même dans des endroits lointains à la recherche de nouvelles images. Ainsi, l’initiative du ministre « Noir » de visiter les colonies françaises d’Afrique de l’Ouest, conjuguée à l’agilité du photographe, a permis de recueillir de précieux témoignages des rituels consacrés aux voduns. Dans le cas des images saisissantes produites par Fortier à Abomey, l’exploit est dû à une rencontre encore plus propice : les festivités du 5 mai 1908 ont été organisées par le commandant de cercle Auguste Le Hérissé, administrateur colonial installé dans la ville depuis 1904 et ami de l’élite locale descendante de la famille royale déchue.21 Selon le carnet de voyage du ministre, Le Hérissé tentait de restaurer les ruines des anciens palais d’Abomey, d’y fonder un musée historique et collectionnait, classait et cataloguait des objets de la culture matérielle du royaume du Dahomey.22
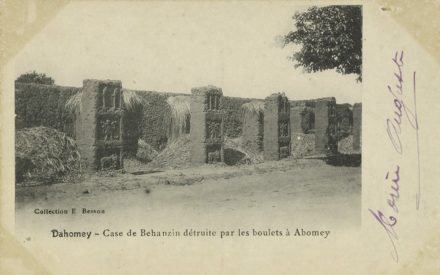
En novembre 1892, pendant les guerres de pénétration française, Béhanzin, alors roi du Dahomey, décide de quitter Abomey et de partir vers le nord avec sa famille et une partie de son armée. La résistance se poursuivra jusqu’à sa reddition en janvier 1894. Avant de quitter la capitale, il incendie son palais et ceux de ses prédécesseurs dans l’espoir d’éviter le pillage des reliques et des trésors royaux.23 Les toits des bâtiments, en paille, flambent, et les structures furent exposées aux intempéries. Sur les murs de ces bâtiments se trouvaient les célèbres bas-reliefs d’Abomey, qui illustraient artistiquement la chronique historique de la dynastie royale. Dans la Figure 13, par exemple, nous voyons trois colonnes ornées de bas-reliefs similaires. En bas est représenté un buffle, l’emblème du roi Guezo, ce qui suggère qu’il s’agit de son propre palais et non de celui de Béhanzin comme le prétend la légende de la carte. Dans la partie centrale, un guerrier dahoméen porte le corps d’un prisonnier nagot qui lui avait lancé une flèche – allusion aux guerres entre le Dahomey et Oyo.24 Avec la domination coloniale française, les membres de la famille royale restés à Abomey perdent leurs sources de revenus et ne parviennent plus à entretenir leurs vastes palais. En 1908, sans ressources pour s’occuper de tous les bâtiments dont ils étaient les responsables, ils donnent la priorité aux tombes royales.25 Les autres bâtiments étaient en ruine, et les bas-reliefs se dégradent (mais ils sont maintenant classés au patrimoine mondial de l’UNESCO). Une partie des reliques sacrées, que Béhanzin avait tenté d’empêcher de tomber entre les mains des conquérants, fut pillée, transportée en France et incorporée aux collections de divers musées. Les immenses statues zoomorphes des rois Guezo (Gezò, qui régna entre 1818 et 1858), Glele (Glɛlɛ̀), qui régna de 1858 à 1889) et Béhanzin, par exemple, furent offertes (à titre de « donations »…) par le général Dodds au Musée du Trocadéro, futur Musée de l’Homme, et sont aujourd’hui au Musée du quai Branly. Les « souvenirs » apportés en France par les membres de l’expédition qui a combattu au Dahomey sont également devenus une marchandise très appréciée sur le marché parisien des « arts tribaux ».26


L’administrateur colonial Le Hérissé a sans doute fait tout son possible pour complaire au ministre et au gouverneur général, afin de les impliquer dans le projet de restauration des palais et de création du Musée historique d’Abomey. Il est également probable que la famille de Béhanzin l’ait aidé dans sa tâche d’impressionner les autorités. De fait, les photographies prises par Fortier lors des représentations publiques à Abomey suggèrent que des membres de la famille royale déchue ont participé aux célébrations en accomplissant leurs rituels ; mais cette initiative commune ne leur valut de la part des autorités coloniales qu’un soutien moral .
En 1908, peut-être Le Hérissé écrivait-il déjà son ouvrage L’Ancien Royaume du Dahomey: Moeurs, religion, histoire, publié en 1911, une étude classique, largement basée sur des sources orales, dont les sources contredisaient les textes écrits précédemment par des. Un des principaux interlocuteurs de Le Hérissé était Agbidinoukoun, le frère du roi Béhanzin.27 On dit que l’auteur connaissait si bien le fongbé, la langue des Fon, que lorsqu’il parlait, un aveugle n’aurait pu savoir qu’il était européen. Sa maîtrise de cette langue lui permit de s’entretenir avec nombreux notables d’Abomey sans passer par des interprètes.28 Outre les images des performances à Ouidah, Pahou, Abomey et près de Savalou, Fortier prit en 1908 de curieux clichés, comme nous le verrons plus loin, dont des photographies d’Adjiki, chef de Porto-Novo, entouré de sa cour, et de Gigla, roi d’Allada.
Une partie intéressante du carnet de voyage de Milliès-Lacroix est celle qui rapporte la visite de la délégation sur le chantier du pont sur la rivière Ouemé, à 247 kilomètres de la côte. Il s’agissait d’un projet stratégique d’ingénierie destiné à assurer la traversée par le chemin de fer du principal fleuve de la région et faciliter son extension vers la ville de Savè en vue de la pénétration française à l’intérieur de la colonie. À leur arrivée, le ministre et le gouverneur général constatèrent que les éléments métalliques du pont préfabriqué étaient au sol et qu’il n’y avait aucun signe de préparation du montage. C’était le 6 mai 1908.
En mars 1909, le gouverneur général William Merlaud-Ponty revient au Dahomey pour inaugurer le pont enfin terminé.29 Fortier l’accompagne et a l’occasion de photographier à nouveau Porto-Novo, Sakété et Abomey. Ce voyage de 1909 fait l’objet de la belle série d’images du marché de Porto-Novo, de celles des embarcations du lac Nokoué et des chefs Adjiki et Odekoulé, en plus de la série montrant les danses voduns à proximité du palais de Béhanzin. Adjiki, grand chef de Porto-Novo, fils et successeur de Toffa 30, avait déjà été photographié par Fortier en 1908. En 1909, il l’a été encore, cette fois- ci dans son carrosse, entouré des hauts dignitaires de sa cour. Odekoulé, roi de Sakété, comme nous le verrons, fut contraint par le gouverneur général de rendre hommage aux français morts lors d’une révolte en 1905. La cérémonie fut captée par Fortier.
Un rapport administratif portant sur le mois de mars 1909, rédigé à Abomey, nous informe du passage de l’entourage du gouverneur général dans la ville.31 La visite fut brève : accompagné de dix-sept personnes, William Merlaud-Ponty arriva à Abomey le 21 mars au soir et en repartit le lendemain. Il y reçut en audience les fonctionnaires locaux et Alpha-Yaya, ancien roi de Labé, en Guinée, exilé par les Français.32 Il visita ensuite la clinique de jour en construction et l’école. Dans l’espace public appelé Simbodji(síngbójí) : maison à deux étages), situé en face du grand palais d’Abomey, où Béhanzin avait vécu pendant son règne, Merlaud-Ponty fut honoré par des performances d’adeptes de la religion des voduns. Dans ce même rapport, on retrouve, une fois de plus, des références au projet de construction d’un musée historique à Abomey.
Lors de ses deux séjours au Dahomey, Fortier est à la fois reporter pour les périples des autorités coloniales (accompagnant le ministre Milliès-Lacroix et le gouverneur général William Merlaud-Ponty) et documentariste impromptu (comme dans la série sur les danses voduns et le marché Porto-Novo). Son regard multiple et complémentaire apparaît clairement quand on considère l’ensemble des photographies – plus de deux cents – publiés sous forme de cartes postales qui dépeignent le Dahomey en 1908 et en 1909.
Colonialisme Français et résistance africaine
Comme déjà mentionné, l’expansion coloniale européenne en Afrique de l’Ouest s’est accélérée dans la seconde moitié du XIXe siècle. Depuis 1840, la compagnie des frères marseillais Régis occupe le fort français d’Ouidah, transformé en bureau commercial. Bien que soupçonnées d’avoir trempé dans la traite des esclaves, des sociétés telles que celle des Régis et celle de Cyprien Fabre investissent de plus en plus dans l’huile et les noix du palmier à huile, produits du « commerce licite », dont la culture et la transformation étaient jusque-là contrôlées par les Africains. L’huile présentait un intérêt croissant pour le commerce européen. Les machines de la seconde révolution industrielle ont besoin de lubrifiants, les ouvriers se sont habitués à consommer de la margarine, et ces produits sont fabriqués avec des dérivés de ce palmier, dont l’huile est aussi à la base de la fabrication du savon de Marseille.33 Pour optimiser l’exportation de cette matière première, il est nécessaire d’assurer la sécurité des ports d’embarquement, et plusieurs traités franco-dahoméens sont rédigés de façon à obtenir des avantages commerciaux sur la côte.

Outre les motivations économiques, il y en avait d’autres, de nature politique, qui ont également stimulé la conquête du territoire. La défaite contre l’Allemagne (la Prusse) en 1870 avait laissé les Français désireux de faire sentir leur présence dans d’autres régions. Dans le cas particulier de ce qui est devenu la colonie du Dahomey, les anciens comptoirs et protectorats français sur la côte étaient coincés entre le Togo allemand et la colonie britannique de Lagos. Soucieuse de tenir son rang parmi les grandes puissances, la France voulait relier le débouché maritime et ses vastes possessions plus au nord où passait le fleuve Niger. La pénétration française à l’intérieur du territoire de l’actuel Bénin se fit à partir de Cotonou et Porto-Novo en 1892.
Les nouvelles technologies (pas uniquement militaires) garantissaient la suprématie européenne. L’ingénierie de l’acier, par exemple, a permis la construction du quai de Cotonou qui assurerait le débarquement des troupes du chef de la conquête française, le colonel Dodds, nommé général après la prise d’Abomey. Il y avait une barrière naturelle qui laissait les Européens à la merci des Africains : d’énormes vagues balayaient l’entrée de la barre infestée de requins, rendant les embarquements et débarquements très lents, dangereux et coûteux. Celle ci n’était traversée que par d’excellents rameurs.34 Comme Béhanzin l’avait prédit, la construction du quai de Cotonou indiquait que la conquête coloniale était proche. Après une résistance acharnée et trois années de guerre, le royaume du Dahomey s’effondre définitivement avec la reddition de Béhanzin en janvier 1894.
La domination coloniale établie et maintenue par la force militaire a entraîné une transformation drastique du Dahomey et des sociétés dans sa sphère d’influence, une population qui, au tournant du XXe siècle, se chiffrait à environ 500 000 personnes.35 La mise en œuvre de la « structure coloniale » a entraîné une occupation territoriale et des changements systémiques sans précédent dans les domaines politique, économique et culturel. L’une des premières mesures dans le domaine politique, comme nous l’avons vu, fut la destitution du roi Béhanzin (Figure 2) et sa déportation en Martinique, avec quatre de ses épouses, trois filles et un fils. Il recevait une pension mais celle-ci fut progressivement réduite par le gouvernement français de manière humiliante. Empêché de retourner au Dahomey, Béhanzin fut finalement transféré en Algérie en 1906, où il mourut et fut enterré. Malgré les demandes des proches, ce n’est qu’en 1928 que le gouvernement français autorisa le retour de ses restes au Dahomey.
Après la reddition de Béhanzin en janvier 1894, les Français firent couronner roi le prince Gucini, solennellement, sous le nom de Agoli-Agbo (Agoliágbò). Son arrivée au pouvoir résulte, selon certains, d’une trahison et, selon d’autres, d’un accord préalable avec son frère Béhanzin.36 Quoi qu’il en soit, malgré l’apparente tentative française de préserver l’institution monarchique, le général Dodds, principal architecte de la politique coloniale, prit l’initiative de diviser en deux le royaume du Dahomey : dans la partie sud, l’ancien royaume d’Allada (conquis par le Dahomey en 1724) fut rétabli et devint un protectorat de la France. L’intention explicite du général Dodds était d’affaiblir politiquement ce qui restait du Dahomey, où Agoli-Agbo était devenu roi sous les auspices de la France. Dans ce contexte, la stratégie de gouvernabilité française consistait à maintenir ou rétablir les monarchies indigènes afin de contrôler à travers elles les populations locales. C’est ce qui s’est produit, comme on le verra, dans les villes d’Allada, Sakété et Porto-Novo. Il s’agit en quelque sorte d’une forme « indirecte » de gouvernement colonial, généralement associée aux colonies anglaises, avec laquelle la France a flirté. Peu à peu, cependant, le système s’avéra inadéquat pour la région et plusieurs mouvements de résistance émergèrent.
Le manque de ressources du nouveau roi Agoli-Agbo et la concurrence des chefs locaux, nommés par les Français, font obstacle à son ambition de reconquérir le pouvoir des anciens souverains du Dahomey.37 Il se met alors à conspirer contre les colonisateurs, exigeant la complicité de ses sujets, « faisant réunir les gens de nombreux villages pour leur donner un fétiche et leur faire jurer qu’ils n’iraient jamais rien raconter aux blancs ».38 Un jour, il aurait envoyé à Savalou un « marabout nago » appelé Boko (peut-être un Bokono (bokɔ́nɔ̀), c’est-à-dire un devin), pour préparer des « gris-gris destinés à faire mourir tous les blancs d’Abomey ».39 Agoli-Agbo finit déposé et exilé au Gabon en 1900. La monarchie fut alors définitivement supprimée et l’aristocratie du dahoméenne, les clans ahovi (axɔ̀ví), avec le palais royal vide et l’émergence des lignées plébéiennes (anato), voit son prestige social érodé.
À terme, les Français remplacèrent le gouvernement colonial « indirect » par des formes de gouvernement « direct », avec la création de nouvelles unités politico-territoriales (« cercles », « subdivisions », « cantons ») et une structure administrative très hiérarchisée occupée presque exclusivement par des fonctionnaires blancs. Au sommet se trouvait le gouverneur de la colonie et, au-dessous de lui, les commandants des cercles, qui à leur tour supervisaient les administrateurs des subdivisions. Celles-ci comprenaient de plusieurs cantons ou communes, dont plusieurs villages. Les administrateurs nommaient des « chefs de canton » et des « chefs de village » parmi la population indigène. Ces chefs locaux, dépourvus d’autorité, étaient contraints au rôle malaise de médiateurs entre des intérêts souvent contradictoires. Ils étaient, par exemple, chargés de collecter les impôts et de recruter des hommes pour l’armée et les travaux publics (comprendre : travaux forcés ).
Mais la transformation économique imposée par la colonisation est allée au-delà de ces phénomènes déjà assez dramatiques. Les activités agricoles de subsistance et le système mercantile traditionnel, qui reliaient les marchés locaux aux routes commerciales interrégionales à longue distance, étaient progressivement soumis à la pression d’une économie monétarisée orientée vers l’exportation et d’un mode de production capitaliste. Ce passage à une logique de marché s’effectua graduellement et, selon Patrick Manning, ne s’acheva que dans les années 1930.40 De plus, les innovations technologiques telles que le quai de Cotonou, le chemin de fer et le télégraphe accélérèrent l’ouverture de la colonie vers l’extérieur et la mondialisation.
Jusqu’à la Première Guerre mondiale, les Allemands et les Français de Marseille se distinguent parmi les commerçants européens établis dans la région. La commerce, après la fin de la traite des êtres humains, portait surtout sur l’échange de noix et d’huile de palme contre des distillats, principalement l’anisé (anizado). Les mêmes barriques parties en Europe remplies d’huile de palme en revenaient pleines de boissons alcooliques.41 Comme à l’époque de la traite, on importait aussi, notamment, des tissus, des armes et de la poudre à canon, mais l’alcool avait une place importante. La plupart des tissus importés provenaient de Manchester, qui savait produire des tissus imprimés de qualité inférieure mais à bas prix. Les commerçants de Hambourg dominaient, eux, le marché des distillats.42
Lorsqu’ils conquirent le Dahomey, les Français effectuèrent des relevés topographiques visant à permettre la construction du chemin de fer vers l’intérieur. Traditionnellement, en fonction des facteurs géographiques le long de l’itinéraire choisi, le transport des marchandises entre l’intérieur des terres et la côte se faisait soit en pirogue sur les rivières et les lagunes, soit par des porteurs , soit par des « rouleurs de ponchons », conducteurs expérimentés des barriques d’huile ou de distillats. Les commerçants européens étaient totalement dépendants des travailleurs africains, car les animaux de monte ou de somme, tels que les chevaux et les ânes, ne résistaient guère au climat. Le recrutement de porteurs s’avérant difficile, beaucoup furent enrôlés de force, une tâche qui, comme nous l’avons dit, incombait aux dirigeants africains soumis aux Français. L’élite – les chefs locaux et l’ensemble des Européens – se déplaçait dans des hamacs suspendus à une barre en bois dont les extrémités étaient en équilibre sur la tête de deux Africains, avançant en file indienne.43
La construction du chemin de fer semblait être la solution à tous les besoins des Européens au Dahomey. L’entreprise, d’abord privée, puis reprise par l’administration française, devient rapidement l’un des scandales des concessions coloniales et de la spéculation financière à la Bourse de Paris au début du XXe siècle. Le ministre des Colonies a confié la construction et l’exploitation du chemin de fer à une société basée à Marseille et représentée par un certain Borelli, qui recevrait, en plus des subventions, quelque 100 000 hectares de terres sur les rives du chemin de fer entre Cotonou et Abomey, c’est-à-dire dans des zones fertiles et peuplées déjà exploitées par les agriculteurs dahoméens. Les terres, non clôturées, furent considérées par certains Européens comme sans propriétaire, alors que les Dahoméens savaient très bien à qui appartenait chacun des palmiers productifs.44 Les travaux de pose des rails commencèrent en 1900. Fin 1902, des commerçants africains, agudas et européens s’allièrent à 9 000 fermiers dahoméens pour exiger que le gouvernement de la colonie empêche la cession des terres à la Compagnie de chemin de fer du Dahomey, avec succès : En fait, il n’y eut pas d’expropriation, et le gouvernement colonial finit par prendre en charge la compagnie ferroviaire. Or les travaux avaient été entièrement financés par des fonds publics provenant des impôts perçus au Dahomey même.45 La main d’œuvre ne comportait pas que des hommes, mais aussi des femmes et des enfants. Les hommes devaient rester sur les chantiers qui employaient chacun plus d’un millier de travailleurs. Pour qu’il n’y ait pas de baisse de leur effectif, on fit appel à des femmes pour leur porter du sable. Dans les campements masculins, les femmes locales s’occupaient aussi de l’alimentation. Quant aux enfants, ils étaient chargés de transporter de l’eau pour les ouvriers.46 La capacité du génie civil français à surmonter les obstacles naturels impressionna les Africains : des lacs, souvent sacrés pour la population locale, au « Lama », l’immense dépression marécageuse qui s’étend d’Allada à Abomey, tous les types de terrains furent terrassés pour y installer les voies ferrées.
En 1905, les 143 kilomètres entre Cotonou et le village de Dan, au nord d’Abomey, avaient déjà été construits. En 1907, comme on l’a dit, les voies allaient jusqu’à la rivière Ouemé, à 247 kilomètres de la côte. La destination finale de cette partie du projet, la ville de Savè, située au kilomètre 261, ne sera atteinte qu’en 1911. Une deuxième ligne fut construite entre 1904 et 1908, reliant Porto-Novo et Saketé, pour atteindre Pobé, plus au nord, en 1913 (voir la carte ci dessous). L’axe ferroviaire reliant Cotonou et Savè eut un impact majeur sur le système commercial interrégional préexistant, favorisant la création de nouveaux marchés locaux dans des gares, telles que Bohicon ou Aguagon, mais évinçant aussi d’autres marchés plus éloignés. Les deux principales routes commerciales reliant l’arrière-pays du nord à la côte furent également affectées. Par exemple, dans la première, qui reliait Grand Popo et Djogou, à la frontière ouest de la colonie, le commerce du sel déclina nettement après l’arrivée dans la région d’Abomey du chemin de fer, qui offrait un itinéraire alternatif. Le commerce sur la route de l’Est, qui allait de Parakou à Badagri et Lagos dans la colonie anglaise voisine, se réorienta progressivement vers Cotonou. Par conséquent, les éleveurs de bovins, qui avant ne bénéficiaient pas du chemin de fer, transférèrent aussi la transhumance à Porto-Novo et à Cotonou, car le transport en train, même cher, pouvait réduire le coût du transport du maïs, favoriser les exportations et stimuler la production. Cependant, le chemin de fer n’affecta pas le prix et ne fit pas augmenter la quantité d’huile ou de noix de palme acheminée jusqu’à la côte. Patrick Manning écrit que ces produits demeurant les principaux produits d’exportation du Dahomey, le chemin de fer fut « condamné à un échec relatif », bien qu’il ait été un élément clé de l’absorption progressive du commerce traditionnel dans le mode de production capitaliste.47
À ces transformations politiques et économiques, il faut ajouter les changements culturels, qui eurent à terme un impact plus durable et plus néfaste pour la population locale. Bien que l’alphabétisation fusse limitée à une minorité d’Africains, les Africains « évolués », l’apprentissage de la langue française et de l’histoire de France, la discipline du corps par les habitudes européennes, façonnèrent l’éducation des futures élites. L’enseignement occidental fut complété par la conversion au christianisme, étant donné que la plupart des écoles étaient sous le contrôle des prêtres des missions catholiques. Cette colonisation des esprits et des corps fut encore renforcée par l’utilisation, dans l’espace public, de toute une série de symboles, de drapeaux et d’hymnes, ainsi que par des cérémonies commémoratives (dont la fête nationale, célébrée dans toutes les subdivisions de la colonie le 14 juillet), qui finirent par imprégner l’imaginaire des populations locales de références culturelles françaises. La situation coloniale est donc un processus historique de changement radical que les photographies de Fortier parviennent à restituer de façon exemplaire.
Toutefois, ce processus de domination ne se produisit pas sans résistances. Les Dahoméens n’ont pas toujours accepté passivement l’imposition d’une autorité étrangère. Nous avons déjà mentionné les attitudes subversives, faisant appel aux ressources spirituelles, du roi Agoli-Agbo. Sous la surveillance soupçonneuse des autorités françaises, les rituels périodiques en l’honneur des ancêtres royaux – le culte des Nesuhue (Nɛ̀súxwé) – continuent aussi à être célébrés. Cet espace de dévotion vodun, dont le code et la langue échappent aux colonisateurs, permet l’activation de la mémoire locale et de formes symboliques de contestation de la domination politique. Ainsi, le champ religieux, qui pouvait apparaître aux Européens comme une forme d’aliénation ou de folklore, était pour les Dahoméens un espace d’affirmation nationale.
Outre cette résistance de « basse intensité », il existait ailleurs des attitudes plus conflictuelles. À l’Ouest, à la frontière avec la colonie allemande du Togo, sur le territoire des Adjas (Ajă) et des Houés, où se trouvait l’ancien royaume du Tado (Tádò), de violents affrontements se produisirent, et le roi Pohizon (Kpoyizu), à l’instar d’Agoli-Agbo, fut exilé au Gabon en 1900.48 Au nord de Porto-Novo, dans la région des Holis ou Holi-idjes, il y eut une forte résistance à la pénétration française, qui se maintint de 1905 à 1910 puis fut écrasée en 1911.49 Cela montre que si l’administration coloniale avait tendance à mettre l’accent sur la tranquillité de la colonie, le succès croissant de la collecte des impôts et le recrutement forcé de jeunes pour travailler sur le chemin de fer, les processus de contestation étaient constants. En effet, en mai 1908, coïncidant avec la visite du ministre des Colonies, marquée par un esprit général de festivités publiques, les chefs d’une révolte qui avait éclaté l’année précédente contre un décret instituant de nouveaux impôts avaient été libérés de prison.50 À ce moment, Abomey vivait dans le calme politique, et l’administrateur écrivait : « Les ‘Fons’ [sont] souples, disciplinés, travailleurs ; les ‘princes’, généralement paresseux et intrigants. Les chefs continuent a être des auxiliaires précieux du Résident [Le Hérissé], et les récompenses que leur a données M. le ministre des Colonies ont stimulé leur zèle, en même temps qu’elles ont satisfait leur amour-propre».51
IIe PARTIE
L’IMAGE AU PREMIER PLAN: DOCUMENTS VISUELS COMMENTÉS
Cotonou
À l’origine village de pêcheurs, le port maritime de Cotonou (Kútɔ́nú), au sud du lac Nokoué, fut créé par Guezo, roi du Dahomey, vers 1840, après le début de la répression britannique de la traite négrière. La tradition veut que ce soit le trafiquant brésilien Francisco Félix de Souza qui ait proposé à Guezo le lieu de construction du port, moins visé qu’Ouidah, jusqu’alors lieu de départ des navires qui traversaient l’Atlantique. Malgré ses débuts comme lieu de contrebande, Cotonou allait devenir le plus grand port de la région, grâce à l’émergence du « commerce licite » déjà mentionné: celui de l’huile et des noix de palme, qui remplaça la traite des êtres humains. Les zones les plus productives, au nord de Porto-Novo et autour du lac Nokoué, étaient reliées au port par des pirogues. Seule une petite bande de sable séparait le lac de la mer. Jusqu’à l’installation des Français dans la région à la fin du XIXe siècle, les transactions commerciales à Cotonou étaient contrôlées par des familles d’agudas.52 Dans le contexte des conflits avec les Allemands et les Britanniques pour le contrôle des zones d’influence en Afrique de l’Ouest, et après l’annexion de Lagos par ces derniers en 1861, la France décide de concentrer ses efforts sur l’occupation de Cotonou. Dans les années 1860, sous le règne de Glele, trois délégations françaises négocient avec les autorités du Dahomey le « cession » de Cotonou contre le paiement d’annuités. En fait, les Européens et les Africains on interprété cet accord différemment : du point de vue de Glele, il ne s’agissait que de l’autorisation de construire un poste de commerce. En 1883, la France déclara qu’elle donnerait à Porto-Novo le statut de protectorat, et deux ans plus tard, elle occupa Cotonou. En 1890, après des désaccords sur la prérogative de perception d’impôts sur les marchandises qui circulaient sur le port, eut lieu le premier conflit armé entre le royaume du Dahomey (qui tenta d’envahir Cotonou) et la France. Au même moment, Béhanzin prend le contrôle du royaume, succédant à Glele, son père, décédé en 1889. Ne parvenant pas à expulser les Français de Cotonou, Béhanzin dut négocier. Là aussi il y eut une divergence d’interprétation sur les termes du nouvel accord, qui prévoyait toujours un paiement annuel au Dahomey. Le royaume considérait ces règlements comme un tribut qui ne remettait pas en cause sa souveraineté, tandis que les Français les percevaient comme une compensation à la reddition. Il faut rappeler que les Français étaient déjà installés, par le biais d’un accord de protectorat, dans le royaume voisin de Porto-Novo, rival historique du Dahomey. Le différend autour du contrôle de Cotonou offrit aux Français une stratégie pour légitimer leur projet d’expansion visant aussi à neutraliser l’influence britannique dans la région.53 Le Traité de Cotonou de 1890 ne signifiait donc qu’une trêve avant la confrontation finale, qui commencerait deux ans plus tard. Pendant ce temps, Béhanzin se mit à acheter d’armes et de munitions aux Allemands établis au Togo, qui les lui livraient à Ouidah. Les Français, pour leur part, qui construisirent le quai de Cotonou et étudièrent le terrain, décidèrent que l’invasion du royaume du Dahomey se ferait par pénétration fluviale, en remontant l’Ouemé depuis Porto-Novo.54 Selon Robin Law, l’intérêt de la France pour Cotonou venait de ce fait que, dès le milieu du XIXe siècle, ce port était plus attractif pour les maisons de commerce européennes que celui d’Ouidah, à l’ouest. D’autre part, la présence de l’administration française dans la ville était très attirante pour l’implantation de nouvelles entreprises.55 La construction du quai, qui a commencé à fonctionner en 1893, ne fit qu’accélérer un processus en cours depuis longtemps. En 1900, le chemin de fer entre Cotonou et le Nord est inauguré, rendant irréversible la concentration économique dans la ville.
Les photographies prises par Fortier à Cotonou le 3 mai 1908 documentent l’espace urbain en formation. Deux cartes postales illustrent l’arrivée du ministre des Colonies Milliès-Lacroix et le système de débarquement et d’embarquement : une grue hissait les passagers sur le quai. Comme nous l’avons vu, la barre, secouée de fortes vagues et infestée de requins, rendait risqué le passage des navires vers la plage. Le quai, long de trois cents mètres, dépassait l’entrée de la barre et accueillait les passagers et le fret à son extrémité, équipée de la grue et des nacelles. La Figure 20 montre, au premier plan, un bateau avec neuf laptots (marins africains) en uniforme et quatre officiers, amarré à une flotteur près du quai. Les pales des rames sont découpés. Les ondulations de la mer sur la gauche indiquent que le quai se terminait là où les vagues commençaient à se former. Au fond de l’image, un autre bateau à moteur se dirige vers le navire ancré au large. C’est le Chasseloup-Laubat, un croiseur de la marine française stationné à Dakar, qui emmena le ministre le long des côtes africaines. La perspective indique que Fortier photographiait déjà sur le quai. C’est aussi de là qu’il capte la scène de la Figure 21, où le ministre et trois autres Européens sont hissés dans une nacelle. Milliès-Lacroix arrive à Cotonou accompagné du gouverneur général de l’Afrique de l’Ouest, William Merlaud-Ponty. Accompagne le groupe le gouverneur de la colonie du Dahomey de l’époque, Edmond Gaudart, qui vient les accueillir et guider.
Le quai est orné de feuilles de palmier pavoisés de drapeaux tricolores pour recevoir le ministre (Figure 22). Au lieu d’utiliser la voie ferrée de type Decauville, de gabarit étroit, servant à déplacer les marchandises le long des trois cents mètres de quai, Milliès-Lacroix se fait porter.
Sur la Figure 23, l’entourage apparaît couché dans des hamacs recouverts de rideaux en tissu ornés et portés sur la tête d’Africains. Ce moyen de locomotion, qui exprime si clairement la relation hiérarchique entre les colonisateurs et les autochtones, a été utilisé à plusieurs reprises lors du voyage du ministre au Dahomey. Les porteurs de hamac, appelés hamacaires par les Français, sont en uniforme ; chaque paire utilise le même modèle de tissu noué à la taille. Ils portent un brassard d’identification. Le porteur le plus à gauche sur l’image a sur la tête un accessoire destiné à répartir le poids. Tous sont pieds nus. Le dernier homme à gauche est un tirailleur sénégalais, membre de l’armée coloniale, muni de sandales. Des tirailleurs vont accompagner l’entourage tout au long du voyage, tandis que les troupes de chaque colonie se relaieront selon les lieux visités. Le ministre n’a amené que deux conseillers, mais la délégation comporte aussi des représentants des autorités locales.

Comme nous l’avons dit, Cotonou était le point de départ du chemin de fer vers le nord de la colonie. De Pahou, une branche menait, à l’ouest, à Ouidah. Ainsi, les plus longs trajets effectués par l’entourage du ministre utilisèrent le train. Sur la Figure 26, on voit la gare dallée et dotée d’un balcon probablement réservé aux Européens. Trois lampadaires à gaz éclairent le quai. Fortier a photographié depuis l’intérieur d’un wagon du train. Nous voyons beaucoup d’Africains au premier plan, et leurs vêtements nous informent sur la société de Cotonou à l’époque. La plupart des personnes présentes sont des hommes. Les vêtements et les chapeaux de différents types sont fabriqués localement ou sont d’origine européenne. Certains des personnages portent des chaussures, d’autres non. À gauche, un homme en smoking et portant un haut-de-forme tient une canne. En 1908, le chemin de fer avait déjà atteint Aguagon, dans le pays Mahi (Maxí), à plus de deux cents kilomètres de la côte. Une autre section allait de Porto-Novo à Sakété (voir Figure 27).

Pahou
À Pahou, à l’ouest de Cotonou, la voie ferrée principale se dirigeait vers le nord, tandis qu’une branche menait à Ouidah, quinze kilomètres plus loin. Robin Law dit que Pahou a été fondée à partir d’Ouidah au moment de la transition entre la traite négrière et la production de dérivés du palmier à huile, cette zone étant propice à sa culture intensive. Le journal du ministre, qui ne mentionne pas l’arrêt à Pahou, rapporte que le jour même de son arrivée à Cotonou, la délégation est repartie en train dans l’après-midi pour Ouidah : il dit qu’il a traversé « une région très intéressante: palmeraies et marais étangs et terres cultivées ; maïs. ».56 En rassemblant les informations des légendes des cartes postales de Fortier et des séries de clichés de l’album qu’il a offert au ministre, nous pouvons identifier quatre images de groupes de personnes qui ont probablement été prises à Pahou.


Sur la Figure 30, on voit un couple debout. Les deux personnes portent des vêtements noués à la taille à la mode locale. Sur le plancher se trouve un tabouret circulaire à trois pieds sculpté dans une unique pièce de bois (kataklε). Ce type de siège servait autrefois de trône lors du couronnement du roi du Dahomey, devenant ainsi un insigne du pouvoir.57 Un groupe de personnes est assis : elles semblent attendre le moment de se présenter. Sur la droite, nous voyons un tambour, appelé kpezìn, dont la caisse de résonance est une jarre en céramique, avec un col allongé et une base sphérique, recouverte de vannerie de paille ou d’osier. Ce type de tambour accompagne l’orchestre dans les cérémonies funéraires (zεnlì), mais aussi dans la musique récréative et dans d’autres célébrations.58

La Figure 31 montre un groupe de danseurs masculins. Leurs tibias sont recouverts de fibres de raphia, un dispositif utilisé dans les spectacles pour valoriser les mouvements du corps et camoufler les clochettes qui tintent pendant la danse. Sur la gauche, au sol, on voit trois tambours. Le plus petit semble être de type kpezìn, et le plus grand, selon les informations recueillies à Abomey, serait de type lenhun (lɛ̀nhun).59 Certains des danseurs utilisent une sorte d’éventail circulaire.

Sur la Figure 32, nous voyons une présentation de ce qui pourrait être un Zangbetó (Zàngbètɔ́), littéralement le « chasseur de nuit », parfois aussi appelé « gardien de la nuit ». Les voduns Zangbetó constituent autour d’eux des sociétés secrètes masculines qui interviennent dans les quartiers et les villages comme une force de police, surveillant les routes et protégeant la communauté des voleurs ou des ennemis. Les adeptes croient que ses vêtements, faits de fibres de raphia, sont animés par une force surnaturelle invisible. Il peut aussi s’agir d’une manifestation du vodun Sò Bragada, associé au tonnerre, auquel cas le masque, fait de bois et de cornes, serait celui d’un bélier, son emblème. Derrière on voit le drapeau français ; les trois hommes à gauche, en uniforme mais pieds nus, pourraient faire partie de l’entourage colonial, peut-être en tant que rameurs. On notera dans la légende de la carte le mot « féticheur », peut-être utilisé par Fortier pour décrire le personnage masqué, mais qui, à proprement parler, désignerait plutôt l’individu à droite de l’image, chargé de prendre soin du vodun, le vodunon (vodúnnɔ́), littéralement le « propriétaire », « maître » ou « gardien » du vodun. Le terme « fétiche », dérivé du terme portugais « feitiço », a commencé à être utilisé par les nord Européens sur la Costa da Mina au XVIIe siècle pour désigner des objets de culte et des dieux africains. De « fétiche » vient au XVIIIe siècle le terme « fétichisme » , représentant pour les philosophes des Lumières la première et la plus simple étape de l’évolution religieuse humaine. Selon eux, le fétichisme consistait à attribuer une valeur sociale et une personnalité à des objets matériels arbitraires et, à ce titre, était associé aux notions de superstition, d’irrationalité, d’exploitation et de charlatanisme. Au XIXe siècle, l’anthropologie évolutionniste et le colonialisme européen ont entretenu ces stéréotypes simplistes dans l’imaginaire occidental, représentant ainsi, d’une manière déformée et biaisée, la religiosité africaine et généralement l’idée d’Afrique. Fortier, malgré ses années de coexistence avec les sociétés locales, n’a pas échappé aux conventions européocentriques des colonisateurs.
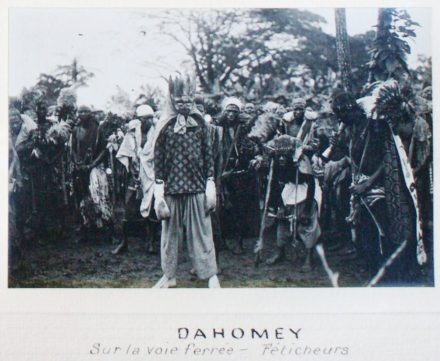

Sur la Figure 33, nous voyons, au premier plan, un autre personnage masqué. Comme les manifestations des egunguns, les ancêtres yorubas, il cache ses mains et ses pieds, et on le croit animé par un vodun ou une force invisible. Le masque est entouré d’un groupe d’adeptes des « voduns des arbres » ou atinmévodun (atinmɛ́vodún), littéralement « vodun dans l’arbre »). La religion vodun est célèbre pour sa vénération des arbres, conçus comme des entités spirituelles auxquelles sont attribués divers pouvoirs, protecteurs et thérapeutes, entre autres. Lors les processions publiques, les prêtres de l’arbre vodun portent sur leur dos l’atchiná (aciná), un tronc de bois orné de plumes et de bandes de tissu coloré, comme on peut le voir au premier plan, dans le coin droit de l’image. Ces objets sont considérés comme les « sièges » ou résidences du vodun. Les entités appartenant à cette catégorie, telles que Lŏkò, Agasú, Bosíkpɔ́n, Măsɛ̀ etc., reçoivent aussi le nom générique de hunvé (hunvε : dieu rouge). De nos jours, la danse conjointe de personnages masquées avec les « dieux des arbres » n’est pas habituelle.
Ouidah
Ouidah ou Glehué (Glexwé), littéralement la « maison du champ », était à l’origine la résidence rurale des habitants de Savi (Saxé), la capitale du royaume Hueda. Elle a probablement été fondée par les indigènes hula (xwlá), pêcheurs dans les régions lacustres parallèles à la côte, qui auraient été rejoints par des Huedas de l’Est. Les premiers Européens qui y débarquèrent, vers 1580, furent des Portugais. Les Huedas étaient à l’époque sous le règne d’Allada. Cependant, vers 1670, sous l’impulsion du lucrative commerce maritime, en particulier de la traite négrière, le royaume de Huedá se libéra par la force du joug de l’Allada. Le village d’Ouidah devint ensuite un des principaux comptoirs du commerce transatlantique.
À l’initiative des Français et des Anglais, qui y avaient construit des entrepôts dans le cadre de leurs activités commerciales, les Portugais élevèrent, en 1721, le fort de São João Baptista de Ajudá, dont le siège administratif était au Brésil, dans la ville de Salvador de Bahia. La prospérité du royaume Hueda éveilla l’avidité du puissant royaume intérieur émergent du Dahomey, qui, en 1727, conquit Savi, puis Ouidah. Ouidah devint le principal port du royaume du Dahomey pour l’exportation des esclaves africains.
Entre 1670 et 1860, environ 1 million de personnes partirent d’Ouidah pour les Amériques, la plupart au Brésil, notamment à Bahia.60 La ville était le principal centre logistique des transactions entre les royaumes européens et africains fournisseurs d’esclaves. En plus de servir d’intermédiaire pour l’achat et la vente de personnes, Ouidah fournit du bois de chauffage, des animaux de ferme et de l’eau pour la longue traversée. Comme l’explique Robin Law, ces peuples côtiers ont joué le rôle de « communautés d’intermédiation », favorisant « la transmission des influences culturelles et, à terme, l’adaptation des sociétés africaines au domaine politique et économique européen (…). Ouidah est devenue nettement plus importante sous le contrôle dahoméen, non seulement en tant que centre de commerce, mais aussi parce qu’elle est devenue le siège de l’administration provinciale.61 En effet, au début du XIXe siècle, Ouidah était la base de la dynamique communauté mercantile constituée entre autres de commerçants portugais et brésiliens. Parmi ces derniers se trouvait le Bahianais Francisco Félix de Souza, qui, de greffier de la forteresse portugaise de São João Baptista de Ajudá, devint, des années 1820 à sa mort en 1849, le plus important négrier de la Costa da Mina. Il reçut du roi du Dahomey Guezo le titre de Chachá, et la reine du Portugal le fi membre de l’Ordre des Chevaliers du Christ.62 Cette communauté, fortement impliquée dans la traite négrière, accueillit en retour les affranchis africains en provenance du Brésil qui, avec leurs descendants créoles, échappèrent à la répression anti-africaine après la Révolte des Malês qui éclata à Bahia en 1835. Le groupe social résultant, les Agudas, avait le portugais pour langue véhiculaire et, en majorité, fit du catholicisme un signe de distinction et d’exclusion, puisque la population autochtone n’avait pas le droit d’être baptisée. L’interruption de la traite des esclaves au Brésil vers 1850 et à Cuba dans les années 1860, ainsi que la croissance de la ville portuaire voisine de Cotonou, entraînèrent un relatif déclin à Ouidah.
Néanmoins, en 1908, au moment de la visite du ministre des Colonies, la communauté aguda était encore très organisée. Le carnet de voyage du ministre nous informe que Milliès-Lacroix a reçu un cadeau de M. Medeiros, « représentant d’une catégorie spéciale de métis originaires du Brésil, des commerçants très intelligents, éduqués et parlant admirablement le français ». Les métis portugais et brésiliens qui constituèrent les Agudas en épousant des femmes autochtones ont laissé des descendants à la peau claire, un trait racial distinctif que beaucoup d’entre eux tiennent encore à souligner. Cependant, les Africains libérés rentrés de Bahia, en raison de leurs coutumes et habitudes occidentales, étaient appelés des « Blancs » (yovó). Ce fait et la tendance des Agudas à l’endogamie peut peuvent expliquer la caractérisation des descendants des rapatriés comme « métis ». La visite de l’entourage du ministre à Ouidah fut brève. Comme nous l’avons dit, le groupe se dirigea vers la ville le jour même de son débarquement à Cotonou et, après s’être arrêté à Pahou, arriva dans l’après-midi, et en repartit vers 19h30. Après l’accueil des marchands locaux et les « nombreux tam-tams de la population enthousiaste », le groupe eut aussi le temps de visiter la nouvelle église catholique en construction, ainsi que le célèbre temple du serpent vodun Dangbé, situé devant la mission.63

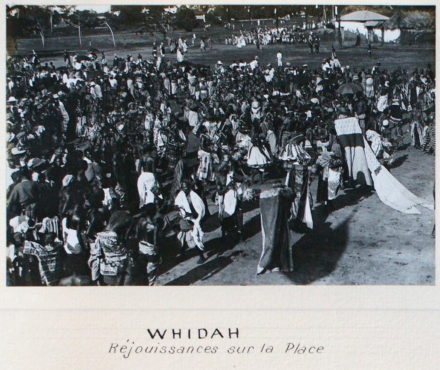
Les Figures 34 à 37 montrent une vaste place à Ouidah. L’ensemble architectural fortifié, en bas de la Figure 34, couvert de grands toits de paille, n’a pas été formellement identifié, mais tout semble indique qu’il s’agit de l’ancien fort portugais de São João Baptista de Ajudá, aujourd’hui Musée historique d’Ouidah. Le fort est mentionné dans le journal du ministre comme lieu de réception et comme ayant « l’aspect d’une ferme ». Fortier photographie encore d’en haut, peut-être depuis le balcon du siège de l’administration coloniale (que les Français appelaient Résidence). La foule présente sur la place reflète tout le spectre social de la ville, et mêle adultes et enfants. Les membres de l’élite locale, dont plusieurs sont probablement agudas, sont vêtus à l’européenne, avec des vestes et des canotiers ou des feutres, certains portant des drapeaux tricolores (Figure 34). D’autres sont habillés dans le style local, avec des pièces d’étoffe croisées sur l’épaule ou nouées à la taille, torse nus, et certains avec des boubous, et coiffés de turbans et de bonnets utilisés par les musulmans.
Le motif de la fête semble avoir été d’honorer le ministre et son entourage par la présentation de diverses congrégations religieuses. La procession des voduns et de leurs fidèles, provenant de divers temples, tenue sur la place publique et devant les autorités, était une pratique courante dans le royaume du Dahomey, perpétuée à l’époque coloniale. On voit ainsi plusieurs voduns des arbres (atinmévodun ou hunvé), avec leurs atchiná sur le dos (Figures 35 et 37), se mêlant aux vodúnsis mieux visibles sur les images suivantes. Le défilé officiel alterne avec les tambours (« tam-tams », comme l’annonce la légende, où les voduns dansent entourés de leurs adeptes et de curieux.

Les photographies des Figures 38 à 46 et 48 à 50 ont été prises par Fortier sur le même plan que les danseurs ou les adeptes des voduns. Les clichés sont nets. L’intensité de la lumière africaine a certainement permis une exposition très rapide, ce qui a permis de photographier le mouvement des femmes sans perdre en profondeur de champ ni en netteté. Fortier a dû positionner la caméra au niveau du cercle formé par les spectateurs, devant l’orchestre de tambours (Figure 44), en se concentrant sur les femmes qui dansent. Dans certains cas, il semble s’être placé au centre du cercle (Figure 39). Il sait se déplacer avec aisance entre les protagonistes, en réalisant des prises en une séquence si méthodique qu’elles semblent être photogrammes d’un film.
La proximité de l’objectif a permis de saisir des détails intéressants, par exemple, la variété des tissus utilisés dans les costumes des participants de la célébration. La majorité sont de production africaine, avec divers motifs géométriques. Il y a aussi de beaux exemples d’estampage à la main, comme on peut le voir dans les Figures 38 et 41. Les tissus européens, un élément important du programme d’importation du pays, sont également présents, comme pour le chemisier d’une femme et pour la jupe et le foulard d’une autre qui apparaissent dans la Figure 45.
Fortier a intitulé la série « Danses de Féticheuses », utilisant une fois de plus le vocabulaire du fétichisme pour désigner indistinctement et génériquement les vodúnsis, terme autochtone qui signifie littéralement « épouse du vodun », mais s’appliquant aussi bien aux hommes qu’aux femmes. Vodunsi désigne une personne qui, après de longs et complexes rituels d’initiation, est consacrée pour recevoir sur sa tête les divinités par la transe médiumnique. Pour qui ne connaît pas les sectes, il est difficile de distinguer quand le vodunsi est dans son état normal ou quand il est possédé par l’esprit. Cependant, certains signes, tels que les arrangements vestimentaires et d’autres détails, nous permettent d’identifier l’occurrence de la « possession », le moment où la personnalité du vodunsi s’efface et laisse place à la manifestation du vodun.
Le port par plusieurs vodúnsis de chapeaux de paille coniques, attribut caractéristique du vodun Avlekétè (alias Avrékété, Afrékété etc.), permet d’identifier le groupe comme des adeptes du panthéon de la mer (xù).64 Cette famille de voduns, vénérée anciennement par les pêcheurs hula de Ouidah, fut associée, peut-être depuis la conquête dahoméenne de la ville en 1727, au panthéon du tonnerre d’Hevioso (Xεbyoso). À Ouidah, le prêtre suprême de ce panthéon composé de la mer et du tonnerre est Daagbo Hunon (Daagbó Xùnɔ̀ ), qui aurait un certain pouvoir sur les autres temples.
Malgré la possible variabilité régionale et les transformations constantes auxquelles sont soumis les panthéons vodun, la famille de la mer à Ouidah est formée d’un couple parent, Agbè (ouXù) et Naétè, et de sa descendance, entre autres, Agbogu, Ahuagan, Tokpodun, Saho, Gbeyogbo et Avlekétè. Selon les informations fournies par la famille d’un prêtre Daagbo Hunon,65 Avlekétè porte un chapeau de paille, Agbè (le père de la famille) et Saho portent un chapeau de feutre foncé, généralement noir ou bleu, autour duquel, si le vodunsi est une femme, ils enroulent un foulard. Sur les Figures 38 et 39, le personnage qui porte une jupe rayée serait donc Agbè (ou peut-être Saho).

Selon les versions, Avlekétè peut être une femme ou un homme, mais, étant cadet de la famille, c’est toujours un enfant gâté, joueur et imprévisible. Dans les cérémonies, il ou elle danse toujours devant et ouvre la voie aux autres voduns en les imitant de façon parodique. Comme le vodun Legba, Avlekétè est aussi expert en langues, traducteur, celui qui fait le lien entre les dieux et les humains.66 Avlekétè aurait volé les clés de la mer à sa mère, Naétè, remplissant la lagune de poissons et apportant la prospérité aux pêcheurs. Il est spécialiste de la propagation de rumeurs et de ragots : de ce fait, lorsque les vodúnsis dansent, elles portent les mains à la bouche, dans un geste qui signifierait « ne parle pas, ne dis rien à personne » (Figure 44).67 Comme l’explique Le Hérissé à propos des rituels dont il avait été témoin dans la capitale Abomey :
« Les prêtresses d’Avrékété forment un groupe du « corps de ballet » de Hébyosô, le tonnerre. Au cours de leurs danses elles ne cherchent nullement à représenter, par leurs gestes, le flux et le reflux de l’Océan où réside leur divinité, comme nous en avons entendu émettre l’opinion ; elles miment un peu trop lascivement des danses d’amour. »68
C’est cette chorégraphie représentant des rapports sexuels que Fortier a captée à Ouidah. Elle est exécutée par huit vodúnsis (certainement déjà possédées par leur vodun, puisqu’ils étaient les seuls à pouvoir faire effectuer cette danse). Les quatre plus âgées ont des vêtements attachés autour de leur poitrine, et les quatre plus jeunes ont les seins découverts. Il convient de noter que cette différence d’habillement distingue, dans la vie profane de l’ancien royaume du Dahomey, les femmes mariées ou adultes des adolescentes encore célibataires. Toutes dansent pieds nus et portent divers colliers, les plus remarquables étant les plus longs, qui pendent sur une épaule et se croisent sur la poitrine. Ils sont de deux types principaux : ceux faits d’une enfilade de gros coquillages cauris, et ceux qui alternent des rangées de perles équidistantes avec ce qui semble être des groupes de deux ou trois cauris. Il faut rappeler que le cauri, objet récurrent dans la fabrication des colliers et autres activités rituelles des cultes vodun, servait de monnaie au Dahomey précolonial. La variété la plus utilisée était l’espèce Cypraea moneta, originaire des îles Maldives, dans l’océan Indien, apportée par les marchands sur les navires européens.
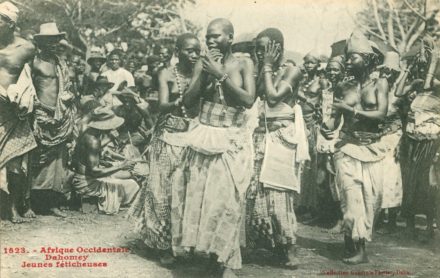
Les vodúnsis de la famille de la mer dansent en cercle en tournant dans le sens inverse des aiguilles d’une montre et de temps à autre se rapprochent par deux et miment l’acte sexuel. Selon Houna II, le prêtre Daagbo Hunon que nous avons consulté :
« La musique rythmique d’Avlekétè s’inscrit dans le cadre du processus de l’élection de sa femme, de l’amour à avoir pour sa femme de la jouissance que l’on tire de l’acte sexuel et toutes les conséquences que ça pourrait engendrer. En un mot, cette phase rituelle exprime par ailleurs, les responsabilités du couple dans le processus du mariage à partir du libre choix du partenaire jusqu’à la reproduction, l’importance de la femme dans le foyer, l’acte sexuel qui doit être préparé etc. »69
Il y a une certaine ambiguïté dans ce témoignage, car dans les cultes vodun, l’imitation symbolique du rapport sexuel est un élément de la fin du processus initiatique, lorsque le novice réintègre la vie profane. On dit que la nouvelle initiée, maintenant transformée en vodunsi, littéralement épouse (asi) du vodun, doit (ré)apprendre ses devoirs conjugaux pour avoir une vie conjugale saine, sans offenser son vodun. Ce que mentionne Daagbo Hunon Houna II est un fait, mais la danse publique photographiée par Fortier semble plutôt exprimer le plaisir hédoniste que savoure le vodun avec ses femmes.

Parmi le public se trouve une femme tenant un hochet et une pagaie décorée de ce qui semble être de petites clochettes (Figure 46, à droite, également dans les Figures 39, 40 et 41, à gauche). Il est à noter qu’Avlekétè est associé à la plage et à l’écume des vagues de la barre et, à ce titre, était invoqué par les piroguiers qui la franchissaient avec leurs marchandises ou leurs passagers. Cortez da Silva Curado, major de l’armée portugaise, écrit en 1888 :
Le fétiche de la mer s’appelle Avléquété et on [les Dahoméens] le croit responsable de provoquer des naufrages pour s’enrichir à bon compte. C’est aussi ce fétiche qui attire la concurrence du commerce extérieur vers la côte. Les rameurs des plages, quand la mer est agitée, n’embarquent pas sans dire leurs prières, et quand ils naviguent sur les vagues ils invoquent l’Avléquété.70

Une gravure (Figure 47) publiée dans l’hebdomadaire parisien L’Univers Illustré en 1891 dans un texte d’Edmond Chaudouin71 décrit le passage de la barre de la côte dahoméenne, où l’on voit dix pagaies de la même forme que sur la Figure 46. Chaudouin ne mentionne pas Avlekétè dans son récit, mais les gestes des rameurs sur l’illustration réalisée par le dessinateur français suggèrent l’invocation décrite par Curado.


Les trois dernières images de la séquence (Figures 48 à 50) montrent que la danse des vodúnsis de la mer se déroule à côté d’autres représentations. Sur la Figure 48, à gauche, on voit un groupe d’adeptes d’autres voduns du temple. L’homme vêtud’une double jupe courte (vlayá) par-dessus le pantalon pourrait être un initié du vodun Sakpata, associé aux pouvoirs de la terre et à la variole.72
Dans la Figure 49, les vodúnsis de la mer, après leur représentation, deviennent spectatrices d’un vodun des arbresqui danse devant le personnage qui est peut-être le chef du groupe, assis sous un parasol. Sur la dernière image (Figure 50), on voit le prêtre des voduns des arbres, avec son atchina sur le dos, derrière une adolescent qui porte sur sa tête un tabouret ou un objet votif en bois décoré d’une sculpture de femme agenouillée soutenue par deux autres femmes de plus petite taille. Il y a là une mise en abîme : la jeune femme porte sur sa tête la représentation d’une autre femme qui porte aussi quelque chose sur sa tête. Sur la gauche, on voit un prêtre tenant une double cloche.
Abomey
La ville d’Abomey (Agbŏmɛ̀), située à environ 120 kilomètres de la côte, était, comme nous l’avons vu, la capitale du royaume du Dahomey. Selon les traditions orales, sujettes à de nombreuses variations, les Aladahonus (Aladaxónú : peuple de la maison d’Allada), qui constituent une des branches du peuple Adja issu de l’ancien royaume du Tado, auraient quitté Allada au milieu du XVIIe siècle, en direction du nord. Après avoir traversé la région marécageuse connue sous le nom de Lama, ils arrivèrent sur un plateau où les Fons, les Guedevis et d’autres groupes indigènes s’étaient établis, et obtinrent la permission des chefs, les ayinon (propriétaires des terres), de s’y installer aussi. Dakodonu (Dakŏdonú), le chef des nouveaux venus, violant les accords conclus avec les ayinon, et après avoir vaincu un chef local nommé Dàn, aurait construit un premier palais appelé Dahomey (Danxomɛ̀ « sur le ventre de Dàn »). Son successeur, Huegbaja (Hwegbájà), vainqueur d’un autre chef local appelé Agli, aurait édifié à proximité un deuxième palais, appelé Agligomé (Aglìgòmɛ̀), autour duquel les rois successifs construisirent leurs résidences. C’est à partir de ce complexe architectural fortifié que s’est développée la ville, entourée de fossés défensifs, ce qui a donné le nom de la capitale du royaume, Abomey, littéralement « à l’intérieur des fossés « (agbŏ, fossés ; mɛ̀, intérieur).73 Comme déjà indiqué, le royaume du Dahomey, doté d’une organisation politique de plus en plus centralisée et d’une puissante armée, étendit son territoire pour atteindre la côte avec la conquête du royaume d’Ouidah en 1727. Dès lors, le Dahomey devient le principal fournisseur d’esclaves de la région. Pour répondre à la demande européenne, l’État investit dans la guerre annuelle menée contre ses voisins pour à capturer une partie de leur population. La plupart des captifs étaient vendus pour la traite atlantique. L’économie de la guerre et du trafic créa une grande richesse et fit la prospérité d’Abomey. En plus d’investir dans la création de nouvelles dépendances du palais d’Agligomé, chaque roi construisit un nouveau palais, à l’extérieur des fossés de la ville, pour les membres de sa lignée et leur entourage.
Dans un but d’ostentation et d’affirmation du pouvoir, les monarques célébraient chaque année la Fête des Coutumes, en l’honneur de leurs ancêtres. Le mot « coutume » était utilisé à Ouidah et Allada pour désigner les hommages que les capitaines européens, avant de procéder à l’achat des esclaves, devaient rendre au roi local. Par extension, les funérailles royales et leurs anniversaires, qui consistaient traditionnellement à offrir des cadeaux au défunt et à son successeur, étaient aussi appelés « coutumes », puisqu’il était prévu qu’à cette occasion les sujets du royaume et les représentants des pays étrangers, notamment les Européens, paieraient leurs « impôts ».
Ainsi, les Coutumes, qui duraient plusieurs semaines et se complexifièrent, devinrent de grands événements spectaculaires qui mobilisaient tout le royaume. C’était le moment où le roi, en collectant des cadeaux et des impôts, rassemblait et exhibait les ressources économiques du pays. Mais c’était aussi le moment où il était tenu de rétribuer généreusement ses sujets, en distribuant en abondance des boissons et de la nourriture à la foule et, souvent aussi des cauris (la monnaie du pays), des tissus et d’autres objets.
À l’occasion des Fêtes des Coutumes, on débattait des questions politiques et commerciales, on rendait la justice et on organisait des défilés militaires pour exalter le sentiment national et augmenter les chances de victoire dans la guerre. Outre cette multifonctionnalité (commerciale, politique, judiciaire et militaire), le cérémonial des Coutumes avait aussi une dimension religieuse et idéologique, dans laquelle les offrandes aux ancêtres (et autres divinités), y compris les fameux sacrifices humains, servaient à activer publiquement la mémoire du royaume, à assurer la sujétion du peuple et à dissuader les ennemis.
La dénonciation des sacrifices humains pratiqués au Dahomey a été formulée par des marchands antiabolitionnistes (disant qu’il valait mieux être déporté qu’être tué par un despote) puis par des missionnaires et des politiques interventionnistes, qui ont vu dans les horreurs de ces tueries la preuve de la barbarie des Africains et la nécessité de les convertir et de les « civiliser ». Ainsi, les sacrifices humains ont été l’un des arguments idéologiques qui ont justifié le missionarisme chrétien et l’occupation coloniale. Cependant, du point de vue local et selon la logique religieuse du vodun, les sacrifices humains étaient une forme de communication avec les ancêtres et une garantie de durabilité et de gouvernabilité du royaume.
C’est autour des Coutumes qu’apparut au cours des XVIIIe et XIXe siècles, le culte des Nesuhue (Nɛ̀súxwé), une catégorie de voduns associant les tovodum et les tohosu. Les tovodum correspondent aux esprits des rois, princes et princesses des lignages aristocratiques (ahovi), et à ceux des ministres et dignitaires de la cour du Dahomey rituellement déifiés. Les tohosu (littéralement roi, axɔ́sú, des eaux,tɔ̀) regroupent les esprits des enfants nés avec une anomalie physique, qui, après s’être noyés rituellement, sont installés dans des autels spéciaux. Chaque roi avait un ou plusieurs enfants déifiés comme tohosu, invoqués comme protecteurs de leurs lignées. Les temples de Nesuhue, y compris ceux dédiés aux tovodum et aux tohosu, sont répartis dans les palais de la ville et leurs rituels, qui suivent l’ordre dynastique, ouvrent le cycle des fêtes annuelles, et les fêtes des voduns publics (le panthéon du ciel (Mawu Lissa), le tonnerre (Hevioso), la terre (Sakpata) et autres) ne peuvent commencer qu’après l’achèvement des fêtes de Nesuhue.74 Avec la suppression de la monarchie dahoméenne faisant suite à la fin de l’occupation coloniale, la hiérarchie sociale qui structurait le royaume en séparant les lignées royales (ahovi) des lignées plébéiennes (anato) fut considérablement transformée. Les familles Anato, parmi lesquelles étaient traditionnellement recrutés les prêtres officiant des Nesuhue, commencèrent à reproduire elles-mêmes ces cultes, en particulier celui des tohosu ou « rois des eaux ». Comme toutes les familles anato, d’une manière ou d’une autre, étaient soumises à l’une des lignées ahovi, la prolifération des cultes tohosu vint réaffirmer et légitimer la structure hiérarchique précoloniale.75 En ce sens, le rituel religieux a continué à fonctionner comme un espace de revendication d’identités sociales et de contestation anticoloniale voilée, même si, par manque de ressources, les fêtes ont graduellement perdu leur splendeur passée.
Le quotidien du ministre explique en détail la visite à Abomey le 5 mai 1908. Tôt le matin, l’entourage est reçu à la gare de Bohicon par M Dreyfus, administrateur en chef du cercle de Zagnanado, et par M. Le Hérissé, administrateur en chef du cercle d’Abomey.76 :
« Grand afflux de populations appartenant aux différents cercles voisins, accompagnées de leurs chefs richement vêtus. Acclamations, tam-tams variés. Nous sommes partis pour Abomey (onze kilomètres), suivis d’une foule considérable. Très belle région. En chemin, nous avons croisé des indigènes qui travaillent le sol en préparant le semis de maïs, penchés sur le sol, en le brisant avec un instrument en forme de grosse et longue houe, au manche court et courbé. Merveilleuse région. Nous sommes passés devant la maison d’Alpha-Yaya, exilée à Abomey après les événements en Guinée. Belle maison. Devant la porte, la suite d’Alpha-Yaya. Attitude digne, solennelle.
Nous sommes arrivés à Abomey, qui ne nous fait pas l’impression attendue. Nous pensions trouver un village indigène avec de bâtiments anciens, des rues pavées, de vieux palais. Nous sommes devant un immense ensemble rural, couvert de champs bien cultivés et de zones où paît le bétail. Les logements des paysans sont en terre battue, confortables, mais sans grande particularité. Ruines de maisons d’argile, de tatas ou de fortifications autochtones. Il semble que les palais, eux aussi construits en terre, soient en ruines, et que l’ancien gouverneur ait voulu les laisser s’écrouler pour effacer la mémoire des anciens rois et l’esprit national ; l’histoire ne s’efface pas ; mais le jeune et illustre administrateur M. Le Hérissé a une autre idée. Il a l’intention (et le Gouverneur général et moi-même lui avons donné notre accord) de préserver et restaurer les vestiges des anciens palais et y construire une sorte de musée historique avec les objets précieux qu’il a collectés et catalogués, en constituant une sorte de classement.
Arrivée sur la place d’Abomey : plus de 3 mille indigènes. Nous avons été accueillis par mesdames Le Hérissé et Dreyfus, les charmantes épouses des deux administrateurs. Nous constatons le bon état de conservation de la maison, ornée pour l’occasion d’objets précieux sauvegardés de l’ancien palais (statues, oiseaux emblématiques en argent, cuivre, bois, armes fort intéressantes, trônes, etc. etc.) et de tam-tams très variés. Nous recevons les chefs, qui nous saluent et nous apportent des cadeaux. (Je fais un don de deux cents francs.) Je les décore solennellement de médailles devant la foule enthousiaste. »77
L’accueil s’est déroulé sur la place devant la Résidence, un bâtiment de deux étages dont la partie supérieure sert de logement à l’administrateur colonial et la partie inférieure abrite les bureaux (Figure 53). Il a été construit en 1901, à l’extérieur des douves et des remparts de la ville, et aujourd’hui le bâtiment abrite l’hôtel de ville. De l’autre côté de la rue se trouvent le palais de justice et la salle de conférence municipale.78 C’est là, pendant l’occupation française, que se déroule le défilé du 14 juillet.79 Le choix de ce lieu ne semble pas arbitraire, puisque la Résidence a été érigée près d’un immense fromager (Ceiba pentandra,en vernaculaire : hŭn atín ou hùntín), appelé l’ « arbre du Général Dodds », bien que probablement, comme plusieurs de ces arbres, il ait été consacré aux voduns (Figure 54).80 Ce n’est pas par hasard que, lors de la réception organisée pour le ministre, beaucoup de groupes vodúnsis venus lui rendre hommage se sont installés sous ses branches (Figures 57 et suivantes). La construction de la Résidence dans un lieu sacré pour la population locale pourrait indiquer un acte délibéré de domination symbolique de la part des Français.81 Des décennies plus tard, le gouvernement de la révolution marxiste de 1975, qui institua au Dahomey la République populaire du Bénin, fut encore plus radical : lors d’une campagne contre l’obscurantisme, il abattit l’arbre, accusé d’être un lieu de sorcellerie.82 Dans les Figures 51 et 52, on voit l’arrivée de l’entourage du ministre à la Résidence, précédée d’un cortège de tirailleurs. Fortier, qui a dû prendre de l’avance, est déjà au premier étage du bâtiment. Une fois de plus, nous constatons le recours, pour le transport local, à des hamacs suspendus à des tiges de bois. Les porteurs, qui ont marché plus de dix kilomètres, ne sont pas en uniforme comme à Cotonou, et ils portent des bonnets phrygiens. Dans la Figure 52, en bas à droite, on voit l’effigie d’un lion, emblème de Glele ; c’est une sculpture en bronze qui faisait probablement partie des « objets précieux sauvegardés de l’ancien palais » mentionnés dans le récit du ministre. En l’occurrence, « sauvegardés » se lit comme une justification de l’appropriation de 1900 : Agoli-Agbo, successeur de Béhanzin, intronisé par les Français, avait conservé son statut de roi d’Abomey avec tous les privilèges correspondants. Lors de sa déposition en février, « tout ce qui pouvait avoir de l’intérêt dans le palais a été enlevé pour être envoyé à l’Exposition [universelle de Paris] en 1900. Après l’Exposition, les objets retournèrent à la colonie du Dahomey, mais il fut décidé qu’ils seraient conservés à Porto-Novo, alors siège du gouvernement, « en attendant qu’une salle pratique soit construite à Abomey pour leur exposition ».83 Le texte du journal du ministre, mentionnant les objets qu’il appréciait à Abomey, indique qu’en 1908 les objets étaient déjà revenus de Porto-Novo et étaient en cours de catalogage par Le Hérissé.
Toujours dans la Figure 52, nous voyons certaines des personnes qui vont se produire dans les danses (à droite, sous les parasols). Sur la Figure 53, Fortier, qui s’est installé à l’avant de la Résidence, montre une partie des « 3000 indigènes » assistant à l’événement. À ce moment, le ministre est probablement en train de remettre aux chefs locaux les médailles mentionnées dans le compte rendu.
La Résidence, exemple typique de l’architecture coloniale française, établit, par sa hauteur, une séparation nette entre le haut et le bas. Le balcon supérieur, orné du drapeau tricolore omniprésent, en plus de la protection contre d’éventuelles inondations ou des animaux, place les acteurs européens dans une position élevée, qui reproduit et renforce la hiérarchie politique du moment. Il convient toutefois de noter que la même stratégie était appliquée pendant les Coutumes, lorsque le roi distribuait des cadeaux à la population à partir d’une estrade appelée ató.
Danses des voduns à la Résidence (1908)
Dans son journal, le ministre mentionne la tenue de « tam-tams très variés », qui ont dû avoir lieu parallèlement aux actes officiels avec les chefs locaux. Bien que les photographies de Fortier révèlent qu’un spectacle grandiose s’est déroulé sur la place de la Résidence lors de la visite de la délégation, Milliès-Lacroix est assez laconique sur ces événements. Un autre homme politique français, René Le Hérissé, député et oncle de l’administrateur et auteur Auguste Le Hérissé, était allé à Abomey cinq ans plus tôt, début 1903. Colonialiste convaincu, avec la mentalité de son temps, il ne cesse de s’enthousiasmer pour le « tam-tam « qu’il voit dans la vieille capitale :
« Au cours de mes voyages en Afrique, j’ai eu l’occasion de voir plusieurs spectacles équestres arabes et d’observer de nombreux ensembles de nègres ; mais je n’ai jamais vu de festivités publiques mieux organisées que celle qu’ils nous ont offertes à Abomey.
Nous sommes installés sur le balcon au premier étage du siège de l’administration, et devant nous viennent des groupes successifs des différentes corporations. On dirait qu’un directeur artistique a organisé une répétition d’un ballet colossal avec plus d’un millier de participants. Les fétichistes ont revêtu leurs habits de couleurs vives et variées ; il y a, autour de la place intérieure, cinq ou six groupes différents, chacun avec son orchestre, ses chanteurs et ses danseurs, et la fête commence au milieu d’une musique de tambours assourdissante, pendant que tous chantent et dansent à la fois dans une immense farandole.
Puis ce sont les fétichistes qui s’alignent au centre de la place et dansent individuellement les chorégraphies les plus fantastiques, maniant les récades, les cannes et l’épée avec une dextérité extraordinaire, tandis que les chefs, stimulés par leurs sujets qui frappent des mains en rythme, se contorsionnent aussi des manières les plus variées. Les danses guerrières sont suivies de danses érotiques : c’est indécent, mais on ne peut nier que les interprètes sont de vrais artistes ; puis c’est la danse collective, qui annonce la fin du spectacle, qui dure plus de deux heures. »84
Vodunsis des temples Nesuhue


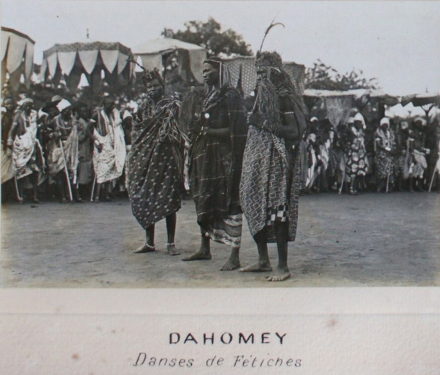
Les Figures 55 à 62 montrent des vodúnsis de temples Nesuhue, qui, comme indiqué, correspondent aux esprits des ancêtres des lignées royales et des notables de la cour. Fortier photographie d’en bas, en disposant l’appareil devant les différents groupes de personnes qui se produisaient sur la place de laRésidence, à côté de l’immense fromager qui apparaît en fond dans de nombreuses images.
Dans la Figure 55, nous voyons un groupe de voduns Nesuhue se manifestant dans leurs médiums, les nesuhuesis dans ce contexte. Ici ce sont des hommes, mais il existe aussi des femmes nesuhuesis. Les vêtements de parade et la disposition des grandes pièces d’étoffe attachées par-dessus l’épaule indiquent la présence des dieux incarnés et non plus d’humains. Derrière les voduns, plusieurs parasols, objets de pouvoir qui contribuent à la protection et à l’identification des différentes collectivités familiales auxquelles ils appartiennent. Fabriquées à partir de toile de coton importée, les figurines découpées et appliquées contiennent plusieurs couleurs, suivant une technique locale. Certains motifs symboliques, en plus de l’aspect décoratif, peuvent faire référence à des rois ou à des histoires et proverbes qui leur sont associés.85 Les vêtements des voduns Nesuhue sont assez complexes et varient selon le moment, que ce soit le début du cycle des festivités, le point culminant, lorsque les voduns parés montrent toute leur splendeur, ou la conclusion. L’usage et la position de certains accessoires constituent un code qui indique le degré d’initiation de la personne, son état de possession et l’identité du vodun. Les médiums masculins, par exemple, lorsqu’ils manifestent leurs vodun, portent deux grands vêtements, ou avò (avɔ̀ ) dont l’un est placé sur la taille, appelé wlŏ ganlìn(ce qui signifie attacher l’étoffe en enroulantune partie de celle-ci), et l’autre nyì av ɔ̀kɔ̀ (placer le tissu sur le cou). Ainsi, le port du tissu sur une seule épaule en laissant l’autre à découvert, dans la vie profane, distingue les princes (ahovi) et, en contexte sacré, signale la présence du vodun manifesté (Figures 55, 56 et 57).


Les médiums nesuhuesis femmes arrangent leurs vêtements différemment. Elles superposent plusieurs pièces d’étoffe telles que jupons et jupes, et peuvent porter une tunique, sur laquelle elles passent une autre bande de tissu comme ceinture. Les vodúnsis qui ne portent pas de tuniques se nouent une étoffe sur la poitrine. Il est obligatoire pour tous les adeptes du vodun de marcher pieds nus, et pour les voduns manifestés eux-mêmes. Au Dahomey, seul le roi avait le privilège de porter des sandales.
En plus des différents types de colliers, dont la combinaison de perles et de couleurs a différentes significations, de nombreux vodúnsis Nesuhue accrochent autour du cou des anneaux de petites perles colorées percées par un fil, appelés kanhodenu (kanxweɖenu) ou afafa (voir Figure 59). Autrefois, des ornements analogues étaient utilisés par les membres de la cour royale d’Abomey.86 Des ornements similaires sont connus dans d’autres cours, comme celle du royaume Akan (Ashanti) au Ghana ou celle du royaume du Bénin au Nigeria, .
Un autre élément qui distingue les médiums Nesuhue est le bracelet de cauris, noué entre l’épaule et le coude, appelé abakué (àbăkwɛ́), de àbă, partie supérieure du bras, et kwɛ́ ou àkwɛ́ qui signifie argent, carle cauri a servi de monnaie au Dahomey. Selon le degré de hiérarchie d’une personne, ces bracelets peuvent avoir une ou plusieurs rangées de cauris et peuvent aussi comporter des perles de couleur rougeâtre. Les plus hauts initiés, appelés mahisi (maxísì) portent l’abakué le plus long, à plusieurs brins (Figures 55, 57 et 59).87 Comme on le voit, la tête est ornée de différentes façons. En général, la nesuhuesis de grade inférieurn‘y attachent qu’une bande de tissu appelée takàn, qui signifie corde de tête (Figure 60). Les tresses, pour permettre la venue des voduns, doivent êtres défaites. Les nesuhuesis de haut range se couvrent la tête d’un foulard noué ou de divers types de chapeaux. Sur la Figure 55, l’homme au centre porte un chapeau à large bord, probablement en velours. Dans l’ancien royaume du Dahomey, les grands chapeaux étaient des objets de prestige réservés au roi, aux membres de la famille royale, aux dignitaires et aux blancs.88 Dans la même image, plusieurs hommes portent une sorte fez, généralement orné de pièces de tissu représentant diverses figures. Ces genres d’articles, autrefois réservés aux princes dahoméens, sont aujourd’hui vendus à Abomey comme souvenirs. D’autres nesuhuesis portent une sorte de bonnet phrygien, peut-être d’influence nagot.

Les tohosu sont, comme nous l’avons vu, l’une des catégories les plus importantes de voduns Nesuhue, correspondant à l’esprit des enfants nés avec des malformations physiques. On les reconnaît aux rangées de petits coquillages accrochés aux cheveux (Figure 55, l’homme au premier plan à gauche ; Figure 57, le personnage central ; Figure 59, la cinquième femme à partir de la droite). Selon les informations recueillies à Abomey, les tohosu utilisent parfois un chapeau fait de fils de paille tressés appelé dĕzàn, littéralement « branche de palmier » (Figure 56, l’homme à droite ; Figure 59, la première femme à droite).89 La Figure 59, l’une des images emblématiques de Fortier, intitulée « Les vétéranes amazones », montre une rangée de mahisis ou nesuhuesis de haut rang, reconnaissables, entre autres, à leurs bracelets de cauris. Cependant, un bon connaisseur des cultes Nesuhue considère qu’il s’agissait de « vodún gankpo » (grands voduns) et non d’« amazones ».90 Ces guerrières, surnommées amazones par les Européens, étaient considérées comme les « épouses » du roi (ahosi), et formaient plusieurs régiments de l’armée dahoméenne. Certaines étaient des vodúnsis, et leurs régiments étaient toujours accompagnés de « fétiches » protecteurs.91 La double participation des amazones, sur le champ de bataille et dans les temples, expliquerait en partie l’éthos militaire du culte Nesuhue, l’exécution de danses à connotations martiales (comme l’adănhŭn ou rythme de colère) et l’usage d’armes dans les vêtements des nesuhuesis. Dans la Figure 59 on remarque, suspendus à la taille des nesuhuesis, leurs poignards, appelés en fongbe hui (hwĭ).
Au XIXe siècle, les rois Dahoméens aimaient mettre en valeur la furie et la fougue guerrière du régiment d’amazones en présence des Européens et d’autres étrangers. À cette occasion, les intrépides guerrières, dans une sorte d’exercice ou de démonstration militaire, simulaient l’attaque d’un village et la capture de ses habitants, représentés par les esclaves du roi. La participation des « amazones » aux activités de guerre, à la ritualisation de la capture des esclaves et au culte Nesuhue nous permet d’imaginer comment le langage de la guerre et de l’esclavage a pu pénétrer les rituels religieux.92 Unautre trait distinctif des Nesuhue, non reproduit par le vodun « public », est l’utilisation de la canne (kpogɛ̀, littéralement « gros bâton »). Dans le contexte africain, le bâton, comme le trône, est un insigne d’autorité politique et religieuse. Dans l’ancien Dahomey, les cannes dénotent le prestige et la distinction de l’aristocratie. Dès le XVIIIe siècle, des documents parlent des femmes du roi « tenant à la main des cannes d’argent doré, comme des pommeaux d’or », et au XIXe siècle, de nombreux voyageurs ont rapporté l’utilisation de cannes par des ministres et de hauts dignitaires.93 Forbes, par exemple, décrit des femmes troubadours de cour portant une canne bleue en forme de béquille, orné d’une encoche et d’un foulard jaune à l’extrémité supérieure.94
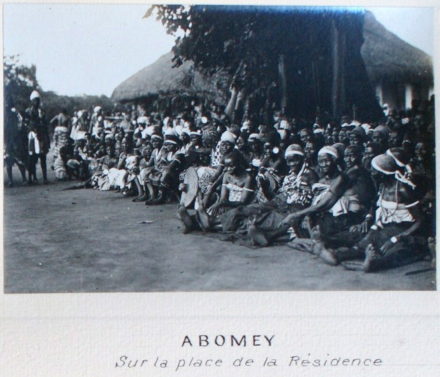
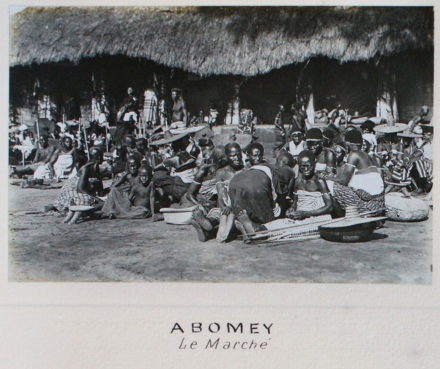
Les images de Fortier montrent différents types de cannes, courtes et longues, y compris celles ayant une extrémité en « U » décrites par Forbes, visibles sur les Figures 61 et 62. L’utilisation d’une canne avec une foulard au sommet est visible sur la Figure 58, chez les hommes, et sur la Figure 59, chez les femmes.95 Cette combinaison de canne et de foulard est caractéristique des voduns Nesuhues, et se perpétue dans la Casa das Minas de São Luís do Maranhão au Brésil, où il est devenu un signe distinctif exclusif du culte afro-brésilien appelé tambor de mina.96 De façon générale, on peut conclure que plusieurs éléments vestimentaires des nesuhuesis – chapeaux, colliers, cannes – reproduisent les usages de l’habillement séculaire des membres de la cour du Dahomey, « contribuant à créer cette attitude majestueuse qui correspond à l’importance du fétiche qu’ils représentent ».97 Il n’y a guère d’autre moyen de situer l’identité des différents voduns Nesuhue qui apparaissent sur les photographies. Il est probable qu’une partie des voduns de la Figure 59 incorpore l’esprit d’un des rois du Dahomey. À côté du vodun manifesté, on voit aussi, dans les Figures 57 (au centre) et 59 (à gauche), un homme à la poitrine découverte et portant un collier circulaire. Il pourrait être prêtre Nesuhue ou maître de cérémonie.
Le culte Nesuhue est un système rituel qui s’est constitué au cours des XVIIIe et XIXe siècles à partir d’éléments d’origines multiples, mais sa liturgie trahit une forte influence de la culture religieuse des Mahi et des Agonli, qui vivent au nord et à l’est d’Abomey. Par exemple, les cérémonies d’initiation exigent la présence de prêtres venant de la région du lac Azili, dans la région des Agonli, et les vodúnsis qui atteignent le plus haut degré d’initiation, comme nous l’avons vu, sont appelés mahisi (les femmes de Mahi). On trouve aussi quelques tohosu, comme Azaka, qui proviennent de Savalou dans la région de Mahi. Par ailleurs, au XIXe siècle, le pontife des temples Nesuhue d’Abomey était l’Agassunon, c’est-à-dire le grand prêtre du vodun-panthère Agassu (Agasú), souvent considéré comme le premier ancêtre (tohuiyo ou tɔ́xwyɔ́) des familles royales des Dahomey (ou parfois comme un vodun autochtone antérieur à l’arrivée de ces familles sur le plateau Abomey, ou même comme un vodun d’origine mahi).
Sur la Figure 56, on voit trois voduns Nesuhue, reconnaissables au placement de l’étoffe sur l’épaule et au brassard de cauris de l’homme au premier plan. Leurs identités n’ont cependant pas encore été déchiffrées. Tous les trois sont couronnés d’une branche de palmier (dĕzàn), et deux ont un chapeau fait de fils de paille tressés, avec une sorte de plume. Ils tiennent un chasse-mouches fait de feuilles de palmiers et portent des colliers de grosses fèves. Le chapeau suggère que ce sont des tohosu, mais les adeptes d’Agassu peuvent aussi porter des bonnets de paille tressée.98 La légende de la Figure 61 indique : « Le marché », mais nous pensons que Fortier avait tort : l’image semble plutôt représenter des membres d’une congrégation religieuse assis par terre, se reposant ou attendant leur tour pour participer aux cérémonies célébrées sur la place de la Résidence. Les colonnes et le toit de paille du bâtiment, en bas de la photo, semblent être ceux de la maison visible sur la Figure 60, derrière le fromager. Les femmes à droite, d’après leurs bracelets de cauris et la bande d’étoffe sur leur tête, peuvent être des vodúnsis des temples Nesuhue. En bas de l’image se trouve un bâton ou une canne en « U », caractéristique, comme nous l’avons dit, de certains voduns Nesuhue (voir Figure 62). Les grands chapeaux à large bord, en paille tressée, étaient également utilisés par ces voduns (voir Figures 60 et 62). Ainsi, l’image semble capturer un moment de détente d’un groupe religieux en marge de la fête organisée en l’honneur des autorités coloniales.
Dans ce groupe de photographies des Nesuhue (Figures 55 à 62), seule la dernière montre les vodúnsis en train de danser. Ce sont de « grands voduns » (vodún gankpo), dont peut-être certaines des mahisis de la Figure 59, recevant les esprits des anciens rois du Dahomey ou d’autres dignités ancestrales. Après une longue attente protocolaire, le moment culminant de la fête était la danse des voduns, quand on battait les tambours et qu’on entonnait les chants des différents rois en évoquant, dans l’ordre dynastique, leurs exploits militaires et leurs autres épisodes glorieux. Quel est le sens de toute cette mobilisation rituelle en présence des colonisateurs blancs ? Pourquoi toutes ces congrégations sont-elles venues invoquer leurs dieux devant l’autorité étrangère, en dehors des temples et hors du calendrier religieux ? Était-ce suite à une convocation des Européens ? Ou bien les chefs locaux agissaient-ils pour complaire aux Français, animés par des intérêts clientélistes ? Dans la première partie de ce travail, nous avons suggéré qu’à l’occasion du voyage du ministre, les représentations sur la place de la Résidence visaient à obtenir des ressources pour restaurer les palais royaux. Les clichés de Fortier ne suffisent pas pour analyser la dynamique du pouvoir dans les coulisses de l’événement. Doit-elle être interprétée comme la preuve d’un processus de folklorisassion ou de désacralisation de la culture religieuse autochtone, favorisée par la colonisation? Le Dahomey avait une longue tradition de manifestations annuelles multiples, les Coutumes, organisées comme un spectacle par les rois et les princes pour montrer, impressionner et, dans le passé, intimider l’ennemi. Une autre interprétation est que, dans ce cérémonial à l’intention des Français, les princes et autres dirigeants locaux ont vu une occasion d’attiser, par l’invocation des ancêtres Nesuhue, la mémoire du passé précolonial devant les forces d’occupation. Ce serait là un moyen, non dénué de nostalgie, d’affirmer la conscience historique et la fierté du peuple soumis.
Les adeptes des voduns publics
Les Figures 63 à 66 montrent plusieurs groupes d’adeptes des voduns publics. À l’exception du celui de la Figure 66, qui semble avoir été réalisé depuis le balcon de la Résidence, les clichés ont été pris par Fortier au même niveau que les personnes photographiées. La Figure 63, un autre des clichés les plus diffusés de Fortier, montre un groupe d’adeptes du vodun Hevioso (Xεbioso), le tonnerre, de la ville de Hevie (Xεvyè). C’est le plus connu du panthéon du tonnerre (sò), qui comprend aussi Sogbó (le grand sò), Jakata sò, Aklɔnbε sò, Akute sò, Gbàdɛ́ etc. On pense que les Aizos, premiers habitants de la région d’Allada, étaient les premiers sectateurs de sò de la région.
Le culte fut importé par les rois Dahoméens à Abomey et, avec le temps, Sogbó ou Hevioso, dieu guerrier, chaud, viril, vengeur et juge, fut associé à la royauté et, par extension, à la capitale du royaume. Le lien entre le roi et le tonnerre existait aussi à Oyo, où l’orisha de le tonnerre, Sango (Ṣàngó), était le dieu principal des aláàfin et du royaume. À Abomey, le lien entre le roi et sò se traduisit par une forte présence vodun dans les temples Nesuhue, en particulier les divinités tohosu. Cette proximité expliquerait l’usage de colliers circulaires (kanhodenu) par plusieurs vodúnsis dans la Figure 63. L’élément qui attire l’attention dans cette image est l’emblème de Hevioso, la « hache du tonnerre » ((sosyɔ́ví), représentant la tête d’un mouton crachant du feu ou des éclairs. Elle est brandie par plusieurs des protagonistes, Une autre caractéristique des vêtements des vodúnsis de Hevioso est la jupe (vlayá) semblable à celles portées par les adeptes de Sakpata (voir Figure 48).99 Le casque de la troisième personne à partir de la droite, avec des plumes blanches, serait indicatif de l’association de cette famille de voduns avec les couleurs blanche et rouge. On peut aussi noter les bracelets de cheville en cauris et l’utilisation de la cloche en fer (alinglé), qui sert au vodun pour saluer ou répondre aux salutations.
Les femmes de la Figure 64 semblent être des adeptes du panthéon de la mer, car plusieurs portent le chapeau de paille caractéristique du vodun Avlekétè (voir ci-dessus dans la section « Ouidah »). D’autres ont sur la tête un ruban et une plume de perroquet rouge (kεsɛ́), signe des « voduns rouges » (hunvé).100 Le Hérissé explique qu’à Abomey, le panthéon de la mer coexiste avec le panthéon du tonnerre d’Hevioso, dont on peut d’ailleurs voir l’emblème sur la gauche de l’image (esosyɔ́ví).101

La Figure 65 montre un groupe d’adeptes du panthéon Sakpata, associé à la terre et aux épidémies de variole et d’autres dermatoses. Les temples de ces voduns, considérés comme très dangereux, ont toujours eu des relations tendues avec les rois du Dahomey ; ils ont plusieurs fois été chassés de la ville puis réintégrés.102 Les voduns de cette famille sont reconnaissables à l’usage de colliers appelés sɔ́kplá, alternant cauris blancs et graines sombres (atínkwín). La disposition de l’étoffe, nouée sur la poitrine, serait une caractéristique des « anciens Sakpata ». Sur la partie supérieure du bras sont attachées des ficelles de paille tressée, appelés au Brésil contraeguns, mais différentes de l’abakué des Nesuhue en cauris. Les chevilles portent des rangées de cauris. La femme au foulard semble tenir un faisceau de fibres de palmier en forme de balai, emblème de ce vodun, appelé au Brésil xaxará. Le chapeau de feutre, porté par la quatrième personne à partir de la gauche, est appelé gbejè ; il est généralement porté par les Nesuhue (Figures 55 et 58), mais parfois aussi par les autres catégories de voduns (Figure 63). On peut noter l’utilisation des parasols par cette congrégation de Sakpata, qui pourrait indiquer son lien, peut-être de vassalité, avec un groupe de la famille royale.

La Figure 66 montre deux groupes de vodúnsis exécutant leurs danses devant un public nombreux, probablement, comme il est d’usage dans la chorégraphie des voduns, selon un mouvement circulaire dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. Les colliers de perles sombres, croisés sur la poitrine et le dos, ainsi que les chapeaux et les bandeaux à plumes, suggèrent qu’il s’agit de voduns « publics » – peut-être d’un temple de Guede, divinité des populations indigènes du plateau d’Abomey, qui porte ce genre de parures.103 C’est la seule image de la danse des voduns de la série d’Abomey que Fortier a photographiée d’en haut – apparemment du premier étage de la Résidence.
Danses des voduns sur la place Simbodji, palais de Béhanzin (1909)
La série des Figures 68 à 76 montre une procession et des danses de vodúnsis devant les murs du grand palais d’Abomey, identifié comme le palais de Béhanzin par Fortier, comme l’indique la légende de la Figure 67. Les clichés de cet événement, pris en mars 1909, ont été publiés par le photographe dans la même série de cartes postales dans lesquelles il a attribué les images des présentations voduns sur la place de la Résidence, prises en mai 1908. Nous avons pu les dater avec certitude grâce à la documentation écrite qui fait référence aux deux voyages de Fortier en compagnie des autorités coloniales. Le journal du ministre, en 1908, ne mentionne aucun autre « tam-tam » que lors de l’évènement organisé sur la place de laRésidence (comme nous l’avons vu, Figures 55 à 65).104 D’autre part, un rapport de l’administrateur d’Abomey en mars 1909 relate le passage du gouverneur général William Merlaud-Ponty dans la ville et fait allusion à la place Simbodji, « où les chefs et les féticheurs avaient organisé de grands tam-tams en son honneur ». La place Simbodji105 se trouve à l’extérieur du grand palais d’Abomey, où Béhanzin a résidé pendant son règne – exactement l’endroit que nous voyons sur les photographies de Fortier.
Selon le compte rendu officiel, le 22 mars 1909, lors de la visite de William Merlaud-Ponty au palais royal, l’administrateur résident français, René Le Garrerès, qui succéda à Le Hérissé, proposa à nouveau la construction d’un musée historique. Ce sujet avait aussi été abordé en 1908 lors du passage du ministre à Abomey, comme nous l’avons vu. Le texte du rapport de 1909 indique qu’un projet de musée avait été présenté pour la première fois en 1903 par l’ancien résident Victor-Louis Maire et avait été approuvé par l’ancien gouverneur M. Liotard, mais n’avait jamais été mis en œuvre.106 Le capitaine Maire, membre du corps expéditionnaire françaises qui avait conquis le Dahomey, fut le premier Européen à documenter en détail les bas-reliefs des palais d’Abomey. Ses dessins, réalisés entre 1893 et 1894, ont été publiés dans l’ouvrage Dahomey.107 Malgré l’échec de la proposition initiale de Maire de créer un espace pour sauvegarder ce patrimoine artistique, nous lisons dans le journal du ministre qu’en 1908 la restauration des palais royaux restait au centre du projet de musée, à côté de la mention des objets dynastiques catalogués par Le Hérissé. En 1909, la perspective est différente : les palais royaux sont disqualifiés comme monuments historiques et l’accent est mis sur les objets de culture matérielle, justifiant la création du musée :
« […] un projet qui avait pour but la réunion définitive et la conservation assurée de tous les meubles, bijoux, etc. ayant appartenu aux rois d’Abomey, dont un grand nombre ont été jugés assez intéressants pour figurer à l’Exposition universelle de 1900, et qui sont l’objet de vénération des Dahoméens en même temps que de la curiosité des Européens. Il est certain que ces objets abrités dans des cases (fussent-elles nommées ‘palais’) en terre de barre coiffées de toits de chaume, sont exposés à être anéantis par le feu, détériorés par les intempéries ou encore dérobés par des fanatiques ou simplement par des cambrioleurs ; ce serait dommage en somme – ont pourrait, pour les abriter sérieusement, construire un bâtiment solide et durable, muni de portes fermant à clé et couvert en tôle. Cette construction présenterait, dans un ordre chronologique, par exemple, tout ce qu’on a conservé d’intéressant se rapportant à la dynastie dahoméenne ; des pancartes renseigneraient les visiteurs qui pourraient se reporter pour plus de détails, à une notice (que M. Le Hérissé, compétant en la matière, ne se refuserait pas d’écrire), et qui serait vendue par le gardien. »108
Le texte est révélateur : le musée est imaginé dans son intégralité, de l’architecture à la brochure explicative, en passant par la muséographie chronologique. La proposition de sauvegarder les objets de la culture matérielle du royaume subjugué est justifiée par son caractère « intéressant ». Rappelons que, depuis la fin du XIXe siècle, l’idée de musée ethnographique a fait son chemin en Europe. À Paris, le Musée de l’Homme du Trocadéro se spécialisa dans l’exposition d’objets provenant des colonies françaises109. Cependant la création d’un musée en Afrique même était une proposition différente. Les autorités coloniales apprécièrent l’initiative, mais sans aller jusqu’à la financer ni la soutenir concrètement. Ainsi, l’idée du musée historique d’Abomey, présentée en 1908 par Le Hérissé au ministre et au gouverneur général, dut être présentée de nouveau avec plus d’insistance en 1909. Lors de ce deuxième voyage en ville, William Merlaud-Ponty a pu se remémorer le projet de musée en regardant des représentations de vodúnsis dans leur « cadre original » : la place Simbodji, devant le grand palais d’Abomey. Son emplacement, situé à l’extérieur des remparts, était justifié par le fait que les vodúnsis n’avaient pas accès aux palais royaux. Les photographies de Fortier documentent la grande muraille (ahohó) construite avec de l’argile rouge poreuse mélangée à du sable ferrugineux, que les Français appelaient terre de barre, une expression dérivée de mot portugais « barro » ou boue. On voit aussi sur les images un immense toit de paille, recouvrant la structure où se trouvait le portail du palais. Comme nous l’avons déjà dit, le roi Béhanzin mit le feu à la ville avant de quitter Abomey envahie par les Français. Agoli-Agbo, son successeur nommé par les Européens, fut responsable de la première intervention pour conserver les palais royaux, dont les toits avaient été détruits par le feu. Le toit de paille photographié sous d’innombrables angles par Fortier est probablement celui construit à l’initiative d’Agoli-Agbo immédiatement après son intronisation.110 Il a une forte pente et possède un large avant-toit protégeant des pluies saisonnières les murs ornés de bas-reliefs. Dans les années 1930, le gouvernement colonial remplaça les toits de paille, responsables des incendies récurrents dans la ville, par des toits de tôle ondulée. Les nouveaux toits furent initialement construits avec une moindre inclinaison et avec des avant-toits beaucoup plus petits que ceux d’origine. Les conséquences pour les bas-reliefs furent terribles, car les intempéries dégradèrent les parties inférieures des murs. Aujourd’hui, les bâtiments du Musée Historique d’Abomey ont un toit en tôle ondulée, mais avec la pente d’origine et un avant-toit de type traditionnel.111
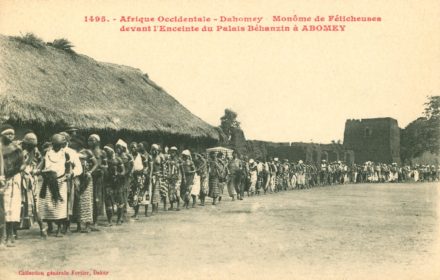

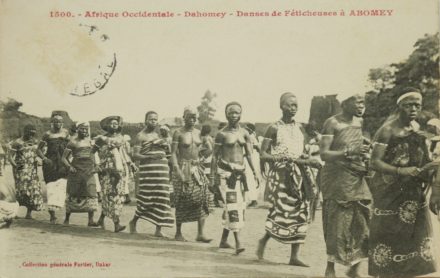
Les trois premières images de cette série (Figures 68 à 70) montrent des vodúnsis Nesuhue paradant en file indienne, probablement devant les autorités, avant de commencer les danses. Elles ne portent pas leurs robes d’apparat, et il est peu probable qu’il y ait des voduns manifestés. Cependant, le grand nombre d’initiés indique l’importance des cultes Nesuhue dans la ville. Les femmes plus âgées portent un tissu couvrant leurs seins, et les plus jeunes, en âge de se marier, ont les seins découverts comme dans la vie profane quotidienne. Beaucoup de femmes portent des brassards de cauris ou abakué différents de ceux des Nesuhue. Plusieurs tiennent des chasse-mouches réalisés avec la queue d’un quadrupède (sí,sɔ́sí, qui signifie queue de cheval). D’autres utilisent la bande de tissu sur le front ou une sorte de chapeau. On en voit aussi une qui porte un collier circulaire (Figure 68). Comme dans les autres représentations photographiées par Fortier, nous avons une fois de plus l’occasion d’observer la variété de la production locale de tissus. Les motifs, pour la plupart géométriques, ont été réalisées par tissage, par teinture à la réserve ou par application directe de colorant sur les étoffes. Il y a peu de tissus européens sur ces images.
Les Figures 71 à 74 illustrent la danse d’un groupe qui semble comprendre des adeptes de divers temples. Certaines des images de la séquence ont été prises par Fortier dans un bref intervalle, créant un effet dynamique quasi cinématographique. Les colliers, lorsqu’ils sont faits de cauris alternant avec des graines sombres, signalent la présence du vodun Sakpata, mais les adeptes de Dan, le serpent vodun associé à l’arc-en-ciel (ayìɖóhwεɖó) et à la richesse, utilisent aussi ce type de collier. Un autre signe de la présence conjointe de ces deux catégories de voduns, qui coexistent dans de nombreux temples, est l’utilisation de la bande d’étoffe sur le front (takàn) avec la plume rouge. Cependant, les deux personnages vêtus de blanc, à droite de la Figure 71, sont des adeptes de Lissa (Lisà), le vodun du ciel, associé au caméléon.112 Ils utilisent un collier circulaire et une cloche (alinglé).
La jeune femme de la Figure 72, à droite, devant le groupe de danse, semble avoir noué à sa taille une étoffe décorée de motifs semblables à ceux teints à la cire (wax prints). Les os des mains, comme dans une radiographie, sont imprimés plusieurs fois sur la surface du tissu. La deuxième femme à partir de la gauche porte aussi un tissu à motif figurant des yeux dans des cercles.
La Figure 74 montre deux femmes portant des pièces de tissu comme jupes, l’une claire et l’autre foncée, décorés de motifs floraux dans des carrés. Apparemment, ce sont des tissus européens, peut-être destinés au départ à la décoration d’intérieur.

La Figure 75, qui a un fond différent à cause du changement de cadrage, montre plusieurs vodúnsis qui se reposent. Elles aussi ont sur le front le takàn avec une plume de perroquet et sur la poitrine des colliers de cauris et de graines. Beaucoup d’entre elles attachent des rangées de cauris sur leurs chevilles. Si ces vodúnsis n’appartiennent pas au groupe représenté dans les Figures 71 à 74, on peut supposer qu’elles ont du moins des voduns apparentés.
Par contre, la Figure 76, bien qu’ayant le même fond d’arbres que la précédente, ne représente pas le même groupe de danseuses ; ici la plupart des vodúnsis, bien qu’elles aient sur le front le ruban et la plume, ne portent pas de colliers de cauris, surtout en perles sombres, un marqueur de différence complété par l’utilisation de brassards. À Abomey, nos interlocuteurs ont associé ce groupe au vodun Agassu, le premier ancêtre des lignées princières, dont les adeptes croisent des perles de couleur rouge-brun sous l’étoffe qui recouvre leur poitrine.113 Les vodúnsis de cette image, probablement en transe médiumnique, sont en pleine danse, suivant une chorégraphie collective où le geste de base semble consister, comme dans d’autres danses vodun, en un mouvement circulaire des omoplates.

Dans la dernière image de la série d’Abomey (Figure 77) se trouvent des membres d’une congrégation de Hevioso, assis à l’ombre d’un arbre de type lisetin. Ils semblent se reposer ou attendre le moment de danser lors des cérémonies sur la place Simbodji. Le personnage assis sur le trône, sous un parasol et coiffé d’un chapeau européen, serait le vodunon, littéralement le « propriétaire » ou « maitre du vodun », c’est-à-dire le chef du temple et de ses adeptes. Cette fonction est généralement assumée par le chef de la collectivité familiale dont relève le vodun, mais parfois il délègue les fonctions rituelles à une autre personne. À gauche du vodunon, sont assis sur des tabourets alignés les adeptes, avec plusieurs voduns manifestés de la famille du tonnerre. Ceux qui ont un ruban rouge et une plume sur le front se distinguent de ceux qui portent une coiffure semblable à celle de la Figure 63, avec des plumes rouges et blanches. Le personnage assis à la droite du propriétaire, vu sa position sous le parasol, pourrait être le second du temple ou le porte-parole du chef. Plusieurs des voduns, y compris le chef, portent des cloches ou des clochettes (parfois doubles). Comme déjà indiqué, les clochettes sont utilisées pour saluer et répondre aux salutations. On remarque, entre les jambes d’un des vodúnsis, une « hache de tonnerre » (sosyɔ́ví), ce qui confirme qu’il sont affilié à Hevioso.114
Région de Savalou
Le 5 mai 1908, en soirée, le ministre et ses compagnons voyagent en train de Bohicon (Abomey) à Aguagon, un village situé à l’est de Savalou, sur le territoire de Mahi, à l’extrémité de la voie ferrée. La délégation arrive le 6 mai à six heures du matin, et se déplace en hamac à porteurs jusqu’à la rivière Ouemé pour visiter le chantier du pont (Figure 78). Comme nous l’avons dit, cet ouvrage, construit sur la plus grande rivière de la région, devait permettre l’extension du chemin de fer vers le nord de la colonie du Dahomey. Le rapport de l’expédition ministérielle sur les rives du fleuve est assez étrange car il révèle le système complexe des responsabilités impliquées dans la conception du pont et les difficultés logistiques rencontrées pour sa construction.
On lit dans le journal de Milliès-Lacroix :
« Nous sommes arrivés à Ouemé à 9h30. Forte chaleur ; le soleil est ardent. L’administration avait essayé de nous dissuader d’y aller ; on voulait cacher le fait que les matériaux du pont avaient été abandonnés au milieu de la brousse pendant deux ans par indifférence ou mauvaise volonté de la part des monteurs : la Société des Batignolles est de fait le maître d’œuvre du pont ; elle s’est engagée à fabriquer les composants et à les transporter jusqu’au port. C’est la Compagnie de chemin de fer du Dahomey devrait effectuer le chargement du matériel par voie ferrée, mais la société devait fournir l’équipe de montage, dont les salaires étaient à la charge de la colonie. Les monteurs avaient été envoyés, mais, impressionnés par leur isolement à une telle distance de la côte (environ 260 kilomètres), ils ont abandonné le chantier. Quoi qu’il en soit, à l’annonce de ma venue, les employés concernés ont redoublé de zèle. Ils ont fait défricher les broussailles où les matériaux étaient cachés, ont rangé les pièces et ont commencé les travaux d’assemblage. L’Ouemé est en ce moment presque à sec, mais pendant la saison des pluies l’eau monte de plus de dix mètres. Les piliers du pont ont été solidement construits. […] L’endroit est très pittoresque ; la rivière ressemble à un torrent, elle coule au milieu de nombreux rochers, son cours est sinueux entre les rochers, et les rives sont très raides. Les Africains (hamacaires etc.) profitent de l’occasion pour se baigner dans le fleuve. La chaleur est vraiment accablante. »115
Le ministre poursuit en disant que s’il n’était pas allé à Aguagon, le pont « aurait dormi éternellement sous les broussailles ». Comme nous l’avons déjà dit, le gouverneur général William Merlaud-Ponty, qui accompagnait alors le ministre, retourna sur les lieux des mois plus tard pour inaugurer le pont sur la rivière Ouemé (Figures 79 et 80). De retour à Aguagon, selon son journal de terrain, le ministre y trouve « un grand nombre d’indigènes avec leurs inévitables tam-tams ».116 Le territoire mahi est une zone montagneuse où des groupes autochtones du plateau d’Abomey, comme les Fons et les Guedevis, se sont réfugiés lorsqu’ils ont été déplacés par l’arrivée de groupes d’Allada qui allaient fonder le royaume du Dahomey. Dans la région se trouvaient d’autres groupes de l’Est, locuteurs de langues proto-yorubas, tels que les Savès, les Dassas, les Itchas et les Ifés. Au cours des XVIIIe et XIXe siècles, cette région, à la population très hétérogène, fut victime des rafles esclavagistes annuelles du royaume du Dahomey. La région était donc subalterne et pauvre, sa population alternant entre indépendance farouche et soumission aux puissants voisins du Sud. Savalou, par exemple, sous les règnes de Guezo et Glele, était un puissant vassal du Dahomey, et sa dynastie royale, les Gbaguidi, acquit un grand pouvoir dans la région.117 Durant la période coloniale, la région de Savalou est devenue une subdivision du cercle d’Abomey, perpétuant ainsi sa dépendance vis-à-vis de la capitale de l’ancien royaume. Sur le plateau d’Abomey, l’arrivée du chemin de fer stimula l’exportation du maïs et des dérivés du palmier à huile, et favorise la création de nouveaux marchés, comme celui de la ville de Bohicon. Cependant, dans la région du Savalou, en 1908, il n’y avait encore aucun signe d’impact économique résultant de la construction du chemin de fer. La gare d’Aguagon venait d’être inaugurée et, comme le montrent les photos de Fortier, la région vivait encore dans des conditions très précaires par rapport à Abomey.
D’après les légendes des cartes, celles portant les numéros 81 à 85 représentent des personnes originaires de la région de Savalou, peut-être d’Aguagon ou des villages voisins. La Figure 81 montre un groupe avec son chef sous un parapluie importé d’Europe, très différent des parasols locales d’Abomey. À gauche du chef, qui est au centre de l’image avec une canne entre les jambes, se tient une vodunsi, reconnaissable au bracelet porté en haut du bras, à la chevillière de cauris et au chapeau, apparemment fait de paille teinte en rouge. Elle est assise sur un trépied de type kataklɛ̀ (voir aussi Figure 30). Nous ne savons pas si elle fait partie du groupe des Figures 82 à 84. Nos interlocuteurs d’Abomey nous ont indiqué que ce groupe de danse relevait de la famille Sakpata, le panthéon de la terre, très en vogue dans la région de Mahi, mais il est possible que l’événement réunisse des membres de différents temples et voduns. Par exemple, les colliers de cauris et de graines foncées caractéristiques de ces voduns ne sont pas visibles sur les vodúnsis. D’autre part, le fait que les femmes portent des jupes superposées de type vlayá pourrait indiquer un lien avec Sakpata.118
La plupart des danseuses portent des bracelets en haut du bras, certains apparemment avec des cauris, comme l’abakué des Nesuhue (voir la section sur Abomey), mais leur combinaison avec des bracelets d’autres types de perles est un élément différenciateur. Il y a aussi l’utilisation très importante des chapeaux de feutre (gbejè) qui, à Abomey, sont associés aux Nesuhue. En fait, la région de Mahi, comme nous l’avons déjà dit, semble avoir eu un lien fort avec le culte des esprits du fleuve et avec les tohosu. Au centre de la Figure 83, des membres de l’orchestre agitent des hochets faits de calebasses recouvertes d’un filet de perles ou de graines, appelés asogüe (asɔgwe).
L’utilisation de chapeaux en feutre et des hochets fait référence à un mythe d’origine du culte tohosu. L’histoire raconte qu’au temps du roi Tegbesu sont apparues de mystérieuses créatures de petite taille, portant de longs cheveux et de grandes barbes, avec des dents surnuméraires et d’autres difformités, qui causèrent désordre et panique à Abomey.119 Homèvo Abada, un vieil homme malade qui ne pouvait s’enfuir, parla à ces créatures, qui étaient les tohosu (« rois des eaux » ou « rois des fleuves ») et informa le monarque que les intrus ne cesseraient de terroriser la population qu’à condition de partager le pouvoir avec lui et de recevoir des sacrifices et des dons d’huile de palme, de tissus et de chapeaux de feutre (gbejè). Tegbesú finit par accepter, mais avant que les tohosu s’éloignent définitivement, il fallut les « retirer des eaux » et les « enfermer dans des jarres »(é sú zèn nú yĕ), sur lesquelles on construisit des autels. Homèvo Abada devint le premier prêtre des tohosu, car il reçut d’eux la connaissance relative aux feuilles et au sistre, ce qui lui permit de communiquer avec eux.120 La place centrale du sistre et des chapeaux de feutre dans le mythe permet de supposer que certains des danseurs de cette séquence d’images étaient des voduns tohosu.
Milliès-Lacroix fait peu de commentaires sur les danses qu’il voit dans la région de Savalou, mais, comme le rapporte son journal, il est impressionné par la présence d’un homme masqué juché sur des échasses (Figure 85) :
« […] Le tam-tam d’Aguagon nous a réservé une surprise. Soudain, un homme monté sur des échasses géantes est apparu sous mes yeux. C’est un griot [un conteur des peuples mandé], qui a inventé ce nouveau procédé pour s’imposer aux indigènes. J’imagine que l’homme a dû participer à une exposition en France, d’où il a importé ce mode de locomotion observé chez un paysan des Landes ou de la Gironde, qui devait aussi figurer dans cette exposition. »121
Cet extrait du rapport souligne l’ethnocentrisme du ministre, non pas tant par la référence aux Landes et à la Gironde (dont il est originaire et où les paysans utilisent traditionnellement des échasses pour parcourir les terrains marécageux) mais par le fait de penser que tout ce qui est ingénieux ou intéressant chez eux (les Africains) doit avoir été copié de chez nous (les Européens).122 Or les personnages masqués qui marchent sur des échasses (généralement des tiges de bambou) ne le font pas nécessairement par imitation des coutumes européennes ; c’est aussi une pratique locale traditionnelle. Dans le fongbé, ces personnages masqués sont appelés aglèlé ou gagamiglèlè. La délégation revint d’Aguagon à Cotonou en train. À la gare de Bohicon, le ministre eut une brève discussion avec les administrateurs Dreyfus et Le Hérissé, entourés de chefs autochtones et d’une grande foule. Ils arrivèrent à Cotonou à 22 heures le même jour, le 6 mai 1908.
Allada
Les royaumes d’Allada, du Dahomey et de Porto-Novo revendiquent une origine commune : tous leurs fondateurs descendraient des Adjas immigrés du Tado, plus à l’ouest, dans l’actuel Togo. Selon la tradition, le premier roi d’Allada, Adjahuto (Ajáhùtɔ́), avait fui le Tado après un grave conflit familial. Il aurait emporté avec lui les objets sacrés de la dynastie locale : le crâne de son père, les deux épées appelées gubasa (gŭbasá), le trône royal taillé dans le bois, ou hundja (un siège sur lequel, désormais, les prêtres d’Adjahuto seraient consacrés), la statue d’Agassu et, enfin, ses deux lances, akplo (akplă), dont il ne se séparait jamais. Le fils et successeur d’Adjahuto institua un culte en l’honneur de son père, dont il fut le premier prêtre.123 Au fil du temps, d’autres différends provoquèrent de nouveaux schismes dans la famille royale, aboutissant à la fondation des royaumes du Dahomey et, plus tard, de Porto-Novo.124 La possession des objets sacrés apportés du Tado, d’une grande valeur symbolique, garantissait la prééminence religieuse du royaume d’Allada sur ses voisins, même lorsque son pouvoir politique déclina.
Jusqu’à l’avènement du royaume du Dahomey au début du XVIIIe siècle, Allada était le plus vaste et le plus puissant des royaumes de la Costa da Mina avec lesquels les Européens étaient en contact. Au XVe siècle, les Portugais lui achetaient déjà des captifs. Les premiers interprètes entre Africains et Européens furent les Portugais et, en 1670, le roi d’Allada lui-même parlait portugais, car il avait été éduqué dans un couvent de l’île de São Tomé.125 En 1724, le royaume d’Allada fut conquis par Agaja, souverain du Dahomey, avec de profondes destructions. En 1730, quand Agaja vint s’installer à Allada, il n’occupa pas le palais de la dynastie déposée, situé à Togudo, mais se construisit une nouvelle ville, à trois kilomètres, aussi appelée Allada. Avec la mort d’Agaja en 1740 et l’arrivée de Tegbesú au pouvoir, le culte du fondateur ancestral d’Allada, Adjahuto, fut restauré. La plus grande autorité locale devint l’adjahutonon (ajáhùtɔ́nɔ̀) ou prêtre d’Adjahuto, qui n’avait aucun pouvoir politique, mais seulement un pouvoir religieux. La fonction principale de l’adjahutonon était de consacrer les rois du Dahomey lorsqu’ils montaient sur le trône.126 La succession de l’adjahutonon n’était pas seulement héréditaire, elle dépendait aussi de l’approbation du roi du Dahomey pendant la période où Allada l’avait soumise. En 1891, pendant les guerres de conquête coloniale, le roi du Dahomey Béhanzin se rendit à Allada pour choisir un nouvel adjahutonon. Il choisit Houngnon Ganhou, le futur roi Gi-Gla.127
Comme nous l’avons vu dans la première partie, en 1894, peu après la chute d’Abomey, le royaume du Dahomey fut divisé et dans sa partie sud le royaume d’Allada fut recréé. L’adjahutonon de l’époque fut reconnu « roi » d’Allada sous le nom de Gi-Gla, forme altérée de Vidé égla. Luc Garcia explique que lorsqu’il fut proclamé roi, Houngnon prononça la sentence rituelle dont on tira son nom fort : Vidé égla non kpongbé non maho. « Les premiers mots, Vidé égla (« Un enfant courageux »), auraient dû définir l’appellation du souverain si, par une grossière étourderie, l’administrateur d’Albèca n’avait transcrit Gigla, nom qui ne signifie strictement rien en langue fon ».128 Gi-Gla essaya de créer une structure politique et devint plus un souverain laïc qu’un chef religieux. Il reconstruisit le palais dans l’ancienne capitale, Togudo, et nomma plusieurs ministres. Traditionnellement, le roi d’Allada ne pouvait sortir de Togudo car il lui était interdit de traverser la rivière Autè. Gi-Gla réforma la coutume : pour se rendre à la ville d’Allada, il fit des offrandes à la rivière, lui demandant le droit de passage, et se couvrit le visage en la traversant.129 En tant que roi, Gi-Gla devait se montrer en public, ce qui était également interdit à l’adjahutonon. La question fut résolue par la désignation d’un autre adjahutonon.130
Gi-Gla a été photographié par Fortier en 1908, dans la ville d’Allada. Sur la Figure 86, il apparaît en gros plan, au premier rang, avec le ministre Milliès-Lacroix à sa droite. La scène s’est probablement déroulée à la gare, à l’arrivée du ministre. Le chapeau de Gi-Gla se remarque bien sur le cliché. Comme nous le verrons, d’autres souverains dahoméens portaient aussi des chapeaux d’origine européenne ornés. Le chapeau de Gi-Gla semble être une élaboration africaine sur des éléments européens. Des pointes du chapeau pendent des sortes d’embrasses de rideau, et, à l’avant, des franges. La structure ressemble à un bicorne du Second Empire français. En 1903, le député René Le Hérissé était à Allada et a décrit la robe de Gi-Gla, qui ne portait pas le même chapeau à l’époque :
« Le roi Gi-Gla […] est un homme noir d’une cinquantaine d’années, au regard ouvert et intelligent, qui porte une étoffe de soie à rayures multicolores (…) et tient une canne à manche en ivoire. Derrière Gi-Gla, deux noirs solennels, dont l’un est le porteur d’un parasol et l’autre le porteur de crachoir, suivent leur maître à deux pas ; puis viennent les ministres, l’orchestre royal, composé de tambours, de cymbales et de trompes en ivoire, et derrière cet état-major, deux à trois cents personnes qui crient, ululent, tirent en l’air, et font un concert de tambours (…) qui va durer jusqu’à l’arrivée à Allada […]. »131
En 1908, sur la Figure 86, sous l’étoffe de soie rayée, Gi-Gla porte une tunique brodée au niveau de la poitrine et des manches. Comme les officiers français à sa droite, il arbore des médailles sur la gauche de la poitrine. Sur la Figure 87, la prise de vue de Fortier est différente, et nous voyons le roi d’Allada, ses sujets et l’entourage français dans une vue panoramique, avec les Européens regardant la caméra en prenant la pose.
Au centre on voit l’immense parasol en cotonnade, décorée d’éléments appliqués portant l’insigne royal. La figure d’un lion se détache, alternant avec celle d’un oiseau tenant un objet dans son bec. Le lion est un emblème bien connu du roi dahoméen Glele, qui, dans ses guerres contre le pays mahi, se serait comparé au « lion montrant sa proie et semant la terreur », et lui aurait pris un de ses surnoms royaux, Kinikini, le lion des lions. L’image de l’oiseau est plus difficile à interpréter. Motif récurrent dans l’iconographie dahoméenne, il a de multiples formes et de multiples significations. Tenir quelque chose dans son bec pourrait le relier à Alantán Agbogbo, un oiseau fabuleux d’une grande puissance destructrice, également associé au roi Glele, connu pour « posséder un bec d’une force extraordinaire, capable de tout capturer ». Cependant, sur les bas-reliefs du palais d’Abomey, la victime dans son bec a un corps humain, ce qui ne correspond pas à l’image de du parasol. D’autre part, il y a parmi les « fétiches du roi » conservés au musée d’Abomey quatre sculptures d’oiseaux soutenaient la figure du vodun suprême Mawu. Deux d’entre eux tiennent dans leur bec un autre oiseau plus petit, en une symbolique de conquête et de pouvoir ; les deux autres, de petits objets cylindriques, comme sur le parasol. Jacques Lombard et Paul Mercier, chercheurs à l’IFAN et auteurs, en 1959, d’un guide du Musée d’Abomey, ont identifié ces dernières statues comme représentations du calao, autre symbole du roi Glele.132 En tout cas, nous serions devant un parasol emblématique de ce monarque.
Comme les bas-reliefs sur les murs des palais royaux d’Abomey, les figures colorées appliquées aux parasols avaient pour fonction de raconter l’Histoire par des représentations symboliques. Faisant l’éloge de la généalogie et des actes des rois et des dignitaires, les dessins appliqués étaient la transcription plastique des traditions orales. L’héraldique africaine, invoquant le roi Glele, dans le cadre de cette visite à Allada, est énigmatique, et peut-être recèle-t-elle, dans un code incompréhensible pour les Français, une justification de l’autorité dahoméenne devant les envahisseurs. L’attention est aussi attirée par un parasol plus petit de style européen, mais avec un fond clair et décoré d’éléments colorés. C’était peut-être un parasol personnelle de Gi-Gla, car elle le couvre sur toutes les images. Dans la Figure 88, ce parasol est exactement sous le grand parasol de Glele. Est-ce une symbolisation de vassalité, ou une simple coïncidence ? Nous ne savons pas comment Gi-Gla a été subordonné à la lignée du roi Béhanzin, fils de Glele, vaincu et exilé, mais l’image du petit parasol européen de Gi-Gla sous le grand parasol de Glele est assez expressive. L’autre grand parasol en tissu foncé appartient probablement aux ministres de Gi-Gla. Le personnage à côté du roi (Figure 87) qui a des colliers au cou, une étoffe foncée sur le bras et une casquette à la main pourrait être l’un d’eux. Sur la Figure 88, le roi est au centre des Européens alignés. Sur ce cliché, on voit plus en détail ses sandales, semblables à celles portées par les rois du Dahomey. À côté de Gi-Gla, on voit toujours un jeune serviteur tenant dans une main une étoffe et un récipient qui pourrait être un crachoir, et dans l’autre, la canne du roi à pommeau métallique. L’utilisation de cannes par les autorités européennes est également étrange ; le ministre lui-même en tient une, apparemment de fabrication locale. Au sol, à gauche, on remarque un segment de voie ferrée.
La Figure 89, tirée de l’album offert par Fortier au ministre, n’a pas été publiée sous forme de carte postale. On y voit Gi-Gla devant son entourage et flanqué des Européens. Ils marchent au milieu des pistes en route vers la Résidence d’Allada. À droite, on peut voir que les dignitaires de Gi-Gla (identifiables aux accessoires qu’ils portent) marchent pieds nus, puisque traditionnellement seul le roi pouvait porter des sandales.
Sur la Figure 90, déjà dans la Résidence française, on remarque, à droite, le parasol de Gi-Gla. En 1903, René Le Hérissé écrit à propos du trajet qu’il a parcouru à pied avec Gi-Gla : « Les indigènes, hommes, femmes et enfants, accourent pour voir passer le défilé. On a ouvert le grand parasol royale en tissu blanc brodé de chimères noires et rouges ; l’orchestre double le tempo, les cornes font entendre de véritables rugissements, le canon tonne, les tirs en l’air retentissent de tous côtés, et nous arrivons au siège de l’administration française ».133 L’architecture de la Résidence d’Allada a suivi la même idée que pour les autres de la région : un balcon au sommet permet aux Européens de voir d’en haut les groupes d’Africains qui visitaient le lieu.
Sakété
Le petit royaume de Sakété (Itakété), situé à l’est du fleuve Ouemé, à trente kilomètres au nord de Porto-Novo, de population majoritairement nagot, était l’un des royaumes yorubas de l’Ouest (tels que Pobé, Holi, Ketu, Savè et Dassa) séparés de ceux de l’Est par la frontière coloniale franco-britannique. L’histoire de Sakété est peu connue. On pense qu’elle a été fondée au XVIe siècle, avant la migration d’autres groupes nagots du royaume d’Oyo, qui, au siècle suivant, se sont installés plus au sud et ont formé les villes de Takon (Itakon) et Ifanhim. Dès le début du XIXe siècle, avec la chute d’Oyo provoquée par le djihad lancé par les fulanis (peuls) de Sokoto, ces petits royaumes nagots, comme celui de Sakété, sont passés sous l’influence politique de Porto-Novo, un royaume cosmopolite enrichi par la traite atlantique. De façon générale, Porto-Novo n’exerça qu’une souveraineté nominale, sans autorité concrète.134 Cependant, invoquer sa protection, y compris adopter les scarifications de ses princes, était une manière pour Sakété de se défendre contre les attaques des Dahoméens, comme celles de la décennie 1830.135 La région de Sakété était riche en palmiers, produisant beaucoup d’huile et de noix de palme. Comme elle se situait à l’extrémité de la route commerciale qui venait de Parakou, au nord, et se terminait à Badagri, sur la côte, une grande partie de cette marchandise allait vers des territoires contrôlés par les Britanniques, notamment vers Lagos. En modifiant cette dynamique, les colonisateurs français tentèrent de rediriger le commerce de l’Est du Dahomey vers le port de Cotonou en passant par Porto-Novo. À cet effet, entre 1904 et 1908, ils construisirent une deuxième voie ferrée entre Sakété et Porto-Novo, longue de 37 kilomètres, avec un écartement de voie plus étroit que celui de la ligne principale qui desservait le nord de la colonie.136 C’est dans ce train, dit tramway, que le ministre et son entourage se rendent à Saketé dans l’après-midi du 4 mai 1908, après une visite à Porto-Novo, où ils étaient arrivés le matin depuis Cotonou. L’expédition ne passe que quelques heures à Sakété, retournant la nuit même à Cotonou.137 La fertilité de la région a impressionné le ministre Milliès-Lacroix, qui l’a inscrite dans son journal : « (…) merveilleux voyage dans un véritable jardin. Admirables plantations de maïs, d’arachides, etc. Des bananiers au milieu de beaux palmiers. Cette région est riche. Les haies vives des plantations indiquent des propriétés bien divisées et bien délimitées, des pâturages verdoyants, de nombreux bovins, des bœufs, des moutons, une population intelligente et laborieuse. Tout cela dégage une impression de prospérité. »138


Odekoulé, roi de Sakété, a été photographié par Fortier en 1909. Dans la série de cartes postales du voyage du ministre en 1908, il en existe une qui peut être située à Sakété, bien que la légende ne mentionne pas la ville (voir Figure 91).139 Nous voyons au centre de cette image un personnage vêtu d’un couvre-chef qui cache son visage. C’est une couronne yoruba (adé), un objet investi d’une valeur spirituelle, politique et esthétique. Emblème du roi Odudua (Odùduwà), l’ancêtre primitif des royaumes yoruba, l’adé « incarne l’institution de la force ancestrale du roi ». Une frange de perles recouvre, telle un rideau, le visage du porteur, car on croit que le roi (oba), sacralisé, ne doit pas être exposé à la vue du peuple. Les adélà, ou grandes couronnes, ont une partie supérieure conique ornée de motifs géométriques et allégoriques, souvent en forme d’oiseaux, faits de perles. L’historien Robert F. Thompson écrit que « cacher [le visage] diminue l’individualité du porteur, de sorte qu’il devient aussi une entité générique. » En ce sens, le masque, ou adé, « combine la double présence du roi et de l’ancêtre, ce monde et l’autre », le présent et le passé, constituant l’incarnation de la dynastie.140 Dans le cas de Sakété, il est probable que le porteur de l’adé était non le roi mais une « doublure » chargée d’assumer cette fonction politique et religieuse.
Manifestation de la force ancestrale, le personnage à l’adé représenté par Fortier dans la Figure 91, vêtu d’un grand boubou brodé et les pieds chaussés ou couverts, a une certaine similitude avec les masques egunguns, manifestations des esprits des ancêtres yorubas. Il tient dans ses mains une étoffe et un sceptre en bois orné de perles. À côté de lui se trouve un autre homme, peut-être le prêtre, pieds nus et portant un boubou en trois éléments et un grand chapeau yoruba. Sur cette photo, nous n’avons pas pu identifier Odekoulé. Cependant, il est mentionné dans la légende d’une carte de la série de 1909. Dans l’image, il est entouré de ses sujets et on reconnaît le même personnage masqué portant l’adé (voir Figure 92).
Odekoulé, bien qu’intronisé lui aussi à l’initiative des Français (contrairement à Adjiki, chef de Porto-Novo, et à Gi-Gla, roi d’Allada) n’était pas soumis aux colonisateurs, et gouvernait la population de Sakété. C’est peut-être pour cette raison que, lors de sa visite au Dahomey en mars 1909, le gouverneur général William Merlaud-Ponty voulut le rencontrer. Pour mieux comprendre l’importance des scènes que Fortier photographiait à l’époque, il faut remonter au début de la colonisation française dans la région.
La frontière orientale de la colonie du Dahomey, qui la séparait du territoire britannique de Lagos, fut établie par la convention franco-anglaise de juin 1898. Aux termes de cet accord, le royaume yoruba de Sakété, situé dans la zone frontalière, relevait de l’administration française. La situation coloniale sépara arbitrairement des populations, y compris des groupes de même affiliation socioculturelle, ce qui rendait plus difficile la circulation des personnes et des biens entre les deux côtés de la frontière. Après l’établissement d’un poste de douane du côté français, le trafic de marchandises importées, généralement moins chères du côté anglais, fut activement pratiqué par l’élite de Sakété, dont les profits substantiels lui valent un prestige qui compensait d’une certaine manière la perte des privilèges politiques après la conquête.141 La population locale, assujettie à l’impôt de capitation par le gouvernement colonial, estimait légitime ce commerce, alors que les Français le considéraient comme de la contrebande, ce qui rendait la situation très tendue.
Fin février 1905, lors de la cérémonie funéraire en l’honneur d’un notable africain décédé trois mois auparavant, un affrontement coûta la vie au jeune administrateur français de la ville, Henri Caït, et à l’officier des douanes, Léon Cadeau. Le poste administratif colonial avait été construit sur la place du marché de Sakété, lieu des cérémonies funéraires. Irrité par le bruit persistant pendant dans la nuit, Caït envoya deux gardes pour exiger l’arrêt de la cérémonie, ce qui fut refusé. Pendant la confrontation, un soldat perça à la baïonnette le tambour principal (yia ìlù) de l’orchestre, ajoutant à la tension. Les gardes coloniaux, tirèrent en l’air, puis sur les Africains. Il eut de nombreux blessés et deux tués, ce qui attisa le conflit. Des coups de feu tirés depuis la place par des fusils de chasseurs participant à la cérémonie tuèrent Léon Cadeau et blessèrent Henri Caït à la tête. Sa femme et quelques aides tentèrent en vain de le sauver en le plaçant dans un hamac pour l’amener à pied vers Porto-Novo. Le quartier général de l’administration fut pillé et le corps de Cadeau fut écartelé. Prévoyant des représailles des troupes coloniales, la ville fut brûlée et abandonnée par la population, qui se réfugia dans les villages voisins. Le roi de Sakété de l’époque, Abgola Djoyé, craignant des représailles contre sa propre personne, s’exila dans sa ville natale, Ibatefin, du côté britannique de la frontière. Malgré la gravité de la révolte, l’importance économique de Sakété en tant que zone agricole amena l’administration coloniale à décider de privilégier un retour à la normale plutôt que poursuivre et châtier les coupables de la mort des deux Français.142 Peu à peu, les villageois retournèrent sur le site et un nouveau roi, Odekoulé, fut désigné. Au centre de la Figure 92, on voit Odekoulé et sa cour, photographiés par Fortier en mars 1909. À gauche de l’image se trouve le personnage masqué avec la couronne adé, incarnation de la force ancestrale des rois, que nous avons également vue dans la Figure 91. Odekoulé tient dans ses mains un sceptre et porte un costume en tissu européen. Son chapeau a probablement été fourni par les autorités françaises, mais il l’a orné d’un oiseau, symbole récurrent dans les couronnes yorubas. Ce détail met en évidence l’appropriation d’un objet allogène pour lui attribuer des significations locales. À côté de lui se trouve un haut dignitaire, peut-être un ministre, portant également un chapeau décoré, mais avec le traditionnel boubou. Sur la Figure 93, au même endroit, un groupe de femmes chante. Certains, agenouillés, frappent des mains en s’agitant ; d’autres, à droite, manient un asogüe.
Le même jour, Fortier prit un autre cliché, à l’endroit où fut érigé un monument dédié aux Français tués lors du soulèvement de 1905 (Figure 94). Dans la légende de la carte postale, Odekoulé n’est pas mentionné, mais on le reconnaît à droite, ainsi que le dignitaire et le personnage à l’adé, qui a là le visage découvert. À gauche, alignés et armés de fusils, se trouvent plusieurstirailleurs sénégalais, reconnaissables à l’insigne de l’armée coloniale sur le béret. C’est probablement la troupe qui a accompagné le gouverneur général lors de sa visite à la colonie du Dahomey. La même image a été publiée en 1912 dans un livre de Louis Sonolet (voir Figure 95).143 La légende donne plus de détails sur la scène : quatre ans après l’assassinat de l’administrateur français, le gouverneur général William Merlaud-Ponty avait ordonné aux habitants de Sakété, représentés par leurs dirigeants politiques et religieux, une l’amende honorable publique, « rite de réparation » français. Nous ne connaissons pas les intentions de Ponty, et nous ne savons pas si la cérémonie avait un sens pour les Africains. Faire amendehonorable comporte dans l’imaginaire français un aspect d’humiliation, mais en contrepartie garantit la clôture du litige et l’absence de tout geste de revanche.144 Curieusement. le personnage qui porte la couronne, (adé) a relevé son voile facial au moment de la prise du cliché ; nous ne savons pas pourquoi. C’était peut-être un autre exemple de la violence symbolique souvent pratiquée par les Français, imposant une visibilité sacrilège à des personnes qui devaient rester cachées, mais c’était peut-être aussi un geste délibéré des autorités africaines, voulant éliminer temporairement la présence sacrée des ancêtres au moment de la soumission. La scène a évidemment été préparée, et les protagonistes posent.
Pendant son règne sur Sakété, Odekoulé est toujours considéré avec suspicion par les Français. En 1914, avec le déclenchement de la Première Guerre mondiale, il est arrêté pour incitation à la révolte contre la conscription forcée pour combattre contre le Togo, alors colonie allemande.145
Sur la Figure 96, on peut voir le tramway décoré qui a amené le gouverneur général Ponty à Sakété. Juste derrière la locomotive, dans un wagon découvert, voyagent les Africains les plus pauvres, tandis que le dernier, peint en blanc, de première classe, est occupé par l’entourage officiel. Les Figures 97 et 98 montrent le chemin de fer reliant Porto-Novo à Sakété et le paysage autour de la gare.
Porto-Novo
Le royaume de Porto-Novo (Adjatché/Hogbonu), sur les rives de la lagune formée par l’embouchure de l’Ouemé, s’est constituées au XVIIIe siècle, après les migrations qui ont suivi la prise d’Allada par le royaume du Dahomey. Porto-Novo était politiquement faible, mais jouait un rôle important en tant que carrefour culturel, commercial et politique pour la région côtière gbe-yoruba. Les Portugais, qui lui ont donné son nom, furent les premiers Européens à entrer en contact avec le royaume dans la première moitié du XVIIIe siècle. Porto-Novo a participé tardivement à la traite négrière, profitant de l’effritement du royaume d’Oyo.146 Avec le déclin de la traite et la progression de la valeur de l’huile et des noix de palme à l’exportation, elle devint un intermédiaire majeur pour ces produits. Son environnement, inondé de façon saisonnière, était propice à la culture de palmiers à huile. En 1861, les Britanniques occupent l’île de Lagos, aujourd’hui au Nigeria, dans le cadre de leur politique visant à mettre fin à la traite négrière. La même année, ils bombardent Porto-Novo. Subissant la pression des Britanniques, mais désireux de continuer la traite, le roi Dè Sodji recourut à la suzeraineté de la France, qui se concrétise par un traité de commerce et d’amitié, signé en 1863. Mais plus tard la France tenta elle aussi de mettre un terme à la traite négrière, ce qui amena les successeurs de Dè Sodji à rompre les accords. Un fils du roi, le prince Dassi, monta sur le trône de Porto-Novo en 1874, avec le soutien de Glele, roi du Dahomey, qui le sacré sous le nom de Toffa. Ainsi, après le départ des Anglais et des Français, Porto-Novo était protégé par le royaume du Dahomey. Cependant, Toffa se lassa de ce protecteur encombrant et se rapprocha des Français et, en 1882, sollicita de la France un statut de protectorat. Dès lors, le pouvoir fut exercé en pratique par le Résident français, même si Toffa restait nominalement roi.147 En 1890, avec le début des affrontements entre l’armée française et l’armée du Dahomey, Toffa prit le parti des Européens, leur fournissant principalement le soutien logistique nécessaire sous forme d’expéditeurs et de ravitaillement. En 1892, des désaccords et des escarmouches entre les sujets de Toffa et de Béhanzin, roi du Dahomey, sont à l’origine de la campagne militaire française décisive en direction de l’intérieur. Dans les combats contre le roi dahoméen, la collaboration entre les Français et Porto-Novo se renforça. Les troupes commandées par le colonel Dodds, en plus des bataillons de la légion étrangère et des tirailleurs africains, comprenaient également des milliers de porteurs enrôlés de force par Toffa.148 Seize ans après la victoire française sur le Dahomey, lorsque l’entourage du ministre Milliès-Lacroix arriva à Porto-Novo le 4 mai 1908, il ne fut pas reçu par Toffa, décédé en février de cette année, mais par son fils et successeur, Adjiki. Celui-ci avait été porté au pouvoir par les Français peu après la mort de son père, mais comme « grand chef » et non comme roi. Avec la mort de son alliée Toffa, Porto-Novo cessa d’être un protectorat de la France et fut officiellement subordonnée à l’administration de la colonie du Dahomey.149 Les Figures 99 à 101 montrent l’arrivée de Milliès-Lacroix dans la ville, après avoir traversé en bateau les lagunes qui la séparent de Cotonou. Décrivant Porto-Novo au début du XXe siècle, Luc Gnacadja donne les indications suivantes: « La ville comprenait deux secteurs pour le commerce : un secteur lagunaire et un secteur organisé autour du marche traditionnel. La lagune était alors l’unique voie par laquelle transitait tout le trafic, mais ses abords immédiats étaient marécageux et aucune factorerie ne put y être édifiée. Les négociants s’installèrent sur les terres stables avoisinant la berge, hors du lit de la lagune, sur des terrains cédés par le roi ou certains notables .Les différents installations commerciales étaient reliées à la lagune par des chemins sur talus aboutissant à des débarcadères (…). Ces ouvrages étaient propres à chaque compagnie commerciale : on parlait de « ponton CieFAO », « ponton John Holt », etc. ; il y avait à l’ouest de ce port fluvial l’appontement du gouvernement, relié au Palais du gouverneur par une avenue. »150
Dans les Figures 99 et 100, nous voyons des soldats alignés le long d’une jetée qui s’étend devant un hangar, autour duquel se trouve une multitude d’Européens et d’Africains. Elle est couverte d’un toit à deux versants et parée de drapeaux tricolores.
Devant les soldats, debout sur le quai, attendant Milliès-Lacroix, se tiennent des hommes vêtus de blanc à l’européenne. Trois portent des uniformes militaires et des casques coloniaux, et les deux autres sont en costume civil et portent des chapeaux à larges bords. Peut-être s’agit-il d’Agudas (les Portugais, les Brésiliens et les Africains affranchis revenus en Afrique).
Il y avait à Porto-Novo, comme à Ouidah, une importante communauté de commerçants agudas. Dans le troisième quart du XIXe siècle, les Agudas furent d’importants intermédiaires commerciaux entre les Africains et les entreprises françaises. Pendant la conquête coloniale, qui dura de 1890 à 1894, les Agudas de Porto-Novo furent les principaux fournisseurs de l’armée française. Sur le plan financier, cet arrangement s’avéra fatal pour beaucoup d’entre eux, car les militaires n’honorèrent pas les paiements prévus dans les contrats.151 La présence française finit par favoriser les sociétés commerciales européennes, qui commencèrent à contrôler l’activité économique à Porto-Novo, négligeant les Agudas. Bellarmin Coffi Codo le commente ainsi :
« D’intermédiaires autonomes, sous contrat avec les fournisseurs européens, les Afro-brésiliens deviennent vers la fin du XIX siècle le plus souvent de simples employés des maisons de traite ou gérants des boutiques de l’arrière pays. Le développement de l’administration coloniale leur permet par contre de devenir interprètes, commis aux écritures, etc. Perdant ainsi leur pouvoir économique., ils voient leur influence politique se réduire au fur et à mesure de l’installation de l’administration coloniale française. »
Cependant les influences individuelles persisteront : l’exemple le plus achevé d’entre elles est la trajectoire d’Ignace Paraíso. Il parvint habilement à s’imposa comme intermédiaire entre le palais royal et l’autorité coloniale française, devenant membre du Conseil d’Administration de la colonie, le premier Africain à être nommé à un tel poste.152
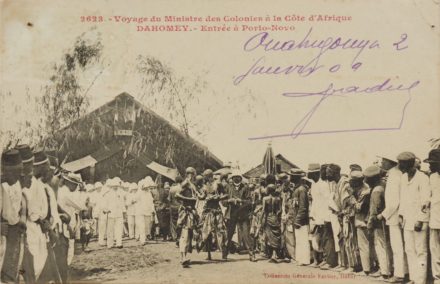
Sur la Figure 101, prise à la sortie du hangar installé sur le quai, on voit un cortège traversant la foule. Certains des hommes représentés, qui regardent sur les côtés et portent des chapeaux de paille de style occidental, étaient probablement agudas. Sur le côté gauche du cortège se trouvent le ministre Milliès-Lacroix, le gouverneur général William Merlaud-Ponty et d’autres officiers ; sur le côté droit se trouve la cour d’Adjiki, chef de Porto-Novo. Le ministre en a pris note dans son journal :
« Nous sommes arrivés à Porto-Novo, où nous avons été accueillis sur le quai par les fonctionnaires locaux, les marchands et les chefs, parmi lesquels Adjiki, le successeur du roi Toffa, vêtu d’un grand manteau brodé d’or, un pantalon à galons dorés, et portant un bicorne doré surmonté de plumes et des chaussons en tissu brodé. Il est entouré de ses ministres, torse nu (…) ; ils sont précédés de trompes (d’argent) produisant des sons stridents. Nous avons visité les bâtiments commerciaux chargées de filets. Très bonne impression. Importance et prospérité du commerce. De nombreuses plaintes concernant le service de transport vers Cotonou, via la lagune de Porto-Novo, qui est, pour ainsi dire, inexistant. Certains commerçants font leur propre transport en canot, ce qui stimule l’exportation vers Lagos (la moitié). Principal commerce des entreprises : à l’exportation, huile de palme et maïs ; à l’importation, sel, riz, tabac, tissus, abats, conserves alimentaires, fruits et poudre. Peu de tissus français (…) nous pourrions faire mieux. »153

Adjiki

Le siège du gouvernement à Porto-Novo (Figure 103) était une grande construction en maçonnerie avec des structures en fer, entourée de balcons protégés par des volets et flanquée de part et d’autre de pavillons carrés de style grec à de colonnes en ciment : l’un abritait la Cour de justice, et l’autre la salle de réunion du Conseil d’Administration de la colonie.154
Sur la Figure 104, on voit le cortège du ministre entrant dans les jardins du siège du gouvernement. Pour l’occasion, la place est ornée de drapeaux tricolores. Sur le côté gauche, dans le public, on remarque plusieurs noirs habillés à l’européenne, peut-être des Agudas. Fortier photographie cette scène du haut de l’escalier situé à l’entrée du bâtiment. Au centre de la Figure 105, prise du rez-de-chaussée, on voit cinq Européennes vêtues de blanc et portant des parasols, entre les colonnes du balcon d’un des pavillons latéraux. La Figure 106, prise du même endroit, montre le même groupe à gauche, au pied de l’escalier qui donnait accès au siège de l’administration coloniale. Debout, une main à la taille et portant l’uniforme de l’Académie française et le bicorne emplumé, se tient Adjiki, grand chef de Porto-Novo, impassible. A ses côtés, un porte-parole parle en faisant de grands gestes. D’autres ministres, torse nu comme le prescrit l’étiquette de la cour, entourent Adjiki. En bas de l’image, on voit un immense drapeau tricolore recouvrant l’escalier. Adjiki a hérité de tout le faste royal, mais son pouvoir est bien moindre que celui de Toffa, son père. Le titre de roi, utilisé par Fortier dans la légende de la carte postale, ne correspondait pas à son statut officiel : après la mort de Toffa, les Français ont décidé d’interrompre la monarchie de Porto-Novo. Le rôle d’Adjiki n’était désormais que protocolaire.155 L’une des raisons de la visite du ministre à Porto-Novo, outre l’attribution de médailles à certaines autorités locales, comme il l’a également fait à Allada et Abomey, était d’établir Adjiki dans son nouveau poste ; mais le ministre exigeait qu’Adjiki lui demande d’abord « pardon au nom de son frère qui avait été emprisonné après les dernières émeutes ». Nous ne savons pas en quoi avaient consisté quel était ces désordres ni quelles étaient les accusations contre le frère d’Ajiki, mais la condition imposée par le ministre est révélatrice des relations de pouvoir colonial derrière la pompe et la dignité de cet événement officiel. Avec la confirmation de son investiture, Adjiki « manifesta sa satisfaction, et ses ministres poussèrent de grands cris de joie : il avait sauvé sa peau ».156
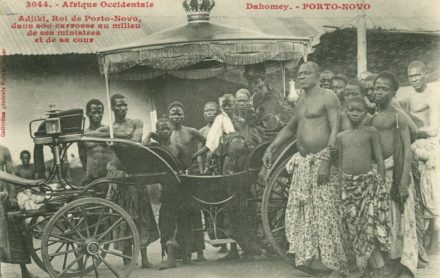
Sur les Figures 107 à 109, nous voyons des portraits d’Adjiki réalisés en 1909, lors du voyage où Fortier accompagnait le gouverneur général William Merlaud-Ponty au Dahomey. L’endroit semble être à l’extérieur de la résidence du grand chef de Porto-Novo. Sur la Figure 107, il s’appuie sur un canapé, entouré de sa cour, apparemment en train de fumer, et, comme dans l’images précédente et la suivante, il tient dans sa main droite une canne et un foulard, dans une attitude de distinction de l’aristocratie dahoméenne également observé chez certains des voduns Nesuhue (voir Figures 58 et 59). Les ministres sont debout, leur importance se reflétant dans leur proximité par rapport au roi. Neuf jeunes gens sont assis par terre, dont trois portent des attributs royaux : le chasse-mouches, la tabatière et le crachoir. Sur la Figure 108, Adjiki est debout, et on remarque qu’il porte des chaussures brodées, alors que les ministres sont pieds nus. L’un d’eux tient le parasol royale. Sur la Figure 109, on voit Adjiki à l’intérieur d’un carrosse en forme de landau, offert par les Français à son père Toffa mais servant davantage d’objet de prestige que de moyen de transport.157
Le marché de Porto-Novo
Prise en 1909, la série de photographies documentant les femmes du marché de Porto-Novo est l’une des plus intéressantes de Fortier. Les marchés occupent beaucoup d’espace en Afrique de l’Ouest. Les activités sont réparties entre hommes et femmes : les hommes vendent des animaux vivants et de la viande, des sacs de céréales, des outils, des tissus importés, etc. et les femmes, des fruits, des légumes, des racines et des denrées similaires. En général, les activités masculines brassent plus d’argent et exigent un capital initial. Les activités féminines sont souvent de petite envergure, ne brassant que peu d’argent et directement accessibles à toutes. Fortier ne documente que la partie féminine du marché, à l’extérieur, alors que les magasins pour hommes sont dans des constructions maçonnées.

Sur la Figure 110, nous voyons des femmes et des enfants assis sur l’escalier qui donnait accès aux magasins des hommes. Dans le coin supérieur gauche, soutenu par quatre tiges de bambou, des nattes servent d’auvents devant deux portes. Les hommes et leurs marchandises coûteuses étaient protégés des intempéries et du soleil ; les femmes, avec leurs paniers et leurs nattes, restaient dehors. Fortier circule dans différents secteurs du marché extérieur, et ses images nous donnent une idée de l’économie domestique de Porto-Novo en 1909. Il est difficile d’identifier toutes les marchandises en vente, mais tentons d’en énumérer quelques-unes. Sur la Figure 110, une femme a sur la tête des objets emballés dans du papier. Bougies ? Boîtes d’allumettes ? À droite, on voit, un peu flous, des piles de fruits, apparemment des noix de cola, et au centre des bottes de légumes.
Sur la Figure 111, sur les marches menant au secteur des hommes, on voit des tiges de canne à sucre. Une jeune femme vend des portions de farine ou de noix de coco râpée. De nombreuses femmes se tiennent sur une place pour vendre leurs marchandises. Des couvercles et des tamis posés sur des paniers empilés font office de tables. La photographie 112 a été prise au même endroit : Fortier a fait quelques pas et dirigé son appareil vers le vendeur de rouleaux de canne à sucre, à qui il a peut-être demandé de rester de profil et de faire le geste d’en saisir. À gauche, on voit une vendeuse de « beignets » (en fait un nom générique de divers types de gâteaux et de galettes frites qui nourrissent les gens qui travaillent dans la rue), des boîtes d’allumettes empilées dans un des paniers, ainsi que des oignons, des patates douces, du manioc, des ignames et peut-être du gingembre. Sur la Figure 113, Fortier a encore avancé de quelques pas en direction des tiges de bambou du bas de l’image précédente. On ne peut dire avec certitude ce que contiennent les paniers, mais la présence de jarres sur la droite indique qu’on est dans un autre coin du marché.
La Figure 114 présente sur la droite toute une variété d’objets en céramique, à usage domestique ou rituel : vasques, poêles, assiettes et pots de différentes tailles. Comme l’explique Marie Mattera Corneloup :
Qu’elle soit à usage domestique ou cultuel, la poterie au Dahomey est affaire de femme, de l’approvisionnement en argile à la cuisson des pots et à la vente. La réalisation des pièces rituelles est réservée à celles qui, parmi les potières, sont initiées, car elle exige de connaître les ornementations symboliques appropriées au culte, tandis que la fabrication des pots utilitaires ne nécessite que la transmission d’un savoir faire de mère en fille.158
La Figure 115 montre la prédominance des grandes pièces de céramique : jarre à ouverture étroite et récipients à couvercle. En bas de l’image, les hommes échangent des chèvres et des moutons.
Sur les Figures 116 et 117, dans une autre partie du marché, on voit une caisse de l’entreprise John Holt & Co, de Liverpool, sur laquelle sont exposés, apparemment, des savons. Cette société avait à l’époque un statut équivalent celui d’une SARL et était dirigée par deux frères nés en Angleterre émigrés à Lagos. Elle est toujours en activité au Nigeria. Au début du XXe siècle, John Holt & Co. exportait de l’huile et des noix de palme africaine, importait des biens de consommation européens et exploitait une flotte de bateaux qui transportaient marchandises et passagers sur les lagunes parallèles à la côte entre Lagos et les ports du Dahomey.159 Sur ces deux images, on reconnaît parmi les produits en vente des ignames et peut-être du manioc et des épis de maïs. Sur la Figure 117, une femme âgée fabrique un objet en paille. Une autre porte un bébé sur son dos.
Dans la Figure 118, peut-être à un endroit proche des précédents, nous voyons un groupe d’enfants. L’un d’eux a un crucifix au cou et porte des bracelets métalliques. Derrière les enfants se trouvent des paniers contenant de petits fruits ronds. Dans la Figure 119, prise au même endroit, une vendeuse vue de face travaille avec concentration, un couteau à la main. Devant elle, par terre, une bassine contient apparemment une tresse de raphia, peut-être destinées à un usage rituel. Sur la gauche de l’image, on voit : une petite caisse sur laquelle des rangs de perles de verroterie sont exposés dans un bocal ; au-dessus, des abats dans un panier ; de nombreuses boîtes de conserve usagées de différentes tailles empilées sur le couvercle d’un panier, probablement vendues comme récipients. La dernière image de cette série (Figure 120) montre une scène inhabituelle d’interaction entre le photographe et des Africains qui semblent faire des commentaires moqueurs à son sujet. Par terre on voit des tubercules et, sur la droite, des racines ressemblant à du vétiver.
Entre Porto-Novo et Cotonou
La géographie du Sud de la République du Bénin est marquée par la présence de grands lacs et lagunes parallèles à la côte atlantique. Ce système lagunaire résulte de deux phénomènes complémentaires : d’une part, les courants marins du Golfe de Guinée, qui se déplacent vers l’est à partir des fonds marins et apporte continuellement du sable sur la côte ; d’autre part, l’écoulement des rivières de l’arrière-pays qui charrient des masses énormes d’alluvions à la rencontre du sable. Trois rivières se jettent dans les lagunes : le Mono, le Couffo (Kufó) et l’Ouemé (Wĕmɛ̀). Leur cours inférieur traverse une zone très peu pentue, sujettes aux inondations. À la fin de l’été, une grande partie de la région est inondée. La rencontre du sable et de l’eau de mer avec la matière organique des inondations a créé un sol très fertile, propice à la culture de palmiers à huile.160 Jusqu’à l’aménagement de voies ferrées et de pistes carrossables, les principales voies de transport de marchandises dans le sud du Bénin étaient les lagunes et les fleuves. Au début du XXe siècle, la voie est-ouest le long des lagunes était la plus fréquentée. Poissons et céréales, fruits, et divers produits manufacturés locaux et importés étaient transportés d’un côté à l’autre des lagunes, selon les fluctuations du marché. Une importante flotte de pirogues circulait entre les villes de Porto-Novo et de Cotonou, transportant le fret d’un commerce qui s’est développé avec la mise en place de l’administration française.161 Chaque village lacustre avait sa propre zone de pêche. Les femmes de ces villages séchaient et fumaient le poisson, utilisant le sel des rives de la lagune et le bois de chauffage venant de l’intérieur des terres. Le poisson séché allait sur les marchés voisins, et le poisson fumé vers des endroits plus éloignés. Les grandes pirogues servaient à acheminer les produits jusqu’au marché, et les piroguiers assuraient également le service de transport de toute la population des lagunes, en poussant l’embarcation à l’aide de perches, ou des rames là où l’eau était assez profonde.
En 1908 et 1909, Fortier, avec les délégations officielles, traverse les lagunes à bord d’un vapeur à faible tirant d’eau (Figure 122), et, d’en haut, photographie les grandes pirogues. La route entre Porto-Novo et Lagos, plus à l’est, permettait la navigation à vapeur avec un plus grand tirant d’eau. Comme nous l’avons vu, le commerce de Porto-Novo se faisait principalement avec Lagos, ville dotée d’un bon port maritime et situé en territoire britannique. Les administrateurs coloniaux s’efforçaient de transférer les relations commerciales de Porto-Novo à Cotonou. Un service de transport entre les deux villes utilisait des péniches à coque métallique comme celle de la Figure 122, tant pour le fret que pour les passagers. Comme indiqué dans la section sur Porto-Novo, les commerçants européens se sont plaints, jugeant le service insuffisant car ils restaient largement tributaires des propriétaires de pirogues.
Sur la Figure 123, on voit un canot à propulsion mixte (voile et perches). De fait, les lagunes entre Porto-Novo et Cotonou sont peu profondes, ce qui rend difficile l’utilisation de rames. L’homme qui manipule la perche se tient à l’arrière du canot. Cinq passagers sont assis au milieu des marchandises : sacs (de céréales ?), paniers, caisses et nattes. À la surface de la lagune, on remarque des points de végétation aquatique. Sur la Figure 124, nous voyons deux canots alignés et, à droite, les silhouettes de deux piroguiers munis de perches. L’une des pirogues transporte une barrique et une sorte de grande jarre crépie. La Figure 126 montre une pirogue plus rustique et plus petite, dépourvue d’ornements, menée par deux hommes munis de rames courtes aux pales arrondies.
Peu d’études ont été consacrées à l’organisation et à l’ampleur du commerce et du transport en canot dans le sud du Bénin à l’époque coloniale. Ceci est en partie compensé par les efforts de l’historien Patrick Manning qui, dans un article paru en 1985, a recueilli des informations pertinentes sur cet important secteur de l’économie locale.162 Dans son texte, il compare les conditions de travail des portefaix qui transportaient des charges sur leur tête (et au sujet desquels il existe davantage de données) avec l’activité des piroguiers. Les premiers étaient généralement des agriculteurs employés comme porteurs à temps partiel pendant la basse saison ou lorsqu’ils y étaient forcés par les administrateurs coloniaux. Les piroguiers, en revanche, étaient spécialisés, travaillaient en groupe ou en lien avec des corporations, et étaient assez souvent des salariés.163
Les bateliers professionnels étaient majoritairement des membres des populations gen, originaires des lagunes de la colonie voisine du Togo. Ils pouvaient être des Hula de Grand Popo et Ketonou, des Toris de la lagune de Porto-Novo ou des Yorubas des berges comme les Ijebus.164 Un court passage du livre L’Agriculture au Dahomey, écrit en 1906 par Norbert Savariau, décrit le transport lagunaire entre Porto-Novo et Cotonou au début du XXe siècle :
Dans tous les endroits importants le long des rives des lagunes ou des rivières, il y a de véritables sociétés de piroguiers qui ont chacune leur propre chef, à qui les personnes intéressées peuvent s’adresser pour obtenir les canots dont elles ont besoin. Le prix du transport est toujours fixé à l’avance, c’est-à-dire qu’il favorise ceux qui savent le mieux négocier.165
Manning estime que la plupart des piroguiers étaient salariés. D’autres types de relations de travail entre les propriétaires des pirogues et ceux qui les exploitaient existaient aussi : il y avait des esclaves, et même des jeunes gens de la famille des propriétaires, mal payés mais qui pouvaient monter dans la hiérarchie.166 Des petites pirogues creusées dans des troncs d’arbres (Figure 126) étaient construites localement. Les plus grandes, qui parcouraient de plus longues distances, étaient achetées à Lagos.167
En termes d’efficacité, le canotage était deux fois plus rapide que l’utilisation de portefaix. De plus, les grosses cargaisons pouvaient être transportées par moins de personnes : ainsi le prix à la tonne transportée procurait un profit considérable pour le propriétaire du canot et une rémunération raisonnable pour les bateliers, qui gagnaient environ trois fois le salaire journalier des portefaix. Manning estime qu’avant la construction de la route reliant Porto-Novo à Cotonou, inaugurée en 1930, environ 1 000 bateliers assuraient la liaison, en six heures en moyenne.168

La tradition veut que les premiers villages lacustres du Sud du Bénin aient été formés à partir du XVIIIe siècle, construits par des gens fuyant l’expansion guerrière du royaume du Dahomey. Selon Georges Bourgoignie, cette origine, ancrée dans l’insoumission et l’indépendance, expliquerait la société égalitaire, sans pouvoir centralisé, qui s’y constitua.169 Les maisons étaient construites avec des matériaux provenant de la végétation des rives des lagunes, en particulier du raphia (Raphia farinifera). Les maisons sur pilotis ou hotin (xɔ signifiant maison, et tín bois) étaient couvertes d’une épaisse couche de paille, ce qui exigeait solide charpente. Elles étaient rectangulaires et très semblables, signe de la mentalité égalitaire.170 Les lacs et les lagunes assuraient, outre la sécurité contre les invasions, une activité économique basée sur la pêche. Les eaux saumâtres abritaient un grand nombre d’huîtres, de crevettes et de poissons, tous d’origine marine, appartenant à des espèces adaptées aux variations saisonnières de salinité. Les pêcheurs utilisaient des techniques de pêche très diverses selon la période de l’année et l’objectif. Le filet le plus courant était l’épervier, ou filet à lancer, jeté depuis des canots pour deux personnes. Ils utilisaient différents types de lignes, avec un ou deux hameçons, des pièges, et des casiers de branches disposés sur la vase (les poissons s’y abritaient et les pêcheurs les capturaient périodiquement après avoir entouré l’endroit d’un filet). Les pilotis aussi attiraient les animaux aquatiques.171 Au Bénin, la pêche a toujours été plus importante dans les rivières, les lacs et les lagunes que dans la mer. Outre le danger de traverser la barre infestée de requins, la pêche en haute mer était entravée par de mauvaises techniques de pêche en eaux profondes et la relative précarité des canots. Dans les villages de pêcheurs Hulas qui vivent entre la plage et la lagune, les mythes sur les voduns des eaux d’Avlekétè et de Naétè, déjà décrits, témoignent de cette préférence pour les lagunes.
Fortier et un photographe inconnu (dont la production figure dans l’album organisé par le ministre) ont photographié l’îlot où ont poussé deux rôniers (palmiers du genre Borassus), située sur le canal de Toché qui relie Porto-Novo au lac Nokoué (Figures 127 à 130).172 Fortier nomme le site « l’île de Robinson » (Crusoé). Les maisons sont construites sur pilotis et surélevées pour ne pas subir d’inondations. Les eaux calmes et peu profondes, ainsi que les abris pour le frai dans la végétation proche des rives, étaient propices à une reproduction considérable des poissons et des crustacés.
Femmes et enfants
Dès le début de sa carrière, Fortier a photographié des filles et femmes africaines nues. Certains clichés frôlant la pornographie ont été publiés, sans mention d’auteur, dans des magazines parisiens qui proposaient des images de « modèles vivants » pour les artistes. Les Africaines y apparaissaient aux côtés de femmes et d’enfants européens et asiatiques, toutes toujours dénudées.173 En tant qu’éditeur de cartes postales, Fortier, dès la première série de 1902, a publié des portraits de filles aux seins nus. L’attrait commercial de ces images était évident et, au fil des ans, il alimenta ses archives de jeunes personnes nues. Comme nous le verrons, les tirages de portraits féminins ont toujours dépassé ceux consacrés à d’autres thèmes. Il est très probable qu’ils représenteraient la partie la plus rentable de leur activité en tant que photographe et petit revendeur à Dakar.
Nous ne connaissons pas le lieu ni les circonstances dans lesquelles Fortier, en 1908 ou 1909, a photographié les femmes et les enfants que nous voyons dans les Figures 131 à 145. Ces portraits ont été publiés dans une série intitulée « Études » : il a photographié chaque femme sous différents angles, généralement en plan américain, cadrage qui mettait en valeur leurs poitrines. La direction de la scène est assez évidente. En comparant les récits du voyage de 1908 – comme on le retrouve dans le carnet de voyage du ministre ou dans le texte de La Dépêche Coloniale – avec les clichés de Fortier, il est intéressant de noter qu’il n’a pas participé aux réunions officielles ou aux hommages des élites locales au ministre lorsque ces évènements se déroulaient à huis clos. Considérant que le voyage de 1908 avait un horaire très chargé, on peut supposer que Fortier profitait des moments où la délégation se consacrait à la politique locale pour photographier des scènes de rue, et surtout des torses féminins.
Les femmes photographiées ont presque toujours une expression très sérieuse. C’est une des raisons pour lesquelles nous pensons qu’elles ont été contraintes, probablement par des hommes de la région, de poser pour le photographe. Fortier voyageait avec les délégations officielles du ministre des Colonies et du gouverneur général, dont des soldats armés (voir Figures 23, 51 et 94). Elles ne pouvaient guère refuser d’accepter les intentions du photographe, qui voulait sûrement profiter de la profusion de femmes à portée de son appareil. Leurs particularités vestimentaires ou de tatouage, expliquées dans les légendes des futures cartes postales, offraient des indications d’appartenance ethnique ; l’ethnographie a donc ici servi à fournir une légitimation à l’œuvre. Cela donnait un cachet de scientificité, et il ne fallait par ailleurs pas s’offusquer puisqu’il s’agissait de femmes d’autres « races », habitantes de l’empire constitué par les Européens. Aujourd’hui encore, sur les sites proposant des cartes de Fortier sur internet, on souligne les attraits sensuels de ces images. Les Africaines photographiées par Fortier ne savaient pas que leurs portraits seraient reproduits et vendus à des milliers d’exemplaires et si longtemps.
Par ailleurs, stylistiquement, l’ensemble des portraits de femmes et d’enfants réalisés par Fortier au Dahomey montrent qu’il avait tendance à les présenter dans des poses faisant référence au classicisme européen. Se référant à la série de portraits de femmes nues, l’historien italien Carlo Ginzburg a écrit :
… Les images de Fortier appartiennent à un genre spécifiquement européen, voire colonial : ce sont des photographies érotiques présentées comme des documents ethnographiques. Mais ce n’est qu’une analyse partielle. Ces Africaines, regardées par un Français et placées devant un public d’hommes français, étaient, au préalable, placées devant l’appareil selon des formules établies par une tradition picturale européenne. Approcher les réalités non européennes par des formes classiques est une caractéristique récurrente de l’exotisme : il s’agit de transmettre au spectateur ou au lecteur une impression d’altérité ou de diversité domestiquée.174
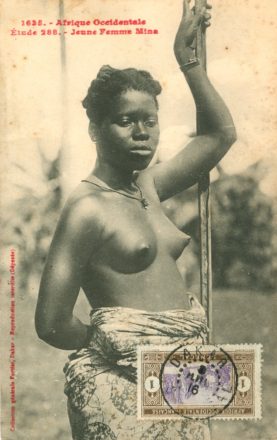
La « Femme Mina » (Figures 131 à 138), photographiée par Fortier dans de nombreuses poses, concorde parfaitement avec la thèse de Ginzburg. Les portraits de Dahoméennes dénudées ont un évident attrait sensuel, voire érotique, mis en scène par le photographe. Pour la société locale, il n’y avait rien d’extraordinaire, car les seins des filles étaient visibles quotidiennement. C’est Fortier qui transforme le spontané en sensuel, par l’orientation qu’il donne à la scène. On ne saurait sous-estimer ou oublier l’exploitation du corps d’une femme noire par un homme européen. Ceci dit, même si le contenu ethnographique des légendes des cartes postales a servi, dans une large mesure, à masquer leur évidente intention érotique, l’analyse des images peut nous fournir des données complémentaires sur la mémoire des pratiques culturelles et de la vie quotidienne des femmes depuis plus de cent ans. Tissus, coiffures, ornements, scarifications de toutes sortes : il y a beaucoup d’informations à déchiffrer dans les portraits réalisés par Fortier.
Sur les Figures 139 et 140, on voit des « jeunes Dahoméennes » au travail, tenant des récipients sur la tête, dans un geste qui, là aussi, fait référence aux normes de représentation du corps typiques du classicisme européen. La jeune fille de la Figure 139 porte une calebasse, ou un autre ustensile en bois, recouvert d’un couvercle ou d’un tamis. Peut-être s’agit-il d’une des vendeuses du marché de Porto-Novo. La femme de la Figure 140 a sur la tête un pot d’argile servant à transporter de l’eau. Les scarifications sur son ventre et les brassards de cauris indiquent une vaudouiste. Elle porte des alésoirs ronds accrochés aux lobes des oreilles.
Les femmes et les enfants des Figures 140 à 144 ont le ventre scarifié, signe d’initiation. La pratique des petites incisions sur la peau, qui dans d’autres situations pourraient servir de marqueur ethnique, sans connotation religieuse, a toujours impressionné les Européens. Au début du XVIIIe siècle, un auteur français anonyme résidant à Ouidah, décrivant le culte du serpent vodun Dangbe (l’un des principaux cultes du royaume, associé à la royauté), fait ces commentaires : « La marque de ces prêtresses (vaudonnous), pour les distinguer des autres, est qu’elles sont incisées sur tout le corps, du cou à la taille, avec des motifs différents ».175 Quelques années plus tard, un marchand français nommé Chevalier des Marchais détaille les mêmes fidèles de Dangbe : « Tout son corps a été déchiqueté avec des instruments de fer, comme s’il s’agissait de dentelle ou de galons, sur le ventre, sur le dos et partout ailleurs, à l’imitation du grand sacrificateur [le grand prêtre de Dangbeh] ».176 Il est donc possible que les jeunes femmes photographiées par Fortier aient été initiées au vodun Dangbe, dont le temple principal se trouve à Ouidah.
À la fin du XIXe siècle, l’abbé Pierre Bouche écrit :
« Les fétichistes indiquent au moyen de tatouages les mystères et les degrés d’initiation. Ces personnages énigmatiques et sacrés marquent à quelle classe de fétichisme ils se consacrent, et quel degré ils occupent dans la hiérarchie de leur ordre. On peut lire ce marquage symbolique sur leur corps, comme si on lisait un passeport ou une lettre de crédit, car le tatouage est une véritable écriture. Le fer n’est pas seul utilisé pour le tatouage : on utilise aussi certaines plantes, dont la sève a la propriété de produire sur la peau des cloques qui laissent des escarres et des cicatrices durables. »177
Sur les Figures 143 à 145, on voit d’autres mises en scènes de Fortier qui créent l’« exotisme » dont parle Ginzburg. L’enfant pose sa tête sur le sein de la femme (Figure 143), dans un geste presque de style Renaissance, tandis que des trios féminins (Figures 144 et 145) semblent représenter les trois Grâces .
IIIe PARTIE
4. Au fil du temps: Interventions, erreurs et propagande
Les documents photographiques réalisés par Fortier dans la colonie du Dahomey en 1908 et 1909 ont été publiés dans diverses séries de cartes postales jusqu’au milieu des années 1920. Au fil des années, à chaque nouvelle édition de ces images, de nombreuses informations visuelles et textuelles des premiers tirages ont été modifiées. Le chercheur travaillant sur ce corpus de photographies doit donc tenir compte de l’historique des publications et des caractéristiques de chaque série.
Les premières éditions de ces images ont été produites peu après le voyage du ministre Milliès-Lacroix en Afrique. Le plus ancien affranchissement connu de cette série, numérotée de 2501 à 2660 et sous-titrée en rouge, date de juillet 1908. Dans cette première édition, entièrement en noir et blanc, Fortier publie sous forme de cartes postales une sorte de « journal visuel » du voyage du ministre en 160 images.178 Toutes les légendes comportent la mention : « Voyage du Ministre des Colonies à la Côte d’Afrique ». C’est une sorte de photojournalisme ; le ministre et son entourage apparaissent sur plusieurs des photos. Il s’agissait donc d’une série « datée », d’un intérêt limité à une certaine circonstance historique : deux ans plus tard, qui achèterait une carte postale avec une photo du ministre français arrivant dans un port de la côte africaine ? C’est probablement la raison pour laquelle nous ne connaissons qu’une seule édition de cette séquence.
Comme nous l’avons déjà dit (voir section Abomey), d’autres images réalisées par Fortier lors du voyage du ministre, mais qui ne faisaient pas partie de la série de « photojournalisme » de 1908, ne furent publiées qu’en 1909, ainsi que des photographies du voyage de William Merlaud-Ponty, gouverneur général de l’Afrique occidentale française. Il existe trois séries de cartes postales sur le Dahomey publiées par Fortier en 1909 : la première sur des représentations du culte vodun et de ses adeptes (numéros 1493 à 1532) ; la seconde avec des portraits de femmes en plan américain (1599 à 1659) ; et la troisième sur le marché de Porto-Novo et le voyage de William Merlaud-Ponty (3000 à 3069).
Les cartes consacrées au voyage de William Merlaud-Ponty au Dahomey (comme en 1908 celles consacrées au voyage de Milliès-Lacroix) devaient être publiées le plus tôt possible pour avoir un intérêt d’actualité. Au vu des versos des cartes179, on peut conclure qu’en 1909 la série imprimée la première est celle qui commence au numéro 3000. Elle a fait l’objet de tirages en noir et blanc et de tirages en couleur. Ensuite, Fortier a publié, sans doute simultanément, la série consacrée aux voduns et la série de portraits. Dans les deux cas, il y a eu plusieurs tirages. Dans la série sur les voduns, Fortier a inclus de nombreuses images déjà publiées dans la série « Voyage du Ministre », de l’année précédente, comme celle de la rangée d’ « amazones ». Trois tirages ont été identifiés : un en noir et blanc (Figure 146), un en couleur (Figure 147) et un autre en couleur, dans des tons peu réalistes et avec quelques modifications dans le texte des légendes (Figure 148). De la série « Portraits », nous avons repéré au moins huit tirages (motivés par l’attrait des seins nus des Dahoméennes), avec différents types de colorisation.
La Figure 150 est un autre exemple de carte postale retouchée à l’aquarelle. Les couleurs ont été appliquées sur des plaques de verre qui ont servi de matrice pour l’impression, à la façon de pochoirs. La colorisation ne correspondait pas toujours exactement aux personnes représentées. Cependant, même réalisée de façon rudimentaire, la peinture a donné aux images un relief visuel absent des éditions monochromes. Il ne faut pas oublier que les plaques de verre étaient généralement colorisées par des personnes européennes sans aucune connaissance du contexte des clichés. Même si Fortier a pu les guider en définissant quelques motifs chromatiques, le résultat provient de leur imagination et ne constitue pas une source d’information fiable. Dans la colorisation de l’image 150, par exemple, rien ne garantit que la jupe de l’une des danseuses eût été verte et orange.

Dans la Figure 151, le bleu du ciel est mis en évidence derrière les branches de l’arbre. Les couleurs sont superposées sur les images d’une manière assez correcte. Indépendamment du réalisme des images, la colorisation leur donne du dynamisme (par rapport à la Figure 76).
Presque toutes les images de Fortier au Dahomey présentées au chapitre précédent proviennent des premières éditions des cartes, en 1908 et 1909. Il est important de le dire, car leurs rééditions ultérieures, comme nous le verrons, apportent des informations imprécises ou erronées. Depuis le début de sa carrière d’éditeur de cartes postales vers 1900, Edmond Fortier s’est appuyé sur les services graphiques des entreprises Albert Bergeret, originellement dénommées Imprimeries A. Bergeret & Cie (A.B. & Cie), puis Imprimeries Réunies de Nancy.180 En 1913, après avoir publié des centaines de milliers de cartes postales de haute qualité, Fortier commence à imprimer ses œuvres à Paris avec la société Le Deley. La qualité du support carton a beaucoup diminué : à Nancy, la matière première était le coton, qui permettait d’obtenir un excellent produit pour recevoir l’encre d’imprimerie ; à Paris, on utilisait de la pâte de cellulose, ce qui donnait un article plus rugueux n’offrant qu’une moindre définition. Pour la plupart des cartes éditées par Le Deley (voir Figures 152 à 159), le verso est vert.

Dans les séries publiées à Paris, Fortier a renuméroté les photographies déjà éditées, selon un autre principe de classement. À partir de 1913, les articles sont classés par thème. Du numéro 1496 au numéro 1614, par exemple, Fortier a rassemblé toutes les photos de ses archives comportant des groupes : agriculteurs au Sénégal, Maures en campement à Tombouctou ou danseurs vodun à Abomey. L’unité de la série ne provenait pas d’un critère géographique, mais de l’idée d’un ensemble de « manifestations authentiques » ou de scènes de genre de la vie africaine. Il est intéressant de noter que les légendes ne mentionnent pas les lieux de ces scènes dans la colonie française. Comme nous l’avons vu, dans les éditions de 1908 et 1909, Fortier était très précis quant à la ville et à la colonie où les photographies avaient été prises. Sur les images 152 à 159, qui représentent toutes des scènes dahoméennes, la légende indique comme lieu uniquement « Afrique-Occidentale Française ». Cette indication est utile à l‘éditeur des cartes mais est insuffisante pour qui aborde le monde d’Edmond Fortier.
Les huit images reproduites ici ont une colorisation fruste avec quatre couleurs de base et peu de nuances. C’est un autre aspect des interventions que les photographies du Dahomey ont subies au fil du temps. En 1916, trois ans après les premières éditions réalisées à Paris avec l’imprimeur Le Deley, Fortier lance sa série « définitive ». On y trouve une sélection de photographies prises au cours de sa carrière et qui seront rééditées avec la même numérotation jusqu’à la fin de la vie du photographe, en 1928, selon une organisation thématique. Comme caractéristique physique de cette série rétrospective, nous pouvons indiquer une variété d’impressions dans lesquelles le dos des cartes postales est fait de carton vert.

A partir de 1916, les photographies du Dahomey apparaissent mélangées à des images d’autres origines, dans les séquences des portraits et des groupes de personnes. La référence géographique pour toutes les photographies est encore « l’Afrique-Occidentale Française », entité géopolitique du colonisateur. De plus, Fortier intervient sur les originaux en effaçant des détails du premier plan. Les Figures 160, 162, 164 et 166, produites au Dahomey, ont subi des occultations. Sur la Figure 160 (par rapport à la Figure 161), les arbres en bas de la scène ont été effacés pour mettre en valeur les danseurs. Dans ce cas, la perte n’était pas importante. Sur la Figure 162, l’intervention de Fortier est beaucoup plus marquée et change la perception. La photographie a été retouchée, éliminant les parapluies français faisant office d’ombrelles de prestige (voir Figure 163). La légende, anciennement « Dahomey – Chef et groupe d’indigènes de la région de Savalou », a été changée en : « Afrique-Occidentale – Populations très primitives ». En plus de réduire l’information visuelle et textuelle, Fortier émet un jugement de valeur dépréciateur.
Dans les Figures 165 et 166, de la même série où le dos des cartes postales est vert, nous avons deux cas d’intervention sur les images d’Adjiki, alors grand chef de Porto-Novo, mais appelé « roi » par Fortier. La Figure 164 montre une version colorisée de la Figure 106. Les trois couleurs de la France sont représentées sur un immense drapeau qui couvre l’escalier du palais du gouverneur de Porto-Novo. Certains Européens apparaissent en bas de l’image. Sur la Figure 165, qui en est une variante, le drapeau tricoloreet les Européens ont été éliminés. La référence à Porto-Novo disparaît et Adjiki devient « un roi indigène ». Dans cette nouvelle version, le geste du bras du porte-parole du ministre est tellement souligné qu’il pourrait faire penser que c’est lui le « roi indigène » et non l’homme à côté de lui vêtu d’un uniforme de l’Académie française. Par contre, sur la Figure 166, représentant Adjiki à une autre époque, il n’y a aucun doute sur la personne censée être le « roi indigène Adjiki » ; il est entouré de sa cour d’hommes et de garçons au torse nu.

Les Figures 167 à 169 représentent Adjiki dans son carrosse. La 167 est la version colorisée de la première édition, et mentionne le Dahomey et Porto-Novo. La personne qui a colorisé la photographie a pensé que les vêtements des ministres d’Adjiki étaient de couleurs vives, et les a rendus en vert et en rouge. Le tissu blanc qu’Adjiki tient en même temps que son bâton est retouché en bleu clair, de même que les tôles ondulées à l’arrière-plan. La deuxième version en couleur (Figure 168) est apparue dans la série imprimée à Paris en 1913. Quatre couleurs soutenues, avec peu de nuances, se chevauchent là aussi avec la photographie originale. La légende, qui ne mentionne pas le nom du « roi », affirme ironiquement que les ministres « ont l’honneur » de tirer le carrosse. La légende de la Figure 169, une version de 1916 de la même photo, mentionne à nouveau Adjiki, mais indique comme lieu la ville de… Dakar !
Dakar, en raison d’une erreur d’édition des légendes des cartes postales, est indiqué dans toutes les photographies d’une édition très tardive de la dernière série créée par Fortier. Ce tirage peut même avoir été imprimé après la mort du photographe en 1928, puisque certains objets ont circulé lors de l’Exposition coloniale de Paris en 1931.
La Figure 30, que nous avons commentée dans la deuxième partie de cet ouvrage, nous montre un groupe avec la légende : « Indigènes de la région de Pahou ». Sur les Figures 170 et 171, nous voyons d’autres tirages de cette image. Dans aucun d’eux nous ne connaissons l’origine des personnes, puisque la légende met l’accent sur l’exotisme de la fête et la représentation musicale (tam-tam). La légende de la Figure 171 situe aussi la scène à Dakar.
Les Figures 172 et 173, représentant un rang d’amazones, sont des éditions tardives181, et les légendes ne mentionnent plus le roi Béhanzin (contrairement aux Figures 146, 147 et 148), mais indiquent seulement qu’elles sont de farouches guerrières. Cela montre que la guerre coloniale, encore vive dans l’esprit des clients lorsque Fortier publia cette image pour la première fois, était sortie de leur imaginaire dans les années 1920 ; il fallait leur expliquer qui étaient ces femmes tenant des cannes. Là encore, la légende de la Figure 173 situe la scène à Dakar.
Les Figures 174 et 175 sont deux autres exemples de scènes du Dahomey décrites comme ayant eu lieu à Dakar. Cette erreur dans les légendes des cartes de Fortier risque de créer beaucoup de confusion chez les chercheurs inexpérimentés.
En plus de l’édition de cartes postales, Fortier a fourni des photographies à des auteurs de livres sur l’Afrique de l’Ouest. Un cas emblématique, en 1912, est celui de la collaboration entre Fortier et Maurice Delafosse : quatorze illustrations du classique Haut-Sénégal-Niger sont issues de l’atelier de Fortier.182 Un autre ouvrage utilisant des photographies de Fortier la même année est L’Afrique Occidentale Française de Louis Sonolet. Cet ouvrage n’a pas le caractère savant, bien que daté, de l’œuvre de Delafosse. Sonolet était un journaliste propagandiste du colonialisme français. Il n’y avait donc guère de rigueur dans le choix des illustrations, qui visaient avant tout à impressionner le public sur la « civilisation » apportée à l’Afrique.
Sur la Figure 176, on voit la procession des vodúnsis sur la place Simbodji, déjà commenté (voir pp. 108-122). Or la légende du livre de Sonolet dit : « Femmes en attendant la consultation au dispensaire d’Abomey. (Dahomey). Les indigènes viennent en grand nombre aux consultations de l’assistance médicale ». Fortier a-t-il induit Sonolet en erreur en lui donnant de fausses informations pour vendre une autre photo ? Ou ont-ils ensemble choisi cette image pour illustrer le discours fallacieux de Sonolet, alors qu’ils savaient que les femmes n’étaient pas du tout dans la file d’attente d’une infirmerie construite par les Français ? Quiconque connaît le Dahomey sait que des femmes ne vont pas à un rendez-vous médical avec un chasse-mouches rituel à la main ou en portant un collier kanhodenu.183 Par contre, dans deux autres images réalisées par Fortier et présentes dans le livre de Sonolet (Figure 177), les légendes sur le Dahomey sont très instructives et ont certainement été rédigées par le photographe.184 La première dit : « Un collège de féticheuses (Dahomey). Les jeunes féticheuses forment des sortes de congrégation qui reçoivent l’enseignement sacerdotal. » Et l’autre : « Un tam-tam d’honneur à Abomey. Dans le fond, les parasols de parade des chefs ». Le texte de Sonolet sur les religions africaines est assez basique, pour ne pas dire ignorant. Commentant les sacrifices humains au Dahomey, Sonolet va jusqu’à écrire que le roi Béhanzin voulait immoler sa propre mère pour qu’elle apporte dans l’au-delà des nouvelles à son père Glele, et que le général Dodds l’en a empêché. Rien n’atteste cela. En fournissant des photographies de son œuvre à un journaliste peu scrupuleux comme Sonolet, Fortier s’est fait complice de la plus basse propagande coloniale française.
Conclusion
Les voyages de Fortier au Dahomey nous ont fourni une occasion unique de voir des aspects de la vie politique, religieuse et quotidienne d’une société africaine sous le régime colonial. Au moment de ses voyages, après quinze ans d’occupation, les Français ont consolidé l’exploitation économique et la pénétration du territoire. Significatif est aussi le fait que les voyages des autorités françaises en 1908 et 1909 aient été associés à l’expansion du chemin de fer à l’intérieur de la colonie.
Les images des rencontres entre les autorités européennes et les « rois » locaux sont des témoignages d’une valeur historique remarquable. Les photographies de Fortier saisissent ce qui semble avoir été un moment charnière de la politique coloniale française, alors qu’elle oscille encore entre des formes indirectes de gouvernement, avec la perpétuation et même la réinstallation de chefs traditionnels comme à Allada, et des formes de plus en plus explicites de gouvernement direct, comme après la disparition de la monarchie dahoméenne. Les rois peu accommodants et capables de susciter des mouvements de résistance furent exilés dans d’autres colonies, comme ce fut le cas avec Béhanzin et avec Pohizon, roi des Adjas, moins connu. Dans certains cas, ils furent remplacés par des « rois » fantoches au service des intérêts coloniaux, qui perdirent rapidement le soutien de la population lorsque fut détruit le système traditionnel de droits et d’obligations qui maintenait leur autorité. Cela semble avoir été le cas avec Gi-Gla à Allada ou Adjiki à Porto-Novo. D’autres rois, comme celui de Sakété, Odekoulé, conservèrent un certain statut et un certain prestige parce qu’ils surent mener, ouvertement ou clandestinement, des mouvements de résistance à l’autorité coloniale.
Par ailleurs, l’autorité politique étrangère imposée par la menace ou la force a établi un séparatisme socioculturel entre colons et colonisés, et une tension raciale entre Blancs et Noirs imprégnant les images de Fortier. La différence hiérarchique s’inscrit explicitement dans les vêtements des personnes représentées, dans l’occupation de l’espace physique et dans la gestuelle, mais elle est aussi latente dans le regard érotisé du portraitiste dans ses Études sur les jeunes femmes . Dans ce contexte d’asymétrie radicale, la mobilisation rituelle des temples voduns face aux autorités coloniales pourrait être interprétée comme une « décaractérisation », voire une folklorisation, de la religion locale. Cependant rien ne prouve que les cérémonies documentées par Fortier aient été mises en scène. L’invocation et la manifestation des dieux dans des rituels tels que ceux que nous voyons sur ces photographies peuvent avoir été une forme oblique d’affirmation de l’identité politico-culturelle.
Bien que la chute de la monarchie ait conduit à une relative démocratisation des cultes associés à la royauté dahoméenne, les cérémonies Nesuhue ont continué à inscrire les symboles et la glorieuse mémoire du royaume. Les différentes collectivités familiales des princes aboméens et leurs familles, malgré les pénuries imposées par le nouveau régime, ont continué à transmettre (par l’héraldique des parasols, les chorégraphies, les chants et la manifestation des ancêtres à travers le corps de leurs initiés) l’éthos d’un peuple guerrier, brave et fier de son passé. Bien que la plupart des témoignages photographiques des cultes voduns correspondent à des célébrations en l’honneur des autorités coloniales, Fortier nous montre que les chefs autochtones se sont présentés publiquement et ont ainsi renforcé leur visibilité et leur prestige social.
Même dans un contexte cérémonial fortement marqué par une présence allogène, la série d’images des cultes voduns a une valeur ethnographique et historique qui mérite d’être soulignée. Il est à noter que peu de clichés sont posés, et une des qualités les plus remarquables de Fortier est sa capacité à circuler dans la population locale et à saisir les actions sur le vif, ce qui confère à son travail une valeur documentaire de premier ordre. Il est capable, comme nous l’avons dit, d’enregistrer les danses dans des séquences quasi cinématographiques. En ce sens, la série sur le culte vodun est la première du genre à apparaître en Europe, vingt ans avant l’expédition du photographe et cinéaste Frédéric Gadmer au Dahomey en 1930, et quarante ans avant que Pierre Verger entame son voyage ethno-photographique sur la voie ouverte par Fortier.185 En pionnier, Fortier a été l’un des créateurs des images qui ont nourri l’imagination européenne sur l’Afrique au début du XXe siècle. Ses dernières éditions à gros tirages, montrent surtout de femmes aux seins nus. Ses photographies font partie de la « bibliothèque coloniale », comme l’appelait Valentim Mudimbé : le discours collectif et intertextuel des médecins, botanistes, voyageurs, missionnaires, anthropologues et photographes à propos du continent africain. L’imagination et l’idée de l’Afrique ont été « inventées » comme un miroir inversé et négatif, au service de l’identité d’un observateur blanc, « civilisé » et bourgeois. Elizabeth Edwards nous rappelle aussi que la photographie était la technologie coloniale idéale, illustrant par elle-même la « supériorité » culturelle de l’Occident, et orientant sa vision classificatrice et hiérarchisant du monde des « autres ».186 Fortier a participé à ce processus épistémologique et en est devenu, peut-être inconsciemment, l’un de ses agents les plus efficaces. Cela étant, le Fortier documentariste ne peut être oublié. Les cartes postales individuelles peuvent être appréciées, mais seules des séries de cartes postales soigneusement organisées peuvent servir de base documentaire offrant des indices pour nous pencher sur le passé. Dans le cas du Dahomey, il y a eu peu d’éditions originales en 1908-1909. Ce sont des objets rares, dispersés, qui sont rassemblés ici. Cette collection, qui peut donc être lue de multiples façons, constitue un fonds d’une richesse exceptionnelle.
NOTES
1 Selon l’alphabet phonétique international, Allada se prononce Aladà en langue fon. Ouidah correspondrait à Xweɖá, écrit Whydah par les Anglais et Judá ou Ajudá par les Portugais. L’orthographe française Dahomey correspondent, en fon, à Danxomɛ̀ : Abomey se prononce Agbŏmɛ̀. À l’est du royaume du Dahomey et à partir du XVIIIe siècle s’est développé le royaume de Porto-Novo, nom portugais correspondant aux toponymes locaux Hogbonu (Xɔgbonú) ou Adjatché (Ajacɛ́). Pour des études détaillées de ces royaumes, voir par exemple Robin Law, The Slave Coast of West Africa 1550-1750. The Impact of the Atlantic Slave Trade on an African Society. Oxford : Clarendon, 1991.
2 Voir Luis Nicolau Parés, O rei o pai e a morte: A religião Vodum na antiga Costa dos Escravos na África Ocidental. São Paulo: Companhia das Letras, 2016.
3 Sur les délégations dahoméennes, voir : Pierre Verger, Fluxo e refluxo do tráfico de escravos entre o Golfo do Benim e a Bahia de Todos os Santos. São Paulo: Corrupio, 1987 ; Luis Nicolau Parés, “Cartas do Daomé: uma introdução”. Afro-Ásia, no 47, 2013, pp. 295-395 ; Mariza de Carvalho Soares,“Trocando galanterias: A diplomacia do comércio de escravos, Brasil-Daomé, 1810-1812”. Afro-Ásia, no 49, 2014, pp. 229-71 ; Ana Lúcia Araújo, “Dahomey, Portugal and Bahia: King Adandozan and the Atlantic Slave Trade”. Slavery and Abolition, vol. 33, no 1, 2012, pp. 1-19.
4 Luis Nicolau Parés, A formação do Candomblé: História e ritual da nação jeje na Bahia. Campinas : Ed. Unicamp, 2007.
5 João José Reis, Rebelião escrava no Brasil:A história do levante dos malês em 1835. São Paulo: Companhia das Letras, 2003 ; Mônica Lima e Souza, Entre margens: O retorno à África de libertos no Brasil 1830-70. Thèse de doctorat – Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro, 2008 ; Lisa Louise Earl Castillo, “Em busca dos agudás da Bahia: Trajetórias individuais e mudanças demográficas no século xix”. Afro-Ásia, no 55, 2016, pp. 111-147.
6 À propos des Agudas, voir, entre autres : Lorenzo D. Turner, “Some Contacts of Brazilian Ex-Slaves with Nigeria, West Africa”. Journal of Negro History, vol. 27, no 1, 1942, pp. 55-67 ; Verger, Fluxo e refluxo : Jerry Michael Turner, Les Brésiliens: The Impact of Former Brazilian Slaves upon Dahomey, Thèse de doctorat – Boston University, 1975 ; Manuela Carneiro da Cunha, Negros estrangeiros: Os escravos libertos e sua volta à África. São Paulo: Brasiliense, 1985 ; Milton Guran, Agudas: Os “brasileiros” do Benim. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999. À propos du commerce atlantique: Flavio G. dos Santos, Economia e cultura do candomblé na Bahia: O comércio dos objetos litúrgicos afro-brasileiros,1850 -1937. Ilhéus: Editora UESC, 2013.
7 Archives nationales du Bénin (ci après ANB), Affaires politiques, 1E 2, boîte 3, Abomey ; 1E 16, boîte 12, Porto-Novo, rapports mensuels, 1908.
8 Verger, Fluxo e refluxo, esp. chap. 26.
9 Voir par exemple : Antônio Olinto, Brasileiros na África. Rio de Janeiro : Editora GRD, 1964 ; Turner, Les Brésiliens ; Carneiro da Cunha, Negros estrangeiros.
10 Sur l’avènement des cartes postales illustrées comme forme de correspondance, et sur la vie familiale et la carrière professionnelle de Fortier, voir Daniela Moreau, Fortier photographe, de Conakry à Tombouctou – images de l’Afrique de l’ouest en 1906, Milan : 5 Continents, 2018.
11 Nous utilisons ici le terme « primaire » pour désigner les premières éditions de ces images. Beaucoup de ces photographies ont été rééditées dans des séries ultérieures, dont les dernières ont été publiées après 1923. Voir ci-dessous, IIIe partie.
12 La numérotation de ces quatre séries ne suit pas exactement l’ordre chronologique. Les numéros les plus bas concernant le Dahomey (1493 à 1532 et 1599 à 1659) mélangent les photographies de 1908 et 1909. La séquence de 2609 à 2659 fait référence au voyage du ministre Milliès-Lacroix, daté de 1908. La séquence de 3000 à 3069 remonte à 1909, lorsque Fortier accompagnait la visite du gouverneur général William Merlaud-Ponty. Cette numérotation complexe a sans doute facilité le travail éditorial de Fortier, en particulier pour réimprimer les séries les plus réussies.
13 Les dreyfusards étaient les gens convaincus de l’innocence d’Alfred Dreyfus, un officier juif français accusé de trahison et d’espionnage pro-allemand. Le procès de l’affaire Dreyfus divisa la société française et dura douze ans, de 1894 à 1906, lorsque qu’il fut définitivement acquitté et réhabilité.
14 Hubert Delpont, Dax et les Milliès-Lacroix. Nérac : Éditions d’Albret, 2011, pp. 119-22.
15 La Dépêche Coloniale Illustrée, 15 août. 1908. Les navires de la ligne sud-américaine (de Bordeaux à Buenos Aires) font aussi escale à Rio de Janeiro.
16 Le but du voyage en Guinée était d’inaugurer officiellement un monument (achevé depuis 1903) dédié au premier gouverneur de la colonie, le médecin Noël Ballay, mort de la fièvre jaune en 1902, ainsi que la gare de la ville de Fofota, à l’intérieur de la colonie, à 180 kilomètres de la capitale. Le fait que les 73 photographies de cette série, même les plus « commerciales », n’aient pas été rééditées suggère que Fortier a négocié ses droits d’auteur avec l’administration française. L’édition du 15 mars 1908 de La Dépêche Coloniale Illustrée était consacrée à la couverture du voyage du gouverneur général Merlin en Guinée. L’auteur n’est pas mentionné, mais on trouve dans la publication une vingtaine de photographies de Fortier, qui ont également été éditées sous forme de cartes postales.
17 Fortier, Tacher et Arkhust ont publié des cartes postales avec des photographies reproduites dans la Dépêche Coloniale Illustrée, ce qui nous amène à leur attribuer la paternité. Tacher a photographié uniquement au Sénégal et Arkhurst uniquement en Côte d’Ivoire. Fortier a travaillé dans toutes les colonies visitées par le ministre : Sénégal, Côte d’Ivoire, Dahomey et Guinée.
18 Arkhurst a publié une carte postale avec cette photo. Sur l’hypothèse que Fortier serait l’homme sur la gauche, l’indice provient d’un cliché de 1906 supposé être un autoportrait du photographe. Voir Moreau, Fortier photographe, de Conakry à Tombouctou.
19 Sur les difficultés rencontrées par les photographes en Afrique, voir Moreau, Fortier photographe, de Conakry à Tombouctou 20. Musée de Borda, Une Mémoire d’Afrique – 1908, Voyage de Raphaël Milliès-Lacroix en Afrique de l’Ouest: 100 Ans après sa collection sort de l’ombre. Catalogue de l’exposition. Dax, Imp. Barrouillet, 2009.
20 Musée de Borda, Une Mémoire d’Afrique – 1908, Voyage de Raphaël Milliès-Lacroix en Afrique de l’Ouest: 100 Ans après sa collection sort de l’ombre. Folheto da exposição. Dax, Imp. Barrouillet, 2009.
21 Marlène-Michèle Biton, Arts, politiques et pouvoirs – Les productions artistiques du Dahomey : fonctions et devenir. Paris : L’Harmattan, 2010, p. 117, note 141.
22 Le Musée historique d’Abomey n’a été créé qu’en 1944 dans le cadre des projets gérés par l’Institut français pour l’Afrique noire (IFAN), basé à Dakar. À propos de la restauration des peintures murales d’Abomey, voir : Francesca Piqué et Leslie H. Rainer, Les Bas-reliefs d’Abomey: L’Histoire racontée sur les murs. Bamako : Jamana, 1999 ; Biton, Arts, politiques et pouvoirs, pp. 105-22.
23 Sur la pénétration française et la résistance de Béhanzin, voir Luc Garcia, Le Royaume du Dahomé contre la pénétration coloniale : affrontements et incompréhension (1875-1894). Paris : Karthala, 1988.
24 Georges Waterlot, Les Bas-Reliefs des bâtiments royaux d’Abomey (Dahomey), Paris, Institut d’ethnologie, 1926, pl. 10, 13.
25 «On note que les cases-tombeaux ont l’avantage d’être en même temps le symbole de la royauté, du pouvoir, de l’Histoire du royaume, des grands morts et d’être également des bâtiments aux proportions plus modestes que les palais et donc d ‘entretien plus facile et à moindre coût». Biton, Arts, politiques et pouvoirs, p. 110.
26 Sur le pillage de la ville sacrée de Cana et de la capitale Abomey, voir Biton, Arts, politiques et pouvoirs, pp. 43-58. L’auteur retrace également le parcours des œuvres dahoméennes sur le marché de l’art européen. Voir aussi Gaëlle Beaujean-Baltzer, « Du Trophée à l’œuvre : Parcours de cinq artefacts du royaume d’Abomey ». Gradhiva nº 6, 2007, p. 70-85.
27 Auguste Le Hérissé, L’Ancien Royaume du Dahomey: Moeurs, religion, histoire. Paris : Emile Larose, 1911, pp. 3-4.
28 Robert Cornevin, « Auguste Le Hérissé (1876-1953) ». In : Hommes et Destins (Dictionnaire biographique d’Outre-Mer). vol. II. Paris : Académie des Sciences d’Outre-Mer, 1975, p. 378.
29 Milliès-Lacroix a écrit à propos de la photographie du pont inachevé qui figure dans l’album offert par le photographe au ministre que l’ouvrage, une fois achevé, avait reçu son nom.
30 Sur Toffa, voir ci-dessous.
31 ANB, Affaires Politiques, 1E 2, boîte 4, Abomey, rapport mensuel de mars 1909.
32 Les dirigeants africains qui résistaient aux Français, lorsqu’ils étaient vaincus, étaient souvent exilés dans d’autres colonies généralement avec leurs familles, où ils restaient indéfiniment. C’est le cas de Samori Touré, décédée au Gabon en 1900, de Ranavalona III, reine de Madagascar, envoyée en Algérie, où elle mourut en 1917, et, comme nous l’avons vu, de Béhanzin, roi du Dahomey, qui fut emmené en Martinique.
33 Robin Law, Ouidah : The Social History of a West African Slaving Port, 1727-1892. Oxford : James Currey Books, 2004, p. 226.
34 À l’époque de la traite des esclaves au Dahomey, ces rameurs n’étaient pas locaux et venaient du fort de São Jorge da Mina. Aujourd’hui, plusieurs familles de la côte béninoise descendent de ces rameurs. Sur l’expérience du passage de la barre par un Européen, voir Alexandre L. d’Albèca, « Au Dahomey ». Le Tour du Monde, 1753, 1754, août 1754. 1894, pp. 68 et suivantes.
35 Patrick Manning, Slavery, Colonialism and Economic Growth in Dahomey, 1640-1960. Cambridge : Cambridge University Press, 2004, p. 333.
36 Voir Garcia, Le Royaume, p. 255 et suiv. et Sophie Dulucq, Écrire l’histoire de l’Afrique à l’époque coloniale (XIXe-XXe siècles). Paris : Karthala, 2009, p. 168.
37 ANB, Affaires Politiques, 1E 2, boîte 1, Abomey, 1895.
38 Id., 1E 2, boîte 1, Abomey, rapport mensuel d’octobre 1895.
39 Id., 1E 2, boîte 1 Abomey, rapport mensuel de juillet 1895.
40 Manning, Slavery, Colonialism and Economic Growth, p. 141.
41 L’anisette, liqueur anisée titrant typiquement 33o. En 1906, les marchands de la colonie du Dahomey achetaient de l’alcool à 90oC. Ces alcools, originaires de Russie et de Hongrie, contenaient des huiles toxiques et devaient être refiltrées dans les distilleries de Marseille et de Hambourg. Ils étaient ensuite transportés dans des fûts d’environ 450 litres. Gouvernement Général de l’Afrique Occidentale Française, Le Dahomey : Nouvelles publiées à l’occasion de l’Exposition coloniale de Marseille. Corbeil-Essonne : Crété, 1906, p. 340. Voir aussi Garcia, Le Royaume, p. 55 ; Manning, Slavery, Colonialism and Economic Growth, pp. 365-380.
42 Exposition coloniale de Marseille, Les Colonies Françaises au début du XXe siècle, cinq années de progrès (1900-1905). Marseille : Barlatier Imprimeur Éditeur, 1906, vol. II, p. 172 et suivants.
43 Le hamac faisait partie de la culture matérielle des populations amérindiennes et son utilisation comme moyen de transport, avec alternance de porteurs, est documentée au Brésil depuis le XVIe siècle. La technique consistant à accrocher le hamac à un bâton ou à une tige de bambou (taboca) est explicitement mentionnée au XIXe siècle. Ernani Silva Bruno, Equipamentos, usos e costumes da casa brasileira : Equipamentos. São Paulo : Edusp ; Museu da Casa Brasileira ; Imprensa Oficial, 2001, pp. 86-8. Il est probable que les Portugais aient transféré cette pratique du Brésil à l’Afrique de l’Ouest au début de la traite négrière. Dans les années 1720, elle est déjà documentée à la cour du royaume de Ouidah.
44 Pour lire l’intégralité du contrat avec Georges Borelli, un intermédiaire ayant des contacts à Marseille, voir P. Dareste et G. Appert (dir.), Recueil de législation & jurisprudence coloniales. Paris : Marchal & Billard, 1903, pp. 191 et suiv. Pour un résumé des négociations entre le ministère de la Colonie française, le concessionnaire et le gouvernement colonial du Dahomey, de 1897 à 1908, voir La Dépêche Coloniale Illustrée, 31 juillet. 1908.
45 René Le Hérissé, Voyage au Dahomey et à la Côte d’Ivoire. Paris : Henri Charles-Lavauzelle, 1903, p. 107 et suivantes ; Manning, Slavery, Colonialism and Economic Growth, p. 145.
46 Le Herissé, 1903, pp. 96-104.
47 Manning, Slavery, Colonialism and Economic Growth, pp. 140-41, 145-51.
48 Nicoué Lodjou Gayibor, Histoire des Togolais : Des Origines aux années 1960. Paris/Lomé : Karthala ; Presses de l’Université de Lomé, 2011, vol. 3, pp. 236-237.
49 ANB, Affaires Politiques, 1E 2, boîte 4, Abomey, rapport sur les Holis, 1905-1910.
50 Id., 1E 16, boîte 12, Porto-Novo, rapport mensuel de mai 1908.
51 Id., 1E 2, boîte 3, Abomey, rapport mensuel de mai 1908.
52 Law, Ouidah : The Social History, p. 193-1944, 228-230. Sur Francisco Félix de Souza, voir ci-dessous.
53 Sur « l’ignorance mutuelle » et le rôle des interprètes, voir Garcia, Le Royaume, pp. 37-51.
54 Law, Ouidah : The Social History, pp. 258, 264-277.
55 Ibid, p. 277.
56 Musée de Borda, Relation du voyage du ministre des Colonies en Afrique de l’Ouest. Transcription dactylographiée, p. 23.
57 Suzanne Preston Blier, “The Path of the Leopard: Motherhood and Majesty in Early Danhomè”. Journal of African History, no 36, 1995, pp. 411-412; Joseph Adandé, “Du Contact diplomatique au contact des formes entre royaumes Ashanti et du Dahomey. Exemples des trônes et des toiles appliquées”. In: Gaëlle Beaujean-Baltzer (dir.). Artistes d’Abomey. Paris/ Cotonou: Musée du Quai Branly; Fondation Zinsou, 2009, pp. 237-238.
58 “The Kpezin (Secular Pot Drum)”, dans Canadian Heritage Information Network, 1999. Disponible à l’adresse : <www.virtualmuseum.ca/edu/ViewLoitLo.do?method=preview&lang=en&id=11990&lang=EN> Consulté le 3 novembre 2017.
59 Entretien avec Bacharou Nondicharo, Abomey, 11 novembre 2016.
60 Base de données sur la traite transatlantique des esclaves, 2008. Disponible à l’adresse : <www.slavevoyages.org>.
61 Robin Law, Ouidah : The Social History, p. 6.
62 Sur la vie de Francisco Félix de Souza, voir Alberto da Costa e Silva, Francisco Félix de Souza, mercador de escravos. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2004; Robin Law, “Francisco Félix de Souza in West Africa, 1800-1849”. In: José C. Curto e Paul E. Lovejoy (dir.), Enslaving Connections: Western Africa and Brazil during the Era of Slavery. Amherst, NY: Humanity Books, 2004.
63 Musée de Borda, Relation du Voyage, p. 23.
64 L’identification d’Avlekétè a été confirmée par Avimanjenon, communication personnelle, Ouidah, janvier 2010, et par Daagbo Hunon Houna II, courriels des 26 et 28 avril 2016.
65 Un différend successoral oppose actuellement deux Daagbo Hunon au sein de la même famille. Nous en avons été informés par le Daagbo Hunon Houna.
66 Legba correspond à l’Esu des Yorubas. C’est le principe dynamique qui imprime le mouvement sur tout processus, et qui est conçu comme un vodun générique et comme une force individualisée inhérente à chaque personne. Il est le gardien des temples et du marché, il peut aussi bien provoquer des conflits que les résoudre ; son ambivalence morale en fait une entité à la fois positive et dangereuse. Legba symbolise également le principe masculin et peut être représenté par une personnage doté d’un phallus de grandes proportions.
67 Auguste Le Hérissé, L’Ancien Royaume, p. 109 ; Melville J. Herskovits, Dahomey, un ancien royaume d’Afrique occidentale. New York : J. J. Augustin Publisher, 1938, vol. 2, p. 152, 155 et 156.
68 Auguste Le Hérissé, L’Ancien Royaume, pp. 369-70.
69 Daagbo Hunon Houna II, communication personnelle, courriel du 26 avril 2016.
70 A. D. Cortez da Silva Curado, Dahomé: Esbôço geographico, historico, ethnographico e politico. Lisboa: Typ. do Comercio de Portugal, 1888, p. 68.
71 L’Univers Illustré n. 1903, 12 sept. 1891. Chaudouin, employé de la société Cyprien Fabre à Marseille, vivait à Ouidah et fut l’un des otages français capturés par Béhanzin et emmenés à Abomey en février 1890, au début des hostilités entre la France et le Dahomey. Des années plus tard, il retourna à Abomey comme administrateur et commença à restaurer les bas-reliefs sur les murs du palais de Glele. Cf. Waterlot, Les Bas-Reliefs, p. 9, note 1, apud Biton, Arts, politiques et pouvoirs, p. 111-6.
72 La jupe courte (vlayá ou avlayá) est typique du vodun Sakpata. Claude Savary soutient que l’utilisation de ce type de jupe, qui rappelle la jupe ballon du XIXe siècle, est le résultat de contacts entre les dahoméens et Portugais et les Brésiliens sur la côte : Claude Savary, La Pensée symbolique des fô du Dahomey: Tableau de la société et étude de la littérature orale d’expression sacrée dans l’ancien royaume du Dahomey. Genève : Éditions Médecine et Hygiène, 1976, p. 187 ; Id., “Rôle du vêtement et de la parure dans les rites vodun chez les Fon (République Populaire du Bénin)”. In : Beate Engelbrecht et Bernhard Gardi (Orgs.), Man Does Not Go Naked. Bâle : Ethnologisches Seminar der Universität und Museum für Völkerkunde, 1989, p. 121 et 125.
73 Sur les différentes versions relatives à l’identité des rois fondateurs de ces palais, voir Luis Nicolau Parés, Le Roi, le Père et la mort: La religion vodun sur l’ancienne Côte des Esclaves de l’Afrique de l’Ouest. São Paulo : Companhia das Letras, 2016 ; J. Cameron Monroe, The Precolonial State in West Africa: Building Power in Dahomey. New York : Cambridge University Press, 2014.
74 Pour une analyse détaillée des Coutumes et de Nesuhue, voir Parés, O rei, o pai e a morte, chapitres 4 e 5.
75 M. Houseman et al., « Note on the changing structure of a historical town ». Cahiers d’Études Africaines, vol. 104, no 26, pp. 527-46, 1986.
76 Un cercle était la plus petite unité de l’administration des colonies françaises.
77 Musée de Borda, Relation du Voyage, pp. 25-6.
78 Construit en 1956, ce bâtiment abritait, sous le régime marxiste-léniniste, le Conseil provincial de la Révolution.
79 Constant Legonou, communication personnelle, courriels des 29 et 30 septembre 2016.
80 En 1895, Édouard-Edmond Aublet (La Guerre au Dahomey, 1888-1893 : D’Après les documents officiels. Paris : Berger-Levrault, 1894-1895, vol. 2, pp. 109-10) explique que le général Dodds, dans un ultime effort pour maîtriser Béhanzin (qui a humilié les Français en échappant à d’innombrables sièges) avait rassemblé à Goho, près d’Abomey, les chefs et princes royaux qui avaient déjà été faits prisonniers. Comme nous l’avons vu, Dodds avait décidé de choisir un nouveau roi pour saper le pouvoir du monarque en fuite : « Abomey avait été complètement détruite lors de l’évasion de Béhanzin et il fallut y ériger quelques constructions pour procurer, dès les premiers jours, une maison convenable au roi que nous allions introniser. D’autre part, le poste [militaire et administratif] de Goho était mal situé et un emplacement soigneusement étudié fut choisi à l’ouest d’Abomey. ».
81 À Conakry, le palais du gouvernement colonial a été construit en 1889 sur un site sacré, où se trouvaient les arbres sous lesquels se déposaient les offrandes religieuses. Odile Goerg, « Le Site du Palais du gouverneur à Conakry : Pouvoirs, symboles et mutations de sens ». In : Jean-Pierre Chrétien et Jean-Louis Triaud (Orgs.), Histoire d’Afrique : Les Enjeux de mémoire. Paris : Karthala, 1999, pp. 389-403.
82 Constant Legonou, communication personnelle, courriel du 30 septembre 2016. Il y a actuellement un réservoir d’eau à cet endroit.
83 Les deux citations sont dans Le Hérissé, Voyage au Dahomey, p. 144. À Paris étaient exposés « des vêtements, des récades, des parures de tête, des masques ; la série des trônes des rois qui se succédèrent à Abomey, de Dako-Kounou, le premier roi, à Agoli-Agbo (…) ; une belle prise: un éléphant pesant plus de 90 kg ; une collection complète d’instruments de musique ; des exposants de bijoux locaux ; tapis, tissus de coton et raphia finement tissé ». Jules Charles-Roux, L’Organisation et le fonctionnement de l’exposition des colonies et pays de protectorat: Les Colonies françaises. Paris : Imprimerie Nationale, 1902, p. 159.
84 Le Hérissé, Voyage au Dahomey, pp. 138-9.
85 Musée Albert-Kahn, Pour une reconnaissance africaine, Dahomey 1930: Des Images au service d’une idée : Albert Kahn, 1860-1940 [et] le père Aupiais, 1877-1945. Département des Hauts-de-Seine : Musée Albert-Kahn, 1996, p. 63. Pour une bonne description de la technique d’application des tissus colorés, voir Herskovits, Dahomey, An Ancient West African Kingdom, vol. 2, p. 329 à 343.
86 Pierre Verger, Notes sur le culte des orisa et vodun à Bahia, la baie de tous les Saints au Brésil et à l’ancienne Côte des esclaves en Afrique. Dakar : IFAN, 1957, p. 253.
87 Entretien avec Olivier Semasusi, Abomey, juin 1995.
88 Vicente Ferreira P. Pires, Viagem de África em o reino de Dahome. São Paulo : Companhia Editora Nacional, 1957, p. 112 ; Parés, « Cartas do Dahomey », lettres nºs 4 et 13.
89 Entretien avec Abadasi, Abomey, 11 novembre 2016. Selon Maurice Glèlèlè-Ahanhanzo (Le Daxome : Du Pouvoir Ajá à la nation Fon. Cotonou : Nubia, 1974, p. 80), les tohosu Adanhunzo, Donuvo et Semasu portent généralement des « chapeaux perlés appelés daza [dĕzàn] ».
90 Entretien avec Bacharou Nondicharo, Abomey, 11 novembre 2016.
91 Frederick E. Forbes, Dahomey and the Dahomans, Being the Journals of Two Missions to the King of Dahomey, and Residence at His Capital, in the Years 1849 and 1850. Londres : [n. r.], 1966, vol. 2, pp. 108, 111-112, 124.
92 Parés, O rei, o pai e a morte, p. 313.
93 Voir la lettre de Bulfinch Lamb de 1724 dans Bulfinch Lamb, « From the Great King Trudo Audati’s Palace of Abomey in the Kingdom of Dahomet », 27 novembre. 1724. In : William Smith, A New Voyage to Guinea. Londres: [s.n.], 1744, pp. 183-4; e John Duncan, Travels in Western Africa in 1845 and 1846 Comprising a Journey from Whydah, through the Kingdom of Dahomey, to Adofoodia, in the Interior. Londres : Frank Cass & Co, 1968, vol. 1, p. 246. Les bâtons de marche Nesuhuesi (kpogɛ̀ ou gànkó : bâtons de chef), certains avec des pommeaux, peut-être d’origine européenne, doivent être distingués des récades ou makpo des rois. Ces objets, plus petits et ornés à l’une de leurs extrémités, étaient des évolutions des claves, armes devenues sceptres et bâtons de commandement. Au Dahomey, les messagers du roi portaient les récades du roi comme insignes.
94 House of Commons Parliamentary Papers (HCPP), Slave Trade, 1850-1, Class A, incl. 2 in nº 220, « Journal of F. E. Forbes », entrées 27 et 29 mai 1850, pp. 330-1.
95 Le Hérissé(L’Ancien Royaume, pp. 124, 190) documente également l’utilisation par les vodunons de cannes à pommeau en or et en argent munis d’un foulard blanc.
96 Parés, Le Roi, Père et mort, p. 343.
97 Le Hérissé, L’Ancien Royaume, p. 124.
98 Musée Albert-Kahn, Pour une reconnaissance, pp. 169, 173.
99 L’orisha Sango, dans la zone yoruba, peut porter une jupe faite de bandes de tissu accrochées autour de la taille, semblable à celles des masques egunguns, mais différente des jupes des vodúnsis de Hevioso.
100 En candomblé bahianais, il correspond à ekodidé (mot yoruba), utilisé par les Yahos à l’issue de l’initiation.
101 Le Hérissé, L’Ancien Royaume, p. 109.
102 Parés, A formação do Candomblé, pp. 292-8. Voir aussi : James H. Sweet, Domingos Alvares, African Healing, and the Intellectual History of the Atlantic World. Chapel Hill : University of North Carolina Press, 2011.
103 Musée Albert-Kahn, Pour une reconnaissance, p. 169.
104 Musée de Borda, Relation du Voyage, pp. 26-7. Il est intéressant de noter que le ministre ne fait aucune référence directe aux palais royaux, mais utilise l’expression « il semble » lorsqu’il mentionne leur état de ruine, ce qui indique qu’il n’était pas là. La série de photographies de Fortier prises à la place Simbodji ne figure pas dans les deux albums photographiques du ministre, ce qui suggère aussi qu’elles sont postérieures à 1908.
105 ANB, Affaires Politiques, 1E 2, cx 4, Abomey, rapport mensuel de mars 1909.
106 « Pendant que M. le Gouverneur Général visitait le palais de Sinbodji – j’ai eu l’occasion de lui dire qu’un projet de musée avait été soumis autrefois par M. Maire, résident d’Abomey à l’agrément de M. Liotard – qui l’avait approuvé. Cette construction n’a pas été faite. » ANB, Affaires Politiques, 1E 2, cx 4, Abomey, rapport mensuel de mars 1909 .
107 Victor-Louis Maire, Dahomey. Abomey : la dynastie dahoméenne. Les palais : leurs bas-reliefs. Besançon : Abel Cariage, 1905.
108 ANB, Affaires Politiques, 1E 2, cx 4, Abomey, rapport mensuel de mars 1909 .
109 Biton, Arts, politiques et pouvoirs, p. 49-58.
110 Francesca Piqué et Leslie H. Rainer, Les Bas-reliefs d’Abomey, pp. 39-40.
111 Ibid, pp. 39-45.
112 Dans la mythologie dahoméenne, le couple vodun Mawu et Lissa, représentant le panthéon du ciel, devint le couple primordial responsable de la création du monde. Nos informateurs d’Abomey nous ont déclaré que Dan, Sakpata et Lissa peuvent danser sur les mêmes rythmes, et ont suggéré que la danse représentée dans les images correspondait au rythme janguedé de Lissa. Entretien avec Bacharou Nondicharo, Dossouhouan, Abadasi et Daa Adomusi, Abomey, 11 novembre 2016.
113 Entretien avec Bacharou Nondicharo, Dossouhouan, Abadasi et Daa Adomusi, Abomey, 11 novembre 2016 ; Musée Albert-Kahn, Pour une reconnaissance, p. 166.
114 Musée Albert-Kahn, Pour une Reconnaissance, p. 206.
115 Musée de Borda, Relation du Voyage, pp. 27-8.
116 Ibid, p. 28.
117 Pour une histoire du territoire Mahi, voir : J. A. M. A. R. Bergé, « Étude sur le Pays Mahi (1926-1928) ». Bulletin du Comité des études historiques et scientifiques en Afrique de l’Ouest française, vol. 11, nº 4, 1928, p. 708 à 755 ; Jessie Gaston Mulira, A History of the Mahi Peoples from 1774-1920. Thèse de doctorat – University of California, Los Angeles, 1984.
118 Entretien avec Bacharou Nondicharo, Dossouhouan, Abadasi et Daa Adomusi, Abomey, 11 novembre 2016 ; selon Claude Savary (« Rôle du vêtement », p. 125), dans les congrégations de Mawu-Lissa et Hevioso, seuls les hommes portent la jupe vlayá.
119 Les mythes sur les créatures de petite taille, souvent considérées comme les premiers habitants de la terre, sont courants du Sénégal au Congo. Voir Alberto da Costa e Silva, A enxada e a lança: A África antes dos portugueses. Rio de Janeiro : Nova Fronteira, 1996, p. 79. Au Dahomey, ces créatures sont également associées aux esprits Azizà, habitants des forêts, détenteurs de la médecine et transmetteurs des secrets de bŏ (Notes Africaines, n° 24, 1945, p. 2 ; n° 25, 1945, p. 18). À Savalou, les Azizà, les Yéouhé et les Yêvi sont aussi imaginés comme des esprits de petite taille, aux cheveux longs et capables de métamorphose. Voir R. P. Paul Falcon, « Religion du vodun ». Études Dahoméennes (nouvelle série),nos 18-19, 1970, p. 99.
120 Parés, O rei o pai e a morte, pp. 242-3, 409. Pour d’autres versions sur le mythe de l’origine du tohosu, voir Le Hérissé, L’Ancien Royaume, pp. 120-1 ; Herskovits, Dahomey, an Ancient West African Kingdom, vol. 1, pp. 230-1 : Verger, Notes sur le culte des orisa, pp. 552-3 : B. Adoukonou, Jalons pour une théologie africaine. Essai d’une herméneutique chrétienne du Vodun dahoméen. Paris : Lethielleux, 1980, vol. II, pp. 72-3, 94 ; Savary, La Pensée symbolique, pp. 197-8.
121 Musée de Borda, Relation du Voyage, p. 28.
122 V. Y. Mudimbé, l’invention de l’Afrique. Lisbonne/Luanda : Pedago ; Mulemba, 2013, p. 32.
123 Jacques Lombard, » Contribution à l’histoire d’une ancienne société politique du Dahomey : La Royauté d’Allada. » Bulletin de l’IFAN, série. B, vol. 29, nºs 1-2, 1966, pp. 44 et suivantes.
124 Les traditions orales nous disent que trois princes frères, après une dispute successorale, auraient décidé de se séparer. L’un d’eux est resté à Allada, l’autre est parti vers le nord pour fonder le Dahomey, et le troisième vers l’est pour fonder Porto-Novo. Dans ce récit, la fondation de Porto-Novo serait contemporaine de la fondation du Dahomey, mais l’historiographie la plus récente affirme que le royaume de Porto-Novo n’a été établi que lorsque la famille royale d’Allada et ses adeptes se sont réfugiés dans la région orientale du lac Nokoué, après l’invasion du royaume par les troupes dahoméennes en 1724. Le Hérissé, L’Ancien Royaume, pp. 105-6, 276-9 ; A. Akindele et C. Aguessy, Contribution à l’étude de l’histoire du pèlerinage antique de Porto-Novo. Mémoire de l’Institut Français d’Afrique Noire, nº 25. Dakar : IFAN, 1953, pp. 20-8 ; Herskovits, Dahomey, un ancien royaume d’Afrique occidentale, vol. 1, pp. 166-9 ; Robin Law, The kingdom of Allada. Leyde : Research School CNWS ; CNWS Publications, 1997, pp. 35-40.
125 François D’Elbée, « Journal du voyage du Sieur Delbée » et « Suite du Journal du Sieur Delbée ». In : Jean de Clodoré (dir.), Relation de ce qui s’est passé dans les Isles & Terre-Ferme de l’Amérique, pendant la dernière guerre avec l’Angleterre, & depuis en exécution du traitté de Bréda. Paris : Gervais Clouzier, 1671, pp. 405, 430 et 443, apud Law, The kingdom of Allada, pp. 2 et suivantes, note 9.
126 Law, The kingdom of Allada, pp. 115 ss.
127 Lombard, « Contribution à l’histoire… », pp. 54-5.
128 Garcia, Le royaume du Dahomé, p. 266. Luc Garcia traduit toute la phrase en : « C’est l’enfant courageux qui fait attention à la parole de Dieu ». On pourrait aussi traduire en : « Un enfant courageux a l’habitude de regarder la vie sans l’acheter ». Constant Fortuné Legonou, communication personnelle, courriel du 2 nov. 2017.
129 Jacques Lombard, « Contribution à l’histoire… », pp. 62-3, note 1.
130 Le Hérissé, L’Ancien Royaume, p. 11, note 1.
131 Le Hérissé, Voyage au Dahomey, pp. 121-2.
132 Waterlot, Les Bas Reliefs, planche XVII; Paul Mercier et Jacques Lombard, « Guide du musée d’Abomey ». Études Dahoméennes, IFAN, 1959, p. 44. Il serait également possible de relier l’oiseau du parasol à Gonufohué (gò nu fɔ̀ hwe), littéralement « le héron royal attrape le poisson dans son bec », un des surnoms du vodun Zomadonu, le monstre fils du roi Akaba et principal tohosu du culte Nesuhue. Dans les murs de ses temples, Zomadonu est représenté sous la forme d’un héron royale enserrant un poisson dans son bec. Savary, La Pensée symbolique, p. 350. L’IFAN (Institut Français d’Afrique Noire) a été fondé à Dakar en 1936 à l’initiative de Théodore Monod et, en 1966, après l’indépendance du Sénégal, a été renommé Institut Fondamental d’Afrique Noire.
133 Le Hérissé, Voyage au Dahomey, p. 122.
134 Yves Person, “Chronologie du royaume gun de Hogbonu (Porto-Novo)”, Cahiers d’Études Africaines. vol. 15, no 58, 1975, pp. 217-238, pp. 230, 236.
135 Anthony I. Asiwaju, « The Aja-Speaking Peoples of Nigeria : A Note on Their Origins, Settlement and Cultural Adaptation up to 1945 », Afrique: Journal of the International African Institute, vol. 49, nº 1, 1979, p. 15-28, p. 20.
136 Gouvernement Général de l’Afrique Occidentale Française, Les Chemins de fer en Afrique Occidentale. Paris : Émile Larose, 1906, p. 138 ; id., Le Dahomey…, 1906, p. 263-264 ; Manning, Slavery, Colonialism and Economic Growth, p. 145-157.
137 Musée de Borda, Relation du Voyage, pp. 24-5. Le journal précise que la délégation est partie pour Sakété à 7h et que sur le chemin du retour elle était dans la lagune à 18h30 et est arrivée à Cotonou la même nuit à 23h. Il y a probablement eu une erreur dans la transcription : 7h devrait être 2h.
138 Ibid, p. 25.
139 La légende de la carte portant le numéro 2655, immédiatement avant cela, mentionne la visite du ministre dans les pépinières Sakété, où les Français faisaient des expériences agricoles avec des hévéas plantés en 1907. Voir A. Houard, « Saignées d’Hevea Medeiros de la plantation de Sakété ». Bulletin du Comité d’Études Historiques et Scientifiques de l’Afrique Occidentale Française, Paris, Larose, 1921, pp. 513-4.
140 Robert F. Thompson, “The Sign of the Divine King: Yoruba Bead-Embroidered Crowns with Veil and Bird Decorations”. In : Douglas Fraser & Herbert M. Cole (Orgs.), African Art & Leadership. Madison : University of Wisconsin Press, 1972 ; id., « Crown. » Nigeria Magazine, nº 84, 1965, p. 22. In : Susan Mullin Vogel (dir.), For Spirits and Kings : African Art from the Paul and Ruth Tishman Collection. New York : The Metropolitan Museum of Art, 1981.
141 Dadjo Koôvi Michel Videgla et Abiola Felix Iroko, “Nouveau Regard sur la révolte de Sakété en 1905”. Cahiers d’Études Africaines, vol. 24, no 93, 1984, pp. 52-4.
142 M. Simon, Souvenirs de brousse. Paris : Nouvelles Éditions Latines, 1965, p. 32. La ville, qui comptait environ 6 000 habitants avant le soulèvement n’en avait plus que cinquante en juillet 1905. Sur les intentions de « pacification » du gouvernement colonial, voir aussi Videgla et Iroko, « Nouveau Regard », p. 61 ss.
143 L. Sonolet, L’Afrique Occidentale Française. Paris : Hachette et Cie, 1912, planche 5, p. 28.
144 L’amende honorable était une peine prévue par la loi française dans l’Ancien Régime. Supprimée dans sa forme originale de la législation après la Révolution française, elle est restée partie intégrante des pratiques culturelles.
145 Videgla et Iroko, « Nouveau Regard », pp. 64-5.
146 Parés, O pai, o rei e a morte, p. 205.
147 Bellarmin Coffi Codo, « Les Afro-Brésiliens et la politique française dans le royaume de Xogbonou (seconde moitié du XIXe siècle) ». In : Catherine Coquery-Vidrovich, Odile Goerg et Hervé Tenoux, (Orgs.). Des Historiens africains en Afrique : Logiques du passé et dynamiques actuelles, Cahiers nos 17-18, L’Harmattan, 1998, pp. 216-22.
148 Le sort tragique de ces porteurs, abandonnés sans vivres par le général Dodds à son retour en France après la prise d’Abomey, a été décrit par Hughes Lepaire – peut-être le seul, parmi les nombreux témoignages d’anciens combattants de la guerre du Dahomey, qui ne glorifie pas Dodds. Hughes Lepaire, « La Campagne du Dahomey – 1982. Notes de voyage ». La Revue Blanche, 1 sem. 1985, pp. 42-61, cité en partie par Biton, Arts, politiques et pouvoirs, p. 28.
149 Akindele et Aguessy, Contribution à l’étude, p. 89.
150 Luc Gnacadja, « Le Bénin » In : Jacques Soulillou (dir.), Rives Coloniales: Architectures, de Saint-Louis à Douala. Marseille/ Paris : Parenthèses ; Ed. de l’Orstom, 1993, pp. 227-8.
151 Turner, Les Brésiliens, pp. 298-9, également dans Codo, « Les Afro-brésiliens et la politique française« , p. 223.
152 Codo, « Les Afro-Brésiliens et la politique française », p. 224.
153 Musée de Borda, Relation du Voyage, pp. 24-5.
154 Le Hérissé, Voyage au Dahomey, pp. 50-1. Plus de détails sur l’architecture coloniale à Porto-Novo dans Gnacadja, « Le Bénin », pp. 235-6.
155 Akindele et Aguessy, Contribution à l’étude, p. 88-90.
156 Musée de Borda, Relation du Voyage, p. 24.
157 Cf. L’Illustration, pp. 195-6, 21 mars. 1908. En 1908, Adjiki propose au ministre de monter sur son char en forme de landau tiré par ses sujets, mais le ministre refuse et préfère être transporté dans un hamac : Musée de Borda, Relation du Voyage, pp. 24-5.
158 Marie M. Corneloup, « Au Dahomey avec Francis Aupiais et Frédéric Gadmer ». In : Musée Albert-Kahn, Pour une Reconnaissance, p. 85.
159 Stephanie Decker, “Return to Imperial Trade? John Holt & Co. (Liverpool) Ltd. as a Contemporary Free-Standing Company, 1945-2006”. In : Sheryllynne Haggerty, Anthony Webster et Nicholas J. White (Orgs.), The Empire in One City ? Liverpool’s Inconvenient Imperial Past. Manchester : Manchester University Press, 2008, pp. 188-191. Comme mentionné plus haut, John Holt avait sa propre jetée à Porto-Novo.
160 Robert Cornevin, Histoire du Dahomey. Paris : Berger-Levrault, 1962, p. 15 ; Manning, Slavery, Colonialism and Economic Growth, p. 61.
161 Manning, Slavery, Colonialism and Economic Growth, pp. 88, 143, 149.
162 Manning, Slavery, Colonialism and Economic Growth, pp. 51-74.
163 Ibid, p. 51.
164 Ibid, p. 60.
165 Norbert Savariau, L’Agriculture au Dahomey. Paris : A. Challamel, 1906, p. 27.
166 Manning, Slavery, Colonialism and Economic Growth, pp. 62.
167 Raoul-Clair-Joseph Gaillard, « Étude sur les Lacustres du Bas-Dahomey ». L’Anthropologie, vol. 18, 1907, p. 109.
168 Manning, Slavery, Colonialism and Economic Growth, pp. 60-62.
169 Georges E. Bourgoignie, Les Hommes de l’eau: Ethno-écologie du Dahomey lacustre. Paris : Éditions Universitaires, 1972, p. 176. Elisée Soumonni, “Lacustrine Villages in South Benin as Refuges from the Slave Trade”. In: Sylviane Anna Diouf (dir.). Fighting the Slave Trade: West African Strategies. Athens: Ohio University Press, 2003, pp. 3-14.
170 Corneloup, « Au Dahomey avec Francis… », p. 136.
171 Manning, Slavery, Colonialism and Economic Growth, pp. 71-2.
172 La légende de la Figure 127 indique : « Vue du village de Tache ». Le canal de Taché relie la lagune de Porto-Novo au lac Nokoué.
173 Malgré l’absence de mention d’auteur, on reconnaît des clichés de jeunes africaines nues pris par Fortier dans les numéros 5, 12, 14, 21, 22 et 23 du magazine L’Humanité Féminine, publié par Amédée Vignola à Paris entre 1906 et 1907. L’attribution est possible du fait que les mêmes filles apparaissent, dans des poses moins compromettantes, sur les cartes postales éditées par Fortier. Au début du XXe siècle, Vignola était le plus célèbre éditeur de magazines présentant des photographies de « modèles vivants » prétendument destinées à faciliter le travail des artistes-peintres qui n’avaient pas les moyens de se procurer leurs propres modèles nus. Malgré les protestations d’un public prude, Vignola réussit à publier sans interruption la revue L’Étude académique entre 1904 et 1914.
174 Carlo Ginzburg, “Além do exotismo: Picasso e Warburg ». In : Id., Relações de força: História, retórica, prova. São Paulo: Companhia das Letras, 2002, pp. 126-7.
175 Archives d’Outre-Mer, Aix-en-Provence. Fonds Ministériels, Dépôt des Fortifications de Colonies, Col. XIII, Mémoires, ms 104. Anonyme, « Relation du Royaume de Judas en Guinée, de son gouvernement, des mœurs de ses habitants, de leur religion et du negoce qui sy fait », vers 1708-14, f. 61.
176 Bibliothèque Nationale, Paris. Des Marchais (Jean Pierre Thibault). « Journal du Voyage de Guinée et Cayenne par le Chevalier des Marchais, 1727. Fonds Français, ms nº 24223, f. 54.
177 L’abbé Pierre Bertrand Bouche, Sept ans en Afrique de l’Ouest: La Côte des Esclaves et le Dahomey. Paris : Plon, Nourrit et Cie. Imprimeurs-Éditeurs, 1885, p. 39.
178 Dans cette séquence, les photographies de la colonie du Dahomey de l’époque ont les derniers numéros (2609 à 2660), précédés du Sénégal (2501 à 2521), de la Guinée-Conakry (2522 à 2560) et de la Côte d’Ivoire (2561 à 2608). Cependant, à la lecture du carnet de voyage du ministre et des articles de La Dépêche Coloniale Illustrée, on constate que l’itinéraire de Milliès-Lacroix était différent : Sénégal, Côte d’Ivoire, Dahomey et Guinée. Voir sur la Figure 5 la carte et l’itinéraire du voyage de 1908.
179 De petites variations dans les textes imprimés au verso des cartes postales, tels que « correspondance » et « adresse », peuvent indiquer non pas exactement la date de chaque numéro, mais l’ordre dans lequel ils ont été édités. Avec le temps, on a eu tendance à ne mettre de texte imprimé qu’au verso des cartes.
180 Albert Bergeret, artiste et entrepreneur graphique, est l’un des fondateurs du mouvement lié aux arts appliqués, l’École de Nancy, mouvement précurseur de l’Art Nouveau en France. Pour plus d’informations, voir Moreau, De Conakry à Tombouctou, pp. 47-52.
181 La carte postale de la figure 172 a des légendes de couleur rouge. La série à laquelle elle appartient, bien que toutes ses légendes soient rouges, ne doit pas être confondue avec la série 1908-1909. Cette dernière série, publiée vers 1920, se reconnaît au carton du verso, toujours vert.
182 Voir Maurice Delafosse, Haut-Sénégal -Niger, 3 vol., Paris, E. Larose, 1912. Les photographies de Fortier sont dans le vol. I fig. 15, pl. VIII, fig. 17 et 18, pl IX, fig. 19 et 20, pl. X, fig. 27 et 28, pl. XIV; dans le vol II, fig. 40, pl. XX, fig. 50, pl. XXV, fig. 53 et 54, pl. XXVII, fig. 56, pl. XXVIII, fig. 57, pl. XXIX; dans le vol. III, fig. 60, pl. XXI, comportant quatorze images portant la mention « Cliché Fortier ».
183 Voir Sonolet 1912, tableau 8, p. 48. Les textes de Sonolet, avec les photographies de Fortier, avant de devenir un livre, furent publiés dans Le Tour du Monde en janvier et juillet 1911 sous le titre « Les progrès de L’Afrique occidentale française ».
184 Ibid., pl 31, p. 232
185 Pour Gadmer, voir musée Albert-Kahn 1996. Pour Verger, voir Verger 1957.
186 Valentim-Yves Mudimbé, A invenção da África, Lisbonne/ Luanda, Pedago/ Mulemba, [1988] 2013; Elizabeth Edwards (dir.) Anthropology and Photography 1860-1920, New Heaven/Londres, Yale University Press/ The Royal Anthropological Institute, 1992. view&lang+en &id=11990&lang=EN> . Consulté le 3 novembre 2017.
Sources
Interviews
Abadasi (Abomey, 28 juillet 1995)
Bacharou Nondicharo, Dossouhouan, Abadasi et Daa Adomusi (Abomey, 11 novembre 2016, entretien collectif)
Constant Legonou (courriels, 29 et 30 sept. 2016)
Daa Daagbo Avimadjenon Ahouandjinou (Ouidah, juillet 1995)
Daagbo Hunon Houna II (courriels, 26 et 28 avril 2016)
Olivier Semasusi (Abomey, juin 1995)
archives
Archives nationales du Bénin, Porto-Novo
1E 2, boîte 1, Affaires Politiques, Abomey, 1895
1E 2, boîte 4, Affaires politiques, Abomey, Rapport Holis, 1905-1910
1E 2, boîte 3, Affaires Politiques, Abomey, 1908
1E 2, boîte 4, Affaires Politiques, Abomey, 1909
1E16, boîte 12, Affaires politiques, Porto-Novo, 1908
Archives d’Outre-Mer, Aix-en-Provence
Fonds Ministériels, Dépôt des Fortifications des Colonies, Coll. XIII, Mémoires, ms 104, Anonyme, « Relation du Royaume de Judas en Guinée, de son gouvernement, des moeurs de ses habitants, de leur religion et du négoce qui s’y fait », vers 1708-14
Bibliothèque Nationale, Paris
Des Marchais (Jean-Pierre Thibault). « Journal du Voyage de Guinée et Cayenne par le Chevalier des Marchais », 1727. Fonds Français, ms nº 24223
Musée de Borda, Dax
Relation du voyage du ministre des Colonies en Afrique de l’Ouest. Transcription dactylographiée
Albums photographiques de Milliès Lacroix
Sites
The Trans-Atlantic Slave Trade Database, 2008. <www.slavevoyages.org>.
Réseau canadien d’information sur le patrimoine, 1999. <www.virtualmuseum.ca/edu/ViewLoitLo.do?method=preview&lang=en&id=11990&lang=EN> Consulté le 3 novembre 2017
Périodiques
L’Univers Illustré, septembre12. 1891.
L’Illustration, 21 mars 1908.
La Dépêche Coloniale Illustrée, 15 mars et 15 août 1908.
Le Tour du Monde, janvier et juillet 1911.
Notes Africaines. Bulletin d’Information et de Correspondance de l’Institut Français d’Afrique Noire (IFAN), nº 24-25, 1945.
House of Commons Parliamentary Papers (hcpp),Slave Trade, 1850-1, Class A, incl. 2 in no 220, “Journal of F. E. Forbes”, entrées des 27 et 29 mai 1850.
Références bibliographiques
ADANDÉ, Joseph. “Du Contact diplomatique au contact des formes entre royaumes Ashanti et du Dahomey. Exemples des trônes et des toiles appliquées”. In: BEAUJEAN-BALTZER, Gaëlle (dir.). Artistes d’Abomey. Paris/ Cotonou: Musée du Quai Branly : Fondation Zinsou, 2009.
ADOUKONOU, B. Jalons pour une théologie africaine: Essai d’une herméneutique chrétienne du Vodun dahoméen. 2 vols. Paris: Lethielleux, 1980.
AKINDELE, A., AGUESSY, C. Contribution à l’étude de l’histoire de l’ancien royaume de Porto-Novo. Mémoire de l’Institut Français d’Afrique Noire, no 25. Dakar: IFAN, 1953.
ARAUJO, Ana Lúcia. “Dahomey, Portugal and Bahia: King Adandozan and the Atlantic Slave Trade”, Slavery and Abolition, vol. 33, no1, pp. 1-19, 2012.
AUBLET, Édouard-Edmond. La Guerre au Dahomey, 1888-1893: D’après les Documents officiels. 2 vols. Paris: Berger-Levrault, 1894-1895.
ASIWAJU, A. I. “The Aja-Speaking Peoples of Nigeria: A Note on Their Origins, Settlement and Cultural Adaptation up to 1945”. Africa: Journal of the International African Institute, vol. 49, no 1, pp. 15-28, 1979.
BEAUJEAN-BALTZER, Gaëlle. “Du Trophée à l’œuvre: Parcours de Cinq Artefacts du royaume d’Abomey”. Gradhiva, no 6, pp. 70-85, 2007.
BERGE, J. A. M. A. R. “Étude sur le Pays Mahi (1926–1928)”. Bulletin du Comité d’Études Historiques et Scientifiques de l’Afrique Occidentale Française, vol. 11, no 4, pp. 708-55, 1928.
BITON, Marlène-Michèle. Arts, politiques et pouvoirs – Les productions artistiques du Dahomey: Fonctions et devenirs. Paris: L’Harmattan, 2010.
BLIER, Suzanne Preston. “The Path of the Leopard: Motherhood and Majesty in Early Danhomè”. Journal of African History, no 36, pp. 391-417, 1995.
BOUCHE, Abbé Pierre Bertrand. Sept ans en Afrique occidentale: La Côte des Esclaves et Dahomey. Paris: Plon, Nourrit et Cie. Imprimeurs-Éditeurs, 1885.
BOURGOIGNIE, Georges E. Les Hommes de l’eau: Ethno-écologie du Dahomey lacustre. Paris: Éditions Universitaires, 1972.
BRUNO, Ernani Silva. Equipamentos, usos e costumes da casa brasileira: Equipamentos. vol. 4. São Paulo: Edusp, Museu da Casa Brasileira, Imprensa Oficial, 2001.
CASTILLO, Lisa Louise Earl. “Em busca dos agudás da Bahia: Trajetórias individuais e mudanças demográficas no século xix”. Afro-Ásia, no 55, pp. 111-147, 2016.
CHARLES-ROUX, Jules. L’Organisation et le fonctionnement de l’exposition des colonies et pays de protectorat: Les Colonies françaises. Paris: Impr. Nationale, 1902.
CODO, Bellarmin Coffi. “Les Afro-brésiliens et la politique française dans le royaume de Xogbonou (seconde moitié du xixe siècle)”. In: COQUERY-VIDROVITCH, Catherine : GOERG, Odile : TENOUX, Hervé (Orgs.). Des Historiens africains en Afrique: Logiques du passé et dynamiques actuelles, Cahiers nos 17-18, L’Harmattan, 1998.
CORNELOUP, Marie M. “Au Dahomey avec Francis Aupiais et Frédéric Gadmer”. In: MUSÉE ALBERT-KAHN. Pour Une Reconnaissance africaine, Dahomey 1930. Département des Hauts-de-Seine: Musée Albert-Kahn, 1996.
CORNEVIN, Robert. Histoire du Dahomey. Paris: Berger-Levrault, 1962.
______. “Auguste Le Herissé (1876-1953)”. In: Hommes et Destins (Dictionnaire biographique d’outre-Mer). vol. i. Paris: Académie des Sciences d’Outre-Mer, 1975.
COSTA E SILVA, Alberto da. A enxada e a lança: A África antes dos portugueses. 2a ed. rev. et el. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1996.
______. Francisco Félix de Souza, mercador de escravos. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2004.
CUNHA, Manuela Carneiro da. Negros estrangeiros: Os escravos libertos e sua volta à África. São Paulo: Brasiliense, 1985.
CURADO, A. D. Cortez da Silva. Dahomé: Esbôço geographico, historico, ethnographico e politico. Lisboa: Typ. do Comercio de Portugal, 1888.
D’ALBÈCA, Alexandre L. “Au Dahomey”. Le Tour du Monde, nos 1753-4, pp. 65-128, ago. 1894. Publié comme livre: D’ALBÈCA, Alexandre L. La France au Dahomey. Paris: Hachette, 1895.
DARESTE, P. : APPERT, G. (Orgs.). Recueil de législation & jurisprudence coloniales. Paris: Marchal & Billard, 1903.
DECKER, Stephanie. “Return to Imperial Trade? John Holt & Co. (Liverpool) Ltd. as a Contemporary Free-Standing Company, 1945-2006”. In: HAGGERTY, Sheryllynne : WEBSTER, Anthony : WHITE, Nicholas J. (Orgs.). The Empire in One City? Liverpool’s Inconvenient Imperial Past. Manchester: Manchester University Press, 2008.
DELAFOSSE, Maurice. Haut-Sénégal-Niger. 3 vols. Paris: Émile Larose, 1912.
D’ELBÉE, François. “Journal du voyage du Sieur Delbée” et “Suite du Journal du Sieur Delbée”. In: CLODORÉ, Jean de (dir.). Relation de ce qui s’est passé dans les Isles & Terre-Ferme de l’Amérique, pendant la dernière guerre avec l’Angleterre, & depuis en exécution du traitté de Bréda. 2 vols. Paris: Gervais Clouzier, 1671.
DELPONT, Hubert. Dax et les Milliès-Lacroix. Nérac: Éditions d’Albret, 2011.
DULUCQ, Sophie. Écrire l’histoire de l’Afrique à l’époque coloniale (xixe-xxe siècles). Paris: Karthala, 2009.
DUNCAN, John. Travels in Western Africa in 1845 and 1846 Comprising a Journey from Whydah, through the Kingdom of Dahomey, to Adofoodia, in the Interior. 2 vols. Londres: Frank Cass & Co., 1968 [1847].
EDWARDS, Elizabeth (dir.). Anthropology and Photography 1860-1920. New Haven/ Londres: Yale University Press : The Royal Anthropological Institute, 1992.
EXPOSITION COLONIAL DE MARSEILLE. Les Colonies Françaises au début du xxe siècle, cinq ans de progrès (1900-1905). 2 vols. Marseille: Barlatier Imprimeur Éditeur, 1906.
FALCON, R. P. Paul. “Religion du vodun”. Études Dahoméennes (nouvelle série), nos 18-9, pp. 1-211, 1970.
FOA, Édouard. Le Dahomey: Histoire, géographie, mœurs Coutumes, Commerce, Industrie, Expéditions Françaises (1891-1894). Paris: A. Hennuyer, 1895.
FORBES, Frederick E. Dahomey and the Dahomans, Being the Journals of Two Missions to the King of Dahomey, and Residence at His Capital, in the Years 1849 and 1850. 2 vols. Londres: [s.n.], 1966 [1851].
GAILLARD, Raoul-Clair-Joseph. “Étude sur les Lacustres du Bas-Dahomey”. L’Anthropologie, vol. 18, pp. 99-125, 1907.
GARCIA Luc. Le Royaume du Dahomé face à la pénétration coloniale: Affrontements et incompréhension (1875-1894). Paris: Karthala, 1988.
GAYIBOR, Nicoué Lodjou. Histoire des Togolais: Des Origines aux années 1960. 3 vols. Paris/ Lomé: Karthala : Presses de l’Université de Lomé, 2011.
GINZBURG, Carlo. “Além do exotismo: Picasso et Warburg”. Relações de força: História, retórica, prova. São Paulo: Companhia das Letras, 2002.
GLÈLÈ-AHANHANZO, Maurice. Le Daxome: Du Pouvoir Ajá à la nation Fon. Cotonou: Nubia, 1974.
GNACADJA, Luc. “Le Bénin”. In: SOULILLOU, Jacques (dir.). Rives Coloniales: Architectures, de Saint-Louis à Douala. Marseille/ Paris: Parenthèses, Ed. de l’Orstom, 1993.
GOERG, Odile. “Le Site du Palais du gouverneur à Conakry: Pouvoirs, symboles et mutations de sens”. In: CHRÉTIEN, Jean-Pierre, TRIAUD, Jean-Louis (Orgs.). Histoire d’Afrique: Les Enjeux de mémoire. Paris: Karthala, 1999.
GOUVERNEMENT GÉNÉRAL DE L’AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE. Le Dahomey. Notices publiées à l’occasion de l’Exposition Coloniale de Marseille. Corbeil-Essonnes: Crété, 1906.
______. Les Chemins de fer en Afrique Occidentale. Paris: Émile Larose, 1906.
GURAN, Milton. Agudas. Os “brasileiros” do Benim. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999.
HERSKOVITS, Melville J. Dahomey, an Ancient West African kingdom. 2 vols. Nova York: J. J. Augustin Publisher, 1938.
HOUARD, A. “Saignées d’Hévéa Medeiros de la plantation de Sakété”. Bulletin du Comité d’Études Historiques et Scientifiques de l’Afrique Occidentale Française, Paris, Larose, pp. 513-4, 1921.
HOUSEMAN M. et al. “Note sur la structure évolutive d’une ville historique”. Cahiers d’Études Africaines, vol. 104, no 26, pp. 527-46, 1986.
LAMB, Bulfinch. “From the Great King Trudo Audati’s Palace of Abomey in the Kingdom of Dahomet”, 27 nov. 1724. In: SMITH, William. A New Voyage to Guinea. Londres: [s.n.], 1744.
LAW, Robin. The Slave Coast of West Africa 1550-1750: The Impact of the Atlantic Slave Trade on an African Society. Oxford: Clarendon, 1991.
______. The Kingdom of Allada. Leiden: Research School cnws : cnws Publications, 1997.
______. Ouidah: The Social History of a West African Slaving Port, 1727-1892. Oxford: James Currey, 2004.
______. “Francisco Félix de Souza in West Africa, 1800-1849”. In: CURTO, José C., LOVEJOY, Paul E. (Orgs.). Enslaving Connections: Western Africa and Brazil during the Era of Slavery.Amherst, NY: Humanity Books, 2004.
LE HERISSÉ, Auguste. L’Ancien Royaume du Dahomey: Mœurs, religion, histoire. Paris: Émile Larose, 1911.
LE HERISSÉ, René. Voyage au Dahomey et à la Côte d’Ivoire. Paris: Henri Charles-Lavauzelle, 1903.
LEPAIRE, Hughes. “La Campagne du Dahomey – 1982. Notes de voyage”. La Revue Blanche, pp. 42-61, 1o sem. 1985.
LOMBARD, Jacques. “Contribution à l’histoire d’une ancienne société politique du Dahomey: La Royauté d’Allada”. Bulletin de L’IFAN, série. B, vol. 29, nos 1-2, pp. 40-66, 1966.
MAIRE, Victor-Louis. Dahomey. Abomey: la dynastie dahoméenne. Les palais: leurs bas-reliefs. Besançon: Abel Cariage, 1905.
MANNING, Patrick. “Merchants, Porters, and Canoemen in the Bight of Benin: Links in the West African Trade Network”. In: COQUERY- VIDROVITCH, Catherine et LOVEJOY, Paul E. (dir.). The Workers of African Trade. Beverly Hills, Londres, New Dehli: Sage Publications, 1985.
________ Slavery, Colonialism and Economic Growth in Dahomey, 1640-1960. Cambridge: Cambridge University Press, 2004 [1982]. (African Studies Series, 30.)
MERCIER, Paul ; lombard, Jacques. “Guide du musée d’Abomey”. Études Dahoméennes, ifan, 1959.
MONROE, J. Cameron. The Precolonial State in West Africa: Building Power in Dahomey. New York: Cambridge University Press, 2014.
MOREAU, Daniela. Fortier photographe, de Conakry à Tombouctou – images de l’Afrique de l’ouest en 1906, Milan : 5 Continents, 2018.
MUDIMBÉ, V. Y. A invenção de África. Lisbonne/ Luanda: Pedago : Mulemba, 2013 [1988].
MULIRA, Jessie Gaston. A History of the Mahi Peoples from 1774-1920. (Thèse – doctorat) — University of California, Los Angeles, 1984.
MUSÉE ALBERT-KAHN. Pour Une Reconnaissance africaine, Dahomey 1930: Des Images au service d’une idée: Albert Kahn, 1860-1940 [et] le père Aupiais, 1877-1945. Département des Hauts-de-Seine: Musée Albert-Kahn, 1996.
MUSÉE DE BORDA. Une Mémoire d’Afrique — 1908, Voyage de Raphaël Milliès-Lacroix en Afrique de l’Ouest: 100 Ans après sa collection sort de l’ombre. Notice de l’exposition. Dax, Imp. Barrouillet, 2009.
OLINTO, Antônio. Brasileiros na África. Rio de Janeiro: Editora grd, 1964.
PARÉS, Luis Nicolau. A formação do Candomblé: História e ritual da nação jeje na Bahia. Campinas: Ed. Unicamp, 2007.
______. “Cartas do Daomé: Uma introdução”. Afro-Ásia, no 47, pp. 295-395, 2013.
______. O rei, o pai e a morte: A religião Vodum na antiga Costa dos Escravos na África Ocidental. São Paulo: Companhia das Letras, 2016.
person, Yves. “Chronologie du royaume gun de Hogbonu (Porto-Novo)”. Cahiers d’Études Africaines, vol. 15, no 58, pp. 217-238, 1975.
piqué, Francesca, rainer, Leslie. H. Les Bas-reliefs d’Abomey: L’Histoire racontée sur les murs. Bamako: Jamana, 1999.
pires, P. Vicente Ferreira. Viagem de África em o reino de Dahomé. São Paulo: Companhia Editora Nacional (introdução de Clado Ribeiro de Lessa), 1957 [1800].
reis, João José. Rebelião escrava no Brasil: A história do levante dos malês em 1835. Ed. rev. et el.São Paulo: Companhia das Letras, 2003.
santos, Flavio G. dos. Economia e cultura do candomblé na Bahia: O comércio dos objetos litúrgicos afro-brasileiros, 1850-1937. Ilhéus: Editora uesc, 2013.
savariau, Norbert. L’Agriculture au Dahomey. Paris: A. Challamel, 1906.
savary, Claude. La Pensée symbolique des fô du Dahomey: Tableau de la société et étude de la littérature orale d’expression sacrée dans l’ancien royaume du Dahomey. Genève: Éditions Médecine et Hygiène, 1976.
______. “Rôle du vêtement et de la parure dans les rites vodun chez les Fon (République Populaire du Bénin)”. In: engelbrecht, Beate et gardi, Bernhard (Orgs.). Man Does Not Go Naked. Bâle: Ethnologisches Seminar der Universität und Museum für Völkerkunde, 1989.
segurola, R. P. B. et rassinoux, J. Dictionnaire Fon-Français. Cotonou: Société des Missions Africaines, 2000 [1963].
simon, M. Souvenirs de brousse. Paris: Nouvelles Éditions Latines, 1965.
soares, Mariza de Carvalho.“Trocando galanterias: A diplomacia do comércio de escravos, Brasil-Daomé, 1810-1812”. Afro-Ásia, no 49, pp. 229-271, 2014.
sonolet, L. L’Afrique Occidentale Française. Paris: Hachette et Cie., 1912.
souza, Mônica Lima e. Entre margens: O retorno à África de libertos no Brasil 1830-70. Thèse (doctorat) — Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro, 2008.
soumonni, Elisée. “Lacustrine Villages in South Benin as Refuges from the Slave Trade”. In: diouf, Sylviane Anna (dir.). Fighting the Slave Trade: West African Strategies. Athens: Ohio University Press, 2003.
sweet, James H. Domingos Alvares. African Healing, and the Intellectual History of the Atlantic World. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2011.
thompson, Robert F. “The Sign of the Divine King: Yoruba Bead-Embroidered Crowns with Veil and Bird Decorations”. In: fraser, Douglas et cole, Herbert M. (Orgs.). African Art & Leadership. Madison: University of WisconsinPress, 1972.
______. “Crown”. Nigeria Magazine, no 84, p. 22, 1965. In: vogel, Susan Mullin (dir.). For Spirits and Kings: African Art from the Paul and Ruth Tishman Collection. New York: The Metropolitan Museum of Art, 1981.
turner, Lorenzo D. “Some Contacts of Brazilian Ex-Slaves with Nigeria, West Africa”. Journal of Negro History, vol.27, no 1, pp. 55-67, 1942.
turner, Jerry Michael. Les Brésiliens: The Impact of Former Brazilian Slaves upon Dahomey. Thèse (doctorat) — Boston University, Boston, 1975.
verger, Pierre. Notes sur le culte des orisa et vodun à Bahia, la baie de tous les Saints au Brésil et à l’ancienne Côte des esclaves en Afrique. Dakar: ifan, 1957. (Mémoires de l’Institut Français d’Afrique Noire, no 51.)
______. Fluxo e Refluxo do tráfico de escravos entre o Golfo do Benim e a Bahia de Todos os Santos. São Paulo: Corrupio, 1987 [1960].
______. “Correspondência de Pierre Verger com Vivaldo da Costa Lima, 1961-1963”. Afro-Ásia, no 37, pp. 241-88, 2008.
videgla, D. K. M. et iroko A. F. “Nouveau Regard sur la révolte de Sakété en 1905”. Cahiers d’Études Africaines, vol. 24, no 93, pp. 51-70, 1984.
vignola, Amedée. L’Humanité Féminine: Revue Hebdomadaire Universelle Illustrée, Paris, Librairie Documentaire, nos 5, 12, 14, 21, 22 e 23, 1906-7.
waterlot, G. Les Bas-Reliefs des bâtiments royaux d’Abomey (Dahomey). Paris: Institut d’Ethnologie, 1926.
Glossaire
A
abakué (àbăkwɛ́): bracelet de coquillages cauris, signe distinctif des adeptes des voduns Nesuhue.
adănhŭn: rythme des tambours et danse à connotation martiale, littéralement « rythme de la colère ».
adé: Couronne yoruba recouvrant le visage d’une rangée de perles.
aglèlélé (var. gagamiglèlè) : hommes masqués marchant sur des échasses.
ahosu (axɔ́sú) : roi.
ahovi: collectivités familiales ou lignages de princes dans le royaume du Dahomey.
akplo (var. akplă) : lance.
àkwɛ́ (var. kwɛ́) : argent ou cauris.
aláàfin: nom du roi dans le royaume d’Oyo.
alinglé: cloche en fer utilisée par les voduns.
anato: collectivités familiales ou lignées plébéiennes dans le royaume du Dahomey.
asogüe (asogwe) : sistre ou hochet constitué d’une calebasse recouverte d’un filet de perles ou de graines.
asi: épouse.
atchiná (aciná) : siège ou adresse des voduns, constitué d’un tronc orné de plumes et de bandes de tissu coloré, porté sur le dos du vodunon.
atín: arbre.
atínkwín: graines de couleur sombre utilisées dans les colliers vodun.
atinmévodun (atinmɛ́vodún) : vodun des arbres, généralement associé aux atchinás.
ato: plate-forme ou plate-forme surélevée depuis de laquelle le roi du Dahomey distribuait des cadeaux au peuple pendant les fêtes des Coutumes.
avò (avɔ̀) : grandes pièces d’étoffe rituelles (voir wlŏ ganlìn et nyìavɔ̀ kɔ̀).
avlayá (var. vlayá) : jupe courte utilisée par les voduns comme Sakpata ou Hevioso.
ayìɖóhwεɖó: arc-en-ciel associé au vodun Dan.
ayinon: propriétaire de la terre.
B
bokono (bokɔ́nɔ̀) : devin du système Fa, médecin ou spécialiste de la préparation des remèdes consacrés.
D
dĕzàn : littéralement « branche de palmier » ; chapeau ou bonnet en paille tressée.
E
egunguns: ancêtres yorubas.
G
gagamiglèlè: voir aglèlé.
gbejè: chapeau de feutre utilisé par les voduns.
gŭbasá : épée.
H
hotin: pilotis.
hui (hwĭ) : poignard.
hundja: trône royal sculpté dans le bois.
hùntín (hŭn atín) : Fromager.
hunvé (hunvɛ) : voduns rouges, souvent associés à atinmévodun.
K
Kanhodenu (kanxweɖenu, var. afafafa) : collier de perles colorées enfilées dans un fil de forme circulaire, Caractéristique des voduns Nesuhue.
kataklɛ̀ : type de tabouret à trois pieds fait d’une seule pièce de bois.
kεsɛ́ : plume de perroquet rouge.
kpezìn: tambour constitué d’une jarre en céramique recouverte de paille ou d’osier, utilisé pour les cérémonies funéraires et autres célébrations.
kpogɛ̀ : grand bâton distinctif des grands vodunons ou chefs religieux.
kwɛ́ (var. àkwɛ́) : argent ou cauris.
L
laptot: marinier africain (piroguier).
lenhun (lɛ̀nhun) : un type de tambour.
M
mahisi: vodúnsis des Nesuhuesi de haut rang.
N
Nesuhue (Nɛ̀súxwé) : culte aux ancêtres royaux du Dahomey. Catégorie de vodúns regroupant les tovodum et les tohosu.
nesuhuesi: vodunsi des Nesuhue.
nyì av ɔ̀kɔ̀ : pièce de tissu rituel porté sur le cou.
O
oba: roi en yoruba.
R
récade: le sceptre des rois.
S
sɔ́kplá : colliers alternant cauris blancs et graines sombres, associé au vodun Sakpata.
sɔ́sí: queue de cheval.
symbodji (síngbójí) : littéralement « grande maison au-dessus » ou maison à étages. Désigne la place devant le palais principal d’Abomey.
sò: tonnerre
sosyɔ́ví: emblème du vodun Hevioso ou hache de tonnerre.
T
takàn: bande de tissu ou ruban que les vodúnsis s’attachent sur la tête. Les vodúnsis de Hevioso, Dan, Sakpata et autres vodun publics utilisent le takàn avec une plume de perroquet.
tam-tam: tambour, ou cérémonie avec percussions et danse.
tɔ̀ : eau, cours d’eau, rivière.
tohosu: de tɔ̀ et ahosu, littéralement « roi des eaux ». Après la noyade rituelle d’enfants, leurs esprits sont installés dans des vases, placés sur des autels spéciaux.
tohuiyo (toxwyɔ́) : ancêtre fondateur d’une lignée ou famille.
tovodum: catégorie de vodúns Nesuhue qui correspond aux esprits des rois, princes et princesses et autres dignitaires de la cour du Dahomey.
V
vlayá (var. avlayá) : jupe courte utilisée par des voduns tels que Sakpata ou Hevioso.
vodun (vodún) : entité spirituelle, dieu, force invisible, mystère.
vodunon (vodúnnɔ́) : littéralement « propriétaire » ou « gardien » du vodun ; grand prêtre du temple.
vodúnsi: littéralement « épouse du vodun »: personne initié (homme ou femme) en qui s’incorpore, par la transe, la divinité.
W
wlŏ ganlìn: pièce de tissu rituelle portée à la taille, partiellement enroulée.
X
xaxará: emblème rituel du vodún Sakpata.
xɔ: maison ou pièce
xù: mer.
Zzεnlì: cérémonies funéraires. Peut aussi désigner un instrument de percussion et la musique chantée dans les rites funéraires.